L’homme est-il la mesure de toute chose ? Tout est-il relatif ? En 1885, Marcellin Berthelot disait du monde dans Les Origines de l’alchimie qu’il était « désormais sans mystère ». En 1916, Albert Einstein publie sa théorie de la relativité générale, produit d’une longue investigation dans le champ scientifique. Cette théorie ne doit pourtant pas faire oublier le caractère métaphysique de la relativité, car la relativité est aussi le produit de valeurs, de représentations, de principes. Peut-on alors, après la détonation historique des découvertes d’Einstein, examiner l’épaisseur métaphysique de la relativité ?

Solitaire, attentif autant que lunaire, Einstein a toujours considéré la manière de penser comme similaire au fonctionnement de la réalité physique et a souvent trouvé ses inspirations en marge de l’institution scolaire. Chez lui, la réalité est toujours intelligible. Nous pouvons la penser, la saisir, la représenter sans en donner un caractère illusoire. A cette intuition qui couvre son jeune âge, Einstein va répondre toute sa vie pour enfanter la théorie de la relativité restreinte, qui s’élargira ensuite à la structure de l’univers et aux déformations de l’espace conduite par le phénomène de gravitation. Einstein prend au sérieux les scientifiques qui le précèdent. Continuant les travaux de Michelson et Morley, celui qui restera dans les esprits comme le père de la physique moderne va entendre une découverte qui rompt déjà avec son époque en 1905 : le temps et l’espace ne sont pas absolus, mais relatifs. La théorie de la relativité restreinte, comme une marche vers sa théorie de la relativité générale qu’il publiera dans le numéro 49 de la revue Annalen der Physik, est posée. Einstein questionne alors sérieusement le rôle de l’observateur et affirme qu’une unité (temporelle ou spatiale) n’est pas identique en tout lieu. La distance ou le temps dépendent directement du déplacement même de l’observateur. Cette idée qui préfigure les avancées de la physique quantique donnera l’image souvent reprise pour vulgariser la théorie du scientifique : un astronaute qui voyage à la vitesse de la lumière dans l’espace ne subit pas la même temporalité que tous les êtres humains restés sur la terre. Si ce phénomène inspira de nombreux réalisateurs, ce qui est important ici est de mesurer l’impact du mouvement sur le temps qui passe dans un espace donné, ces deux derniers étant relatifs au premier.
Ce premier développement, par l’application à la notion d’énergie et de masse, va trouver son accomplissement dans la fameuse formule E=mc², ou autrement dit le fait que l’énergie augmente à mesure que la masse se met en mouvement. Le résumé du passage de l’Evangile de Marc (11, 23 :24) sous la formule éculée « la foi déplace des montagnes » trouve alors son écho physique : quelque chose de presque immatériel, ou du moins une quantité modeste de matière, peut impliquer la libération d’une énergie gigantesque si la vitesse appliquée sur cette matière est elle-même considérable. Avec peu, on peut déplacer beaucoup, mais encore faut-il que ce peu de matière aille vite. Le principe de la fusion nucléaire doit se comprendre à partir de cette découverte.
De la relativité restreinte à la relativité générale

Dix années de recherche vont pousser cette théorie de la relativité restreinte à s’élargir au domaine gravitationnel pour donner, sur fond de géométrie différentielle, la théorie de la relativité générale qui s’éloigne radicalement de la vision développée par Newton. Gardant cette idée d’une quantité de matière propulsée à une vitesse importante, Einstein va étudier les phénomènes gravitationnels sur les corps en mouvement, permettant de représenter la structure même de l’univers. Rompant avec la géométrie euclidienne, l’espace se conçoit comme courbé, déformé sous l’action des forces en vigueur. C’est ce que l’on entend communément par la courbure de l’espace-temps : l’espace et le temps s’influencent réciproquement, et cet espace-temps prend sur lui l’empreinte marquée des masses qui le parsèment. La célèbre théorie définit donc la gravitation non pas comme une force mais comme une courbure de l’espace-temps, elle-même conséquence d’une répartition d’énergie. Ce phénomène de gravitation qui permet de comprendre la structuration de l’univers est ainsi jugé « relatif », changeant selon la place de l’observateur.
Le présupposé métaphysique à la théorie scientifique
Une fois posé ce caractère relativiste qui structure le monde physique, que dire ? Nous voilà donc avec une théorie et son amas de mots : relativité, référentiel, distance, vitesse, temps, observateur, etc. Mais le bon sens des enfants que nous sommes restés interroge encore le « pourquoi » des choses, cherchant moins à décrire un fonctionnement mécanique qu’à trouver du sens dans l’écho énigmatique du monde, et c’est le drame de l’époque moderne d’avoir voulu conjoindre les deux approches. Et cette question du sens, c’est toujours la question d’une métaphysique, d’une philosophie qui ne peut être totalement absente de la théorie scientifique.
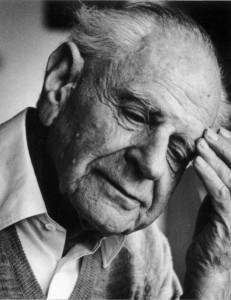
Car la science même ne peut se passer de la métaphysique. Dans La Structure des Révolutions scientifiques (1962), Thomas Kuhn montre justement que les théories scientifiques s’organisent autour de principes qui, eux, ne découlent pas logiquement de l’expérience. Ces principes, qui sont dans le vocable de Kuhn des « paradigmes », des matrices qui cadrent l’activité du chercheur, supposent une théorie scientifique toujours en construction, nécessitant un consensus dans la communauté scientifique. Kuhn définit ces paradigmes en partie par une vision du monde qui est sous-entendue par la théorie scientifique à justifier. Cette vision peut tout fait être une métaphysique. En ce sens, nous pouvons parler de paradigme platonicien ou aristotélicien, mais également de paradigme newtonien, laplacien ou du paradigme de la relativité générale d’Einstein. Concevoir l’espace-temps comme une courbe relève d’un paradigme. Par extension, on pourrait même dire que face à certains problèmes scientifiques certains paradigmes soient plus ou moins adaptés à la résolution. Karl Popper, bien que non avare en critiques envers Kuhn, a nourri cette approche et considéra avec raison que c’est bien la science qui repose sur des présupposés métaphysiques et non la philosophie, la science étant « la fille de la métaphysique ». C’est pourquoi Popper parlera de « présupposés métaphysiques » dans le développement scientifique. L’entreprise positiviste de disjoindre la physique et la métaphysique ou d’imposer la domination de l’empirisme sur le domaine de l’idéalité est donc une erreur sur la méthode d’élaboration des théories scientifiques elles-mêmes. Encore une fois comme le disait Rabelais, « science sans conscience n’est que ruine de l’âme ».
Une approche de la réalité par le logos

Avant les grandes découvertes de la physique moderne et de l’empirisme, avant les vérifications permises par la technique dont disposent nos laboratoires les plus perfectionnés, les premiers à interroger dans la rigueur philosophique le caractère de la réalité sont les grecs. Et il est étonnant de voir, bien au-delà d’une vision unitaire et monolithique de la réalité, que Platon questionne l’Être dans son caractère pluriel, et contient par son travail sur le logos les germes de la physique à venir, plus de 2000 ans avant Einstein. Dans Le Parménide de Platon ou le jeu des hypothèses (2000), le trop méconnu Alain Séguy-Duclot propose une vision autant originale que solide, celle d’un Platon « plus fort que soi-même », qui aurait élaboré une théorie différentielle de la vérité et de l’Être qui ferait place à une pluralité des points de vue sur le réel qu’ont défendu les philosophes et les sophistes. L’altérité ne se joue alors pas par rapport à l’Être conçu comme un Etant immobile, absolu, identique à soi, mais elle se joue à l’intérieur de l’Être dans les relations qui unissent et disjoignent réciproquement les uns aux autres, car on est toujours l’autre de quelqu’un. Einstein n’est donc pas bien loin de ce dernier Platon, et le monde grec n’en finit toujours pas d’illuminer notre époque.
Les sophistes, les parménidiens, les héraclitéens, ou encore les modernes auraient tous en un sens raison, leur tort aurait été d’une part de prétendre qu’ils avaient absolument raison, comme pour remplacer Dieu en conférant une valeur de vérité globale sur une dimension partielle, et d’autre part de mésinterpréter le sens du mot être en l’assimilant trop exclusivement à la seule dimension sensible ou intelligible de la réalité, comme si l’une ou l’autre de cette dimension était exclusive de l’autre. En somme, le monde de la modernité n’existe pas : il n’y a qu’un point de vue moderne sur le monde, un point de vue qui est déjà le produit d’une métaphysique, et donc d’une volonté souterraine, d’instincts, d’affects, de pulsions cachées. Si le monde moderne est un grand cadavre comme le dit Péguy, c’est par déduction que ces pulsions étaient morbides.
Crédit photo : Ernest hass studio
