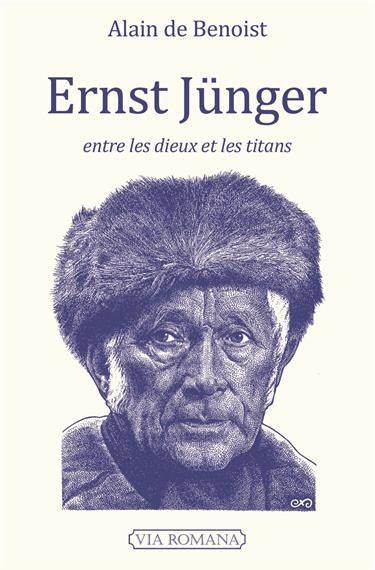Alain de Benoist est écrivain et journaliste. Théoricien de la « Nouvelle Droite », il a participé à la fondation des revues Éléments, Nouvelle École et Krisis. La critique de la modernité, de l’ethnocentrisme, ainsi que la défense des autonomies locales sont au cœur de son œuvre prolifique (plus de 50 ouvrages et 3 000 articles publiés). Il a publié récemment Ernst Jünger, entre les dieux et les titans (Via Romana) dans lequel il aborde les liens entre les œuvres de l’auteur d’Orages d’acier et Drieu la Rochelle.
PHILITT : Ernst Jünger et Drieu la Rochelle, tous deux anciens combattants partis au front en 1914, ne sauraient être étudiés sans une analyse de leur rapport à la guerre. Cette expérience fondatrice a profondément marqué leur vision du monde, ainsi que leur rapport à la technique. Opposés l’un à l’autre sur la ligne de front, les deux hommes ont-ils toutefois développé une vision commune de la guerre ?
Alain de Benoist : Il ne fait pas de doute que la Première Guerre mondiale a marqué Drieu et Jünger d’une manière indélébile : expérience plus existentielle chez Drieu, expérience plus intérieure chez Jünger. Dans Orages d’acier, Jünger écrit : « De tous les moments excitants vécus dans la guerre, aucun n’est aussi fort que celui de l’affrontement entre deux escouades d’assaut dans les étroits boyaux des positions de combat ». L’épreuve du feu survenue pour Drieu le 23 août 1914 dans la plaine de Charleroi, dans laquelle il entraîna lui-même plusieurs de ses camarades, est restée pour lui inoubliable. Ce fut, il l’a dit et répété, l’expérience la plus forte de sa vie. « J’ai senti à ce moment-là l’unité de la vie. Même geste pour manger et pour aimer, pour agir et pour penser, pour vivre et pour mourir ». Il s’est, en d’autres termes, brusquement senti capable, un bref instant, de réconcilier les impulsions contradictoires qu’il a toujours ressenties en lui. Ajoutons que Drieu et Jünger se sont parfois battus au même endroit, de part et d’autre de la ligne du front (mais pas au même moment). Et qu’en partant pour la guerre, ils semblent avoir eu l’un et l’autre dans leur musette un exemplaire du Zarathustra de Nietzsche..
Cela dit, c’est aussi la comparaison de ce qu’ils ont en commun qui fait le mieux apparaître, par contraste, tout ce qui les distingue. Alors que Drieu part au front comme conscrit, Jünger se porte volontaire dès août 1914. Deux ans plus tôt, il a déjà tenté de s’engager dans la Légion étrangère. On sait que son engagement, et son courage, lui vaudront quatorze blessures et la croix Pour le mérite. Il n’en est pas moins resté jusqu’à la fin à la tête d’une section d’assaut qu’il n’a jamais quittée. Drieu, lui, n’a pas pris part aux combats que d’une façon intermittente. À Verdun, il est blessé après un seul jour de combat, le 26 février 1916, avant d’être évacué. Même chose à Charleroi, puisqu’il sera versé au mois de décembre dans le service auxiliaire avant d’être à nouveau évacué. Il n’a d’ailleurs reçu la Croix de guerre qu’après l’armistice. Dans l’un des textes de Sur les écrivains (« Réflexions sur son œuvre »), il l’a reconnu lui-même : par opposition à Erich Maria Remarque, l’auteur d’À l’Ouest rien de nouveau, « ni moi ni Montherlant ne sommes restés jamais longtemps au front, et cela fait toute la différence ». Une grande différence en effet.
On sait que les premiers livres de Jünger puisent leur inspiration dans ses carnets de guerre. Les Orages d’acier, d’abord publiés à compte d’auteur en 1920, et qui vont connaître à partir de leur deuxième édition, en 1922, un succès toujours croissant, montrent bien que la Première Guerre mondiale, qu’il a décrite quasiment dans le feu de l’action, est à l’origine de sa vocation d’écrivain. Drieu, lui, à l’exception de ses deux premiers recueils de poésie, Interrogation et Fond de cantine, n’a guère écrit sur la guerre. Il a attendu vingt ans pour rédiger les six nouvelles qui composent La comédie de Charleroi. (En outre, ayant été réformé en 1939, il ne participera pas à la Deuxième Guerre mondiale).
Drieu tire de la guerre un sentiment d’exaltation éminemment personnel : la guerre a été pour lui l’occasion de connaître des situations qu’il n’oubliera jamais. Jünger, qui donne au courage beaucoup plus d’importance que Drieu, y voit un moyen de sélectionner un type d’homme. En outre, il adhère à cette époque à une conception guerrière de l’existence (« c’est la vie, sous le plus terrible aspect que le créateur lui ait jamais donné »), voire à une mystique de la guerre, ce qui n’est pas du tout le cas de Drieu (qui, dans les années 1920, penchera même vers le pacifisme). La guerre est à ses yeux un fait de nature, et d’abord de nature humaine : « La guerre n’est pas instituée par l’homme, pas plus que l’instinct sexuel ; elle est loi de nature, c’est pourquoi nous ne pourrons jamais nous soustraire à son empire. » On pourrait dire que, paradoxalement, c’est dans la guerre que l’homme trouve les conditions de mettre en œuvre sa pleine humanité – y compris de faire la guerre sans haine pour l’ennemi (le vrai guerrier fait la guerre pour lui-même avant de la faire contre ceux d’en face). « Une civilisation peut être aussi supérieure qu’elle veut, si le nerf viril se détend, ce n’est plus qu’un colosse aux pieds d’argile. »
Les deux écrivains ont cependant mesuré l’un et l’autre combien la Grande Guerre, commencée en 1914 comme une guerre classique, s’est transformée peu à peu en une guerre d’un type totalement nouveau : un déploiement de forces impersonnelles gigantesques, un « duel de machines si formidable qu’auprès de lui l’homme n’existe pour ainsi dire plus », dira Jünger. Mais l’avènement de la « guerre technique » – « cette guerre de fer et non de muscles » – a surtout provoqué l’horreur chez Drieu, qui y verra une « révolte maléfique de la matière asservie par l’homme », une véritable « boucherie industrielle », alors que chez Jünger, qui voit bien en quoi cette guerre s’apparente à une forge volcanique, où les éléments se déchaînent de façon titanesque, elle fera naître l’intuition d’un nouveau type humain, totalement opposé à celui du bourgeois : le Travailleur, dont le « réalisme héroïque » serait capable d’assurer la mise en mouvement (Mobilmachung) du monde. Alors que Drieu s’en tient à la déploration, pour Jünger, les « armées de machines » annoncent les « bataillons d’ouvriers », l’expérience de la guerre devant conférer à l’homme une disposition (Bereitschaft) à la « mobilisation totale », c’est-à-dire à une volonté de domination (Herrschaft) qui s’exprime par les moyens de la Technique. Drieu, même s’il écrit qu’« il faut maintenant que l’homme apprenne à maîtriser la machine, qui l’a outrepassé dans la guerre », ne partage en rien cette vision à la fois optimiste et volontariste, que l’écrivain allemand développera en 1932 dans son célèbre livre Le Travailleur, en faisant l’éloge de cette Technique dont il condamnera plus tard, sous l’influence de son frère Friedrich Georg, le caractère « titanesque ».
Drieu et Jünger s’accordent bien sûr également pour constater que la Grande Guerre a mis un terme à la guerre « en forme » (Vattel) qui conservait encore quelque parenté avec la guerre de chevalerie. Mais Jünger comprend aussi que la guerre est désormais une « guerre totale », expression dont il faut préciser le sens. La guerre totale n’est pas la « guerre absolue » (absoluter Krieg) dont parlait Clausewitz, qui résulte seulement d’une montée aux extrêmes pouvant éventuellement conduire à la « guerre d’anéantissement » où l’ennemi, même s’il n’est pas totalement détruit, devient incapable de poursuivre le combat. L’idée la plus importante, que les milieux conservateurs et réactionnaires n’ont en général pas encore compris, est plutôt l’idée que la guerre n’est plus désormais chose exclusivement militaire, et que la guerre interétatique classique est en passe de céder la place à la guerre économique et impérialiste. Ce que Léon Daudet avait très bien entrevu dès 1918, dans son livre précurseur précisément intitulé La guerre totale : « C’est l’extension de la lutte aux domaines politique, économique, commercial, industriel, juridique et financier. »
Les deux écrivains ont utilisé l’utopie romanesque – Jünger avec Sur les falaises de marbre ou Héliopolis et Drieu avec Beloukia ou L’homme à cheval – dans une époque où le genre était encore assez rare. Au-delà de cette similarité, les deux écrivains partagent-ils d’autres traits communs dans leur œuvre littéraire ?
Je ne suis pas assez critique littéraire pour répondre correctement à cette question. Du point de vue de l’écriture, ce qui me frappe néanmoins chez Drieu, c’est sa propension à une certaine forme de confession, où il se livre sans détours ni indulgence vis-à-vis de lui-même. On le voit bien dans les textes de lui qui ont été publiés après sa mort, qu’il s’agisse de Récit secret ou du Journal 1939-1945 (qui reprend le précédent). Sauf erreur, Jünger ne s’est jamais livré de la sorte et n’en a visiblement pas éprouvé le besoin. Tous les carnets qu’il a tenus ont été publiés de son vivant.
Comme le souligne Julien Hervier dans son livre Deux individus contre l’histoire : Drieu et Jünger , « ce qui frappe chez Drieu comme chez Jünger, c’est le mélange détonnant qui se produit en eux entre un esprit réactionnaire incontestable et une volonté révolutionnaire ». Jünger fut ainsi proche au sortir de la Grande Guerre d’Ernst Niekisch, le penseur du national-bolchevisme, et Drieu se tourna lui vers le fascisme. Comment se caractérise dans l’entre-deux-guerres leur tentative politique respective d’une troisième voie au-delà de la droite et de la gauche ?
Tous deux ont incontestablement été des conservateurs révolutionnaires, désireux de sauvegarder des valeurs qu’ils jugeaient éternelles, mais en même temps conscients que l’avènement du monde moderne a créé des ruptures sur lesquelles on ne saurait revenir. Mais à mon avis, la ressemblance ne va guère plus loin. L’engagement politique de Jünger se situe dans le prolongement direct de son expérience du front : après avoir perdu la guerre, le Soldat du front doit « gagner la nation ». Dans cette optique, la défaite allemande peut même devenir un atout : « L’Allemagne a été vaincue, mais cette défaite a été salutaire parce qu’elle a contribué à faire disparaître la vieille Allemagne […] Il fallait perdre la guerre afin de gagner la nation. » Rien de tel chez Drieu, qui ne s’engage vraiment en politique qu’au moment où Jünger commence au contraire à s’en détourner.
Au tout début des années 1920, Ernst Jünger a très vite été considéré comme le plus brillant des écrivains de la génération du front. Installé à Leipzig à partir de 1923, après avoir quitté la Reichswehr, il se rapproche des organisations liées aux corps-francs (la brigade Ehrhardt, l’organisation Rossbach) et de certaines ligues bündisch rattachées au Mouvement de jeunesse (Jugendbewegung), fréquente d’innombrables cénacles et groupes nationalistes et se jette à corps perdu dans la politique, avec son frère Friedrich Georg. Cet engagement incandescent, dans une époque qui ne l’est pas moins, l’amène à écrire pour toute une pléiade de revues (Arminius, Vormarsch, Die Kommenden, Widerstand) environ 140 articles dans lesquels il prône un « nouveau nationalisme » d’inspiration soldatique et nationale-révolutionnaire. (Ces écrits de jeunesse, republiés il y a quelques années en Allemagne, puis traduits en italien, restent à ce jour inédits en français). « Si l’on veut mettre le programme que Niekisch développa dans Widerstand sous la forme d’une sèche alternative, écrira-t-il, c’est quelque chose comme : contre le bourgeois, pour le travailleur, contre le monde occidental, pour l’Est. »
Les grands essais politiques paraissent à partir de 1929. C’est d’abord la première version du Cœur aventureux (1929), puis La mobilisation totale (1931), et enfin Le Travailleur, qui est publié en 1932, à Hambourg, par la Hanseatische Verlagsanstalt que dirige Benno Ziegler. Dans sa jeunesse, sans doute précisément sous l’influence de Niekisch, Jünger en est parfois venu à voir dans les communistes les meilleurs préparateurs de la « révolution sans phrases » qu’il célèbrera dans Le Travailleur. Plus tard, cependant, et dans une toute autre optique, il soulignera à quel point le communisme et le national-socialisme ont pareillement introduit la technique dans la vie politique, manifestant ainsi une même adhésion à la modernité, sous l’horizon d’une volonté de puissance que Heidegger a su démasquer comme simple « volonté de volonté ». On trouve des réflexions analogues dans Genève ou Moscou (1928), où Drieu souligne que capitalisme et communisme sont tous les deux héritiers de la Machine : « L’un et l’autre sont les enfants ardents et sombres de l’industrie. »
Peut-être déjà inquiet de la montée du nazisme, Jünger prend radicalement ses distances avec la politique au moment même où Drieu s’y engage tout aussi résolument. Il publie Socialisme fasciste en 1934, puis adhère trois ans plus tard au PPF de Jacques Doriot, dont il s’éloignera dès 1938 en lui reprochant de n’être pas un « vrai révolutionnaire » (sa démission définitive du PPF date de 1939). En 1933, pourtant, il s’était rapproché du courant de gauche animé par Gaston Bergery au moment où celui-ci lançait un « Front commun contre le fascisme ! » Entretemps, il faut bien le dire, que le spectacle des manifestations du 6 février l’a enthousiasmé.
Dans Socialisme fasciste, Drieu oppose Nietzsche à Marx : « Nietzsche contre Marx, Nietzsche succédant à Marx, Nietzsche véritable prophète et inspirateur des révolutions d’après-guerre. » Mais ce serait une grande erreur de croire que Drieu regarde la politique comme le domaine des idées en acte. Il la voit tout au contraire comme une action pure, par opposition à tout intellectualisme, comme un moyen de prendre congé des idées, c’est-à-dire de l’intelligence abstraite. Mais tout en dénonçant l’intellectualisme, il n’ignore pas lui-même qu’il est un intellectuel. Dans la « péroraison » de son Exorde (qui ne sera publié qu’en 1961, en même temps que le Récit secret), on lit : « Je me suis conduit en pleine conscience, selon l’idée que je me suis fait des devoirs de l’intellectuel. L’intellectuel, le clerc, l’artiste, n’est pas un citoyen comme les autres. Il a des devoirs et des droits supérieurs à ceux des autres. »
Comme l’a bien noté Julien Hervier, la nécessité de l’engagement relève donc pour Drieu d’une éthique de l’action pour l’action. Il s’engage, non par provocation, mais parce que ne pas s’engager serait une lâcheté : dans la vie, il faut s’obliger à se salir les mains. Et surtout, répétons-le, il recherche dans la politique ce qu’il a toujours recherché, sans jamais y parvenir : non pas tant une « troisième voie » qu’une sorte de synthèse absolue, grâce à laquelle il parviendrait à réconcilier ses contradictions. Il est vite déçu, mais il ne veut pas l’avouer. C’est pour la même raison que, sous l’Occupation, alors même qu’il sera persuadé de la défaite allemande il restera sur ses positions.
Dans ses romans, Drieu met d’ailleurs en jeu des personnages qui dénoncent ou font apparaître la vanité de l’engagement politique. Dans Beloukia, Felsan est présenté comme « un de ces médiocres qui se jettent dans le fanatisme politique pour y trouver une revanche des résultats misérables que dans l’ordinaire des travaux produit l’excessive médiocrité de leurs tempéraments ». Dans L’homme à cheval, Felipe ne se fait lui aussi aucune illusion sur la politique. Est-ce une autocritique – une de plus ?
Le national-bolchevisme professé par Niekisch et quelques autres voyait dans la révolution d’Octobre une révolution éminemment nationale. Il plaidait pour une « orientation à l’Est » (Ostorientierung) afin de libérer l’Allemagne vaincue de la double influence de l’Ouest dissolvant et du Sud catholique. Niekisch apercevait aussi dans le système soviétique quelque chose qui s’apparentait à l’esprit prussien en même temps qu’à ce « socialisme allemand » dont se sont aussi réclamés Spengler et Sombart. Drieu, lui, écrit que « la seule ressource profonde de l’impérialisme allemand serait un communisme allemand », mais il ne se situe pas dans la même perspective. Ce n’est qu’à partir de 1943, après avoir compris que Hitler a raté la « révolution socialiste » et que l’hitlérisme est une impasse, qu’il fera franchement l’éloge du communisme russe : « Il faut souhaiter la victoire des Russes plutôt que celle des Américains […] Les Russes ont une forme alors que les Américains n’en ont pas […] Rien ne me sépare plus du communisme, rien que m’en a jamais séparé que ma crispation atavique de petit-bourgeois. »
Ces derniers mots sont révélateurs. Dans le Manifeste du parti communiste (1847) Marx disait que « le gouvernement moderne n’est qu’un comité qui gère les affaires communes de la classe bourgeoise tout entière ». Il ajoutait que « les conditions bourgeoises de production et d’échange, le régime bourgeois de la propriété, la société bourgeoise moderne […] ressemblent au magicien qui ne sait plus dominer les puissances infernales qu’il a évoquées ». Jünger aurait pu souscrire à ce propos, puisque pour lui la Figure du Travailleur est tout à l’opposé de celle du Bourgeois détesté. Drieu est beaucoup plus ambivalent. Son premier mariage avec Colette Jéramec lui avait déjà permis de mener une vie bourgeoise qu’il disait exécrer. Son roman intitulé Rêveuse bourgeoisie, publié en 1937, décrit l’histoire d’une famille bourgeoise avant et après la Première Guerre mondiale, mais ne contient guère de considérations politiques. Drieu sait très bien que l’individualisme bourgeois, qu’il condamne avec force, fait aussi partie de son être. Il maudit la décadence d’autant plus qu’il se rend compte qu’il y a aussi quelque chose de décadent en lui.
Interrogation contient ce vers : « Et le rêve et l’action ». Ce sont des mots qu’on a souvent cités parce que leur juxtaposition traduit très exactement ce que, toute sa vie durant, Drieu a cherché à réconcilier. La recherche d’une « troisième voie » pourrait certes paraître toute naturelle chez quelqu’un qui a toujours cherché à concilier les contraires : le rêve et l’action, l’écriture et la guerre, l’encre et le sang. Mais il n’a jamais pu parvenir à ses fins. La politique, elle aussi, a correspondu à la quête d’un absolu susceptible de réconcilier tous les contraires. Comme le héros de L’homme à cheval, Drieu a aussi rêvé « de quelque chose de plus profond que la politique, ou plutôt de cette politique profonde et rare qui rejoint la poésie, la musique et, qui sait, peut-être la haute religion ». Mais il n’a pas su déterminer la voie qui le mènerait dans cette direction. A bien des égards, il a toujours été un dilettante. A propos de son Journal des années 1939-1945, on a même pu parler de son « indifférence à toute conviction idéologique profonde », de sa « versatilité » (Julien Hervier). Au fond, il n’avait pas les moyens théoriques de comprendre vraiment les idées dont il se réclamait.
Drieu est de ceux qui s’appliquent à chérir ce qui leur fait le plus défaut. Il a d’autant plus la passion de la politique que la politique le dégoûte et le déçoit. Il en va de même des femmes, et aussi du corps. Drieu était un homme d’hésitations, de volte-face, d’oscillations, d’enthousiasmes contradictoires, d’indécisions et surtout d’élans toujours déçus. Comparé à Jünger, il a été un Soldat du Front, parfois un Rebelle (Waldgänger), jamais un Anarque.
Les deux hommes ont pour point commun d’avoir pensé nécessaire pour les peuples européens de dépasser le cadre national. Quel regard portaient-ils tous les deux sur la nation, sujet de beaucoup de leurs écrits après la Grande Guerre ?
C’est dans les années 1920, à partir de Mesure de la France (1922), que Drieu plaide avec le plus de force en faveur d’un grand bloc continental européen. L’idée est reprise en 1927 dans Le jeune Européen, en 1928 dans Genève ou Moscou, en 1931 dans L’Europe contre les patries. Dans La comédie de Charleroi, on lit encore en 1934 qu’« aujourd’hui, la France ou l’Allemagne, c’est trop petit ». En même temps, Drieu a cru trouver dans la Société des nations l’ébauche de ce qu’il appelle de ses vœux (Genève ou Moscou), ce qui semble un peu étrange aujourd’hui. Plus bizarrement encore, il assigne au « capitalisme européen » le rôle de détruire les patriotismes locaux au profit du patriotisme européen.
L’idée de « troisième voie » s’appuie en fait chez lui, de façon assez classique, sur la nécessité évidente à ses yeux qu’a l’Europe de se tenir à distance aussi bien du modèle américain que du modèle soviétique, deux forces dont, comme on l’a déjà dit, il décèle la parenté profonde : « Aux États-Unis d’Amérique, ceux qu’on nomme capitalistes, dans l’URSS de Russie ceux qu’on nomme communistes, font la même chose ». Dans ses romans, Boutros, personnage central d’Une femme à sa fenêtre, déclare, quoique communiste, qu’il n’a pas « plus confiance dans les Américains ou les Russes ». « Peuples d’Europe réduits et exténués, nous sommes entre deux masses : Amérique et Russie. L’Europe, placée entre les empires aux dimensions continentales, commence à souffrir d’être divisée entre vingt-cinq États, dont aucun n’est de taille à dominer tous les autres ou à représenter dignement dans la concurrence disproportionnée qui s’ouvre entre d’énormes morceaux d’Asie et d’Amérique » (Mesure de la France). Son idée générale est que l’avenir de l’Europe dépend de sa capacité à s’unir pour faire face aux deux impérialismes concurrents qui la menacent également. Les « petites nations », les nationalismes devenus étriqués, en sont incapables. Pour faire l’Europe, il faut faire la guerre aux « petites patries » qui sont autant d’obstacles à son émergence sur la scène mondiale. « L’Europe se fédérera ou elle se dévorera, ou elle sera dévorée », lisait-on déjà dans Mesure de la France. Au passage, Drieu fait l’éloge de l’Empire : « La patrie est amère à celui qui a rêvé de l’empire. Que nous est une patrie si elle n’est pas promesse d’empire ? » (L’homme à cheval). L’Europe doit se fédérer de façon « impériale », ce qui veut dire qu’il ne la conçoit pas de façon « napoléonienne », comme une nation agrandie. Ce que Hitler, prisonnier de son nationalisme et de son pangermanisme, n’a jamais compris. Drieu le répète constamment après 1942 : « Hitler est un révolutionnaire allemand, mais pas européen ».
Dans L’Europe des patries, il écrit : « D’abord vous n’êtes pas des Germains, assez de ces blagues. Pas plus que nous ne sommes Gaulois ou Latins, ou que les Italiens ne sont romains. Figures esquissées par la poésie, épaissies en formes de monstres politiques par des petits-bourgeois nostalgiques au fond des bibliothèques du XIXe siècle […] Maintenant s’imposent d’autres soins que d’arrondir un État national à une époque où l’on n’est rien quand on n’est pas un continent ». À noter que Drieu reprend aussi à son compte l’opposition des « jeunes peuples » et des « vieux peuples », que l’on retrouve chez un Moeller van den Bruck. Sous différentes guises ce thème d’une Europe puissante et socialiste restera l’une constantes de son œuvre.
Jünger a lui aussi su prendre de la distance vis-à-vis des appartenances nationales étroites. Il a été lui aussi un « bon Européen », mais pas dans le sens que lui donnait Drieu. Le Travailleur pose déjà une problématique mondiale que l’on retrouvera après la guerre dans son essai sur l’État universel. Dans La paix, Jünger se contente de plaider pour la renaissance d’une Europe spirituellement unie et rechristianisée. Drieu, lui, rêve seulement d’une régénération. Comme Nietzsche, il pense que ce qui est en train de s’effondrer, il ne faut pas chercher à le sauver, mais au contraire accélérer son effondrement. C’est pourquoi, dans son journal, il déclare souhaiter la destruction de l’Occident et appeler de ses vœux une invasion barbare qui balaiera cette civilisation finissante : « C’est avec joie que je salue l’avènement de la Russie et du communisme. Ce sera atroce, atrocement destructeur.»
Drieu est anglomane et a la réputation d’être germanophile, mais au fond il ne connaît pas grand-chose du monde germanique. Jünger est considéré comme francophile, ce qui n’est pas faux mais fait trop souvent oublier, chez les Français en particulier, à quel point il appartient aussi à la germanité. Drieu est parfois aveuglé par son anglomanie : il a d’abord écrit que les Européens devaient prendre pour modèle les Anglo-Saxons, dont il soulignait, en bon dandy, la beauté, le culte du corps et la distinction. C’est seulement dans un second temps, semble-t-il, qu’il réalisera que les pays anglo-saxons sont aussi la terre d’élection du capitalisme, de l’utilitarisme et de l’uniformisation matérialiste, et que ce sont « les deux grandes puissances anglo-saxonnes qui tiennent les océans ». On constate enfin que les pays du Sud, qui jouent un grand rôle dans ses romans, sont remarquablement absents de ses considérations plus théoriques relatives à l’Europe.
Tous deux ont accordé beaucoup d’importance à la transcendance et développé un intérêt pour les religions et pour le christianisme – on pense aux nombreuses références à l’Ancien et au Nouveau Testament dans le « Journal de guerre » de Jünger – tout en développant un regard à la fois critique et nietzschéen sur celles-ci. Quel regard portaient-ils sur ce monde moderne déserté par le divin ?
Jünger a surtout lu les écrits bibliques et chrétiens à partir de la fin de la guerre, quand il écrit La paix, et aussi dans les années 1950, durant la période qui s’achève avec son essai sur L’État universel (1960) – évolution qui déçut beaucoup son secrétaire d’alors, Armin Mohler ! Jünger met en parallèle la montée du totalitarisme (la « bestialité nue ») et la désintégration de la chrétienté.
Dans ses lettres aux surréalistes, Drieu, qui a également rêvé d’être prêtre ou moine, écrit que « la fonction essentielle, la fonction humaine par excellence qui est offerte aux hommes comme vous, hardis et difficiles, c’est de chercher et de trouver Dieu ». Mais chez lui, les allusions à Dieu sont plutôt rares, et sur ce point il se distingue assez peu de Jünger. Plus que la religion elle-même, c’est la spiritualité – pour prendre un terme devenu à la mode, et donc bien galvaudé – qui l’attire. D’où l’intérêt qu’il a fini par porter aux sagesses orientales et même à l’ésotérisme. Dans la préface de Gilles (1939), il écrit que si sa vie était à refaire, il la consacrerait à l’histoire des religions. Comme Jünger, qui fut très lié à Mircea Eliade (ils animèrent ensemble la revue Antaios), il porte un intérêt passionné aux mythes et se réfère constamment au sacré, mais sans jamais chercher à le rapporter à une religion particulière. Le sacré est pour lui synonyme de divin, et ce divin est plus immanent que transcendant : « Dieu », dit-il encore, représente avant tout la « profondeur du monde ». De l’affirmation de Nietzsche selon laquelle « Dieu est mort », Jünger tire quant à lui la conviction que « Dieu doit être conçu d’une nouvelle façon ». Ce qu’on appelle ordinairement la foi n’y trouve guère son compte. On pense plutôt à la célèbre affirmation de Heidegger : « Seul un dieu peut nous sauver ».
Voyez-vous dans leurs attirances artistiques marquées par le surréalisme pour Drieu la Rochelle et le classicisme pour Ernst Jünger un lien avec leurs engagements politiques ?
Je ne sais pas si l’on peut véritablement parler, concernant Jünger, d’une véritable attirance artistique pour le classicisme. Parvenu dans la période « goethéenne » de sa vie, il n’a certes cessé d’écrire dans un style classique, mais cela ne l’a pas empêché de s’intéresser à des peintres, des graveurs ou des dessinateurs de tendances bien différentes (Alfred Döblin, A. Paul Weber et bien d’autres).
Drieu, de son côté, a toujours eu une vision éminemment esthétique de la vie en général, et de la politique en particulier. Il s’est voulu grand artiste, comme il s’est voulu grand poète, grand amoureux, grand politique, mais on voit mal quels étaient exactement ses goûts artistiques. Dans trois lettres incendiaires bien connues, il a rapidement rompu avec les surréalistes, qui l’ont eux aussi déçu. Dans l’une de ces lettres, il confie qu’il conçoit « la vie comme une prière, et l’Art, la façon d’articuler cette prière », mais son propos ne porte que sur « l’Art » en général, pas sur un style particulier. Il lui est arrivé par la suite de défendre des peintres comme Fernand Léger, Georges Braque, Matisse ou Picasso, mais cela ne suffit pas à nous renseigner vraiment sur ses dilections artistiques.
Dans son article « Artistes et prophètes », publié en 1939 à Buenos Aires dans le journal La Nación, Drieu note que les « inquisiteurs hitlériens », dans leur lutte contre la « peinture dégénérée », « veulent détruire tout l’aspect convulsif de l’art des derniers lustres. Or eux-mêmes, dans leur mouvement révolutionnaire, sont l’expression la plus certaine du caractère convulsif de l’esprit du siècle ». Et il ajoute : « Les hitlériens ont banni des musées allemands l’œuvre de Vincent Van Gogh. Or, ce peintre violent et désespérée me paraît l’un des précurseurs de Hitler ». Une idée qui n’avait pas encore été explorée !
Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.