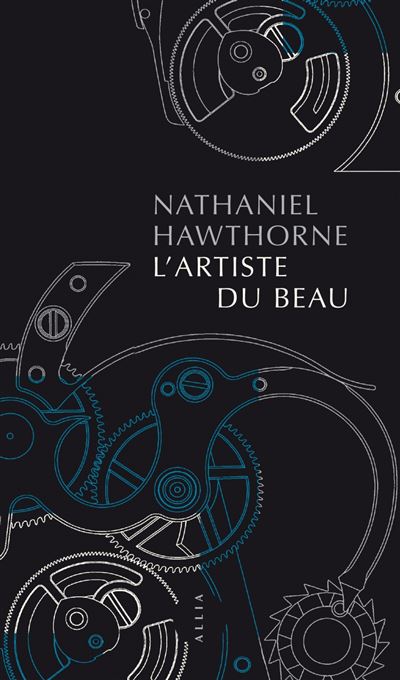Rédigé en 1846, L’Artiste du Beau constitue une petite allégorie raffinée sur la création artistique, s’immisçant dans l’esprit tourmenté d’Owen Warland, un jeune horloger obsédé par l’idéal d’une éternelle Beauté. À travers l’obsession maladive de son personnage c’est sa propre quête spirituelle que trace Hawthorne, en équilibre constant au bord du gouffre de la folie.
Dans Enquêtes, Jorge Luis Borges disait de Nathaniel Hawthorne qu’il « était homme de perpétuelle et curieuse imagination mais réfractaire à la pensée » : pensant exclusivement par images et intuitions il fit de l’allégorie la pierre angulaire de sa littérature. Son imagination était romantique, son style appartenait à la fin du XVIIIe siècle, son esprit voyageait en permanence dans les contrées lunaires des mondes fantastiques parfois dissimulés au coin de la rue ou dans l’arrière-boutique d’un commerçant.
Hawthorne était pétri de l’antique conflit entre l’éthique et l’esthétique : « Comme Stevenson, fils lui aussi de puritains, Hawthorne ne cessa jamais de penser que le métier d’écrivain était frivole ou, qui pis est, coupable. » Rongé par d’intimes scrupules il imagine, dans le prologue de La Lettre écarlate, les fantômes de ses ancêtres raillant son travail de fabuliste : inepte et ridicule ! En voilà une manière de louanger Dieu et d’être socialement utile ! Il persévéra tant bien que mal et essaya de résoudre cette contradiction intérieure en ajoutant des moralités (sans doute superflues) à ses fables : « Il fit, poursuit Borges, ou tenta de faire de l’art une fonction de la conscience. »
Désireux d’entreprendre son grand œuvre, le personnage d’Owen Warland doit ainsi faire face aux quolibets de son vieux maître d’apprentissage, Peter Hovenden, vieil homme raisonnable et sûr de lui, illustrant une certaine vulgarité matérielle : « Rien n’était plus aux antipodes de sa nature que l’intelligence froide et dénuée d’imagination de cet homme, au contact de laquelle tout partait en fumée, hormis la matière la plus dense du monde physique. […] C’est vous mon mauvais génie ! Vous et ce monde dur et grossier ! Vos pensées de plomb et la consternation dont vous m’accablez sont mes chaînes. Sans cela, il y a bien longtemps que j’aurais accompli la tâche pour laquelle j’ai été fait. » Génie incompris, le royaume d’Owen n’est pas de ce monde. La force est un monstre terrestre, avoue-t-il, et si force il y a en lui, elle est d’ordre spirituelle.
À la schématique opposition entre l’ordre spirituel et l’ordre matériel correspond le contraste entre le royaume de l’inutilité de l’art et celui des objets pratiques rythmant la vie quotidienne. Pour Owen, le premier domaine, le sien, est baigné d’une aura bienveillante quand le second, celui du monde extérieur, est affublé de lueurs pâles et grisâtres. Cette différence manifeste de clarté est l’une des obsessions du romantisme que résume la célèbre sentence de Théophile Gautier : « Il n’y a vraiment de beau que ce qui ne peut servir à rien ; tout ce qui est utile est laid. » (préface de Mademoiselle de Maupin). La sensibilité minutieuse d’Owen s’accorde avec ce principe : « Il semblait s’agir d’un nouvel accomplissement de l’amour du Beau qui, peut-être, aurait pu faire de lui un poète, un peintre ou un sculpteur, et qui était aussi épuré de tout vulgaire utilitarisme que s’il se fut exprimé dans l’un ou l’autre de ces Beaux-Arts. Il regardait avec un dégoût peu commun le mouvement lourd et répétitif des machines ordinaires. »
A contrario de la force (brutale) de travail qu’illustre son ancien camarade de classe, le forgeron Robert Danforth, Owen met sa délicatesse au service de créations fines et méticuleuses : « Non que le sens de la beauté chez Owen se réduisit à un goût pour la mièvrerie. L’Idée du Beau est sans rapport avec la taille, et peut se développer aussi parfaitement dans un espace si petit qu’il nécessite une investigation microscopique que dans l’ample demi-cercle délimité par l’arc-en-ciel. Quoi qu’il en soit, la petitesse caractéristique de ses objets et réalisations rendait peut-être le monde plus incapable encore de saisir le génie d’Owen Warland. »
De fait, pour Hawthorne et les romantiques, l’art est une finalité sans fin : une œuvre d’art ne sert qu’à être ce qu’elle est. Réduire la création artistique à une quelconque utilité pratique ne peut résumer que le sentiment d’un béotien contaminé par le pragmatisme de la vie matérielle. Un jugement certes exclusif et radical – oublieux des chefs d’œuvre que peut produire l’artisanat, mêlant habilement aisance domestique et contemplation – mais qui demeure un cap inaltérable pour celui qui consacre sa vie à la quête de l’absolu Beauté. Celle pour qui une existence à son service est le moindre des prix à payer. Pour Owen il n’y a pas vérité plus tranchante. L’utilité sociale n’est pas de son fait (« Je n’ai certes pas pour ambition de m’enorgueillir de la paternité d’un nouveau modèle de machine à filer le coton. »). L’artiste doit poursuivre sa voie, seul, quitte à sacrifier le maigre confort dont il jouit et à s’éloigner des convenances socialement admises : « Ainsi en est-il des idées nées de l’imagination, qui semblent si aimables à celle-ci et sans commune mesure avec tout ce que les hommes jugent de valeur. Au contact du Pratique, elles s’exposent à êtres brisées et anéanties. Il est requis que l’Artiste de l’idéal possède une force de caractère qui semble à peine compatible avec sa délicatesse ; il lui faut garder sa foi en lui-même, alors que le monde incrédule l’assaille de son scepticisme absolu ; il lui faut s’élever contre l’humanité et être à soi-même son seul disciple, aussi bien en respect de son propre génie que des objets vers lesquels il tend. »
L’éphémère création
En ce point, Owen Warland ressemble, à Jean des Esseintes, le héros torturé d’À Rebours de Joris Karl Huysmans. Reclus en lui-même comme à l’intérieur de son pavillon isolé, Des Esseintes, fatigué de la médiocrité ambiante, est obsédé par la recherche d’une beauté artificielle qui viendrait surpasser celle de la Nature. Après s’être enquis de sublimes plantes exotiques, sa sensibilité le pousse progressivement – à rebours des considérations esthétiques de l’époque – à collecter des fleurs rares imitant à la perfection les plus bruts matériaux industriels :
« Autrefois, à Paris, son penchant naturel vers l’artifice l’avait conduit à délaisser la véritable fleur pour son image fidèlement exécutée, grâce aux miracles des caoutchoucs et des fils, des percalines et des taffetas, des papiers et des velours. […] Cet art admirable l’avait longtemps séduit ; mais il rêvait maintenant à la combinaison d’une autre flore. Après les fleurs factices singeant les véritables fleurs, il voulait des fleurs naturelles imitant des fleurs fausses. […]
Il y en avait d’extraordinaires, des rosâtres, tels que le Virginale qui semblait découpé dans de la toile vernie, dans du taffetas gommé d’Angleterre ; de tout blancs, tels que l’Albane, qui paraissait taillé dans la plèvre transparente d’un bœuf, dans la vessie diaphane d’un porc ; quelques-uns, surtout le Madame Mame, imitaient le zinc, parodiaient des morceaux de métal estampé, teints en vert empereur, salis par des gouttes de peinture à l’huile, par des taches de minium et de céruse ; ceux-ci, comme le Bosphore, donnaient l’illusion d’un calicot empesé, caillouté de cramoisi et de vert myrte ; ceux-là, comme l’Aurore Boréale, étalaient une feuille couleur de viande crue, striée de côtes pourpre, de fibrilles violacées, une feuille tuméfiée, suant le vin bleu et le sang. »
Mais l’aristocrate décadent de Huysmans est un collectionneur. Owen est un créateur. L’homme d’une seule œuvre, mystérieuse mais d’une incomparable merveille. Celle qu’il destine à Annie Hovenden, la fille de son vieux maître, entretenant les liens sacrés de l’amour et de l’art : « Annie – ma tendre et chère Annie – tu dois raffermir mon cœur et ma main, et non les ébranler ; car si je m’acharne à vouloir donner forme à l’esprit même du Beau, et lui transmettre le mouvement, c’est pour toi et toi seule. Oh, cœur frénétique, calme-toi ! » Annie, le seul être aimé, celle qui a eu l’intuition de la spiritualisation de la matière, à deux doigts de franchir les portes du secret d’Owen. Celle que ce dernier idéalise d’un excès maladif : « Elle était la forme visible sous laquelle se manifestait à lui ce pouvoir spirituel qu’il vénérait et espérait honorer en déposant sur son autel une offrande qui n’en serait pas indigne. »
Hawthorne maintient adéquatement un léger voile sur le mystère de cette folle création, égrenant de menus indices au long du récit, évoquant subrepticement la Tête d’Airain de Friar Bacon, le canard de Vaucanson et la beauté fugace de jouets naturels plus léger que l’air. Car, toute légendaire qu’elle soit, l’absolue Beauté que conquiert Owen Warland, cette « harmonie en mouvement » qui tend à l’immortalité, n’en demeure pas moins éphémère : « Lorsque l’artiste s’élève suffisamment haut pour atteindre le Beau, le symbole par lequel il le rend perceptible aux sens mortels devient de peu de valeur à ses yeux, une fois que son esprit l’a possédé dans la plénitude de la Réalité. »
Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.