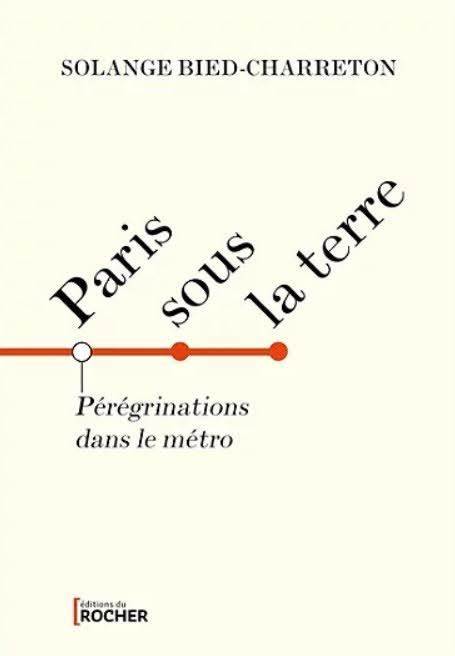Solange Bied-Charreton est journaliste et écrivain. Elle a publié trois romans chez Stock : Enjoy (2012), Nous sommes jeunes et fiers (2014) et Les Visages pâles (2016). Elle vient de publier aux éditions du Rocher Paris sous la terre, un carnet de choses vues lors de ses déambulations dans le métro parisien.
PHILITT : Dans un précédent entretien pour PHILITT, vous disiez vouloir écrire « comme le premier Perec, celui des Choses ». Vous le citez d’ailleurs en introduction de ce nouveau livre. Avec ce carnet de choses vues dans le métro, avez-vous voulu écrire un ouvrage perecquien ?
Solange Bied-Charreton : Oui, même s’il est toujours périlleux, tant de se réclamer d’un grand auteur – en sommes-nous digne ? – que de se circonscrire dans une référence. Il y a bien, avec ce carnet de choses vues dans le métro, une volonté d’épuiser le paysage, de ne rien en perdre. C’est une démarche qui fait le lien avec Georges Perec, sa poétique étant profondément marquée par le souci de consigner, retrouver, classifier, dans sa veine autobiographique, que ce soit avec W ou le souvenir d’enfance, ou avec ce recueil posthume, L’Infra-ordinaire (1989) dans lequel on trouve la précieuse chronique de la destruction progressive de la rue de sa petite enfance, à Belleville. Dans sa veine nous paraissant plus purement stylistique, encore que le sens en soit, justement, toujours la réparation de la perte, avec la Tentative d’épuisement d’un lieu parisien, que je cite en début de livre. Épuiser l’espace, dans le métro, même quand c’est laborieux, se poster dans un coin et tout noter pendant une, deux heures comme je l’ai fait, m’aura aussi permis de rendre ses lettres de noblesse à la description, je pense qu’elle n’est jamais gratuite, elle porte du sens, un état d’esprit évidemment pérecquien.
Pour ce quatrième livre, vous sortez de la forme romanesque pour un ouvrage à la dimension poétique indéniable. Comment expliquez-vous la presque extinction du genre poétique dans la production littéraire actuelle ?
C’est une problématique française et, peut-être aussi anglo-saxonne, mais la sphère anglo-saxonne a pour elle de prendre le roman pour ce qu’il devrait être le plus souvent : une forme qui raconte, par quelques tours que ce soit, une, des histoires. Le monde slave, le monde nordique, ces sphères-là n’ont pas abandonné la poésie. Les poètes y sont magnifiés, admirés. Qui chez nous lit ou connait seulement Essenine ou Þórarinn Eldjárn ? En France, la poésie est marginalisée pour des raisons commerciales, ce sont des choix d’éditeurs. Je ne l’explique pas forcément, mais il doit s’agir d’une fixation sur le roman comme alpha et comme omega depuis deux siècles. Tout de même en France on peut lire Jaccottet, bien qu’il soit suisse. On peut lire Éric Poindron, bien qu’il ne soit bien plus qu’un poète. Il reste que le roman ressort forcément surestimé de ces siècles de mise en avant, malgré la pression des déconstructeurs qu’il aura subi en seconde partie de XXe siècle.
Le métro vous est-il apparu comme un objet d’étude particulièrement pertinent pour décrypter la ville et notre époque ?
Notre époque, je ne sais pas. Le métro apparait déjà daté, il est l’objet des temps industriels, de la performance, de la vitesse. C’est un décor, un objet futuriste. Il a quelque chose à voir avec la conception que ce fait Walter Benjamin de la ville moderne. Ce qui m’a peut-être le plus intéressée, c’est précisément son léger biais, ou parfois son criant décalage avec un époque qui aspire à la mobilité douce, à la multiplication des espaces verts, à la prise en compte de l’individu, sensible à l’hostilité de la masse, de l’impersonalisation. Il y a tant à exploiter littérairement dans ce décalage que j’ai le sentiment que le livre traite principalement de cela, du métro comme violence, comme quelque chose avec lequel on négocie sans cesse pour rester humain, de l’espace qu’il nous reste pour le faire.
La ville est faite de cela, du combat entre l’humanité – les hommes autant que les vertus qu’ils s’échinent à maintenir vivantes – et cette forme particulière de vie, de survie que la ville impose. Elle qui promettait le confort moderne est devenue déshumanisante, désociabilisante. En l’espèce le livre s’échine à collecter la grâce qui apparait entre deux feux, la poésie spontanée héritée de cette hybridation de l’existence.
Dans Le Peintre de la vie moderne, Charles Baudelaire évoque « l’immense jouissance » du flâneur, qui peut « élire domicile dans le nombre, dans l’ondoyant, dans le mouvement, dans le fugitif et l’infini ». Cette flânerie dans le métro parisien vous a-t-elle ouvert de nouveaux plaisirs d’écriture ?
Je crois qu’ils étaient là depuis longtemps, et j’ai eu la chance jusqu’à présent de ne pas être contrainte par mes éditeurs, ceux qui ont édité mes romans. J’ai eu le privilège d’être prise au sérieux en accordant à la description une place majeure dans mes romans. La description n’est jamais gratuite, même et surtout quand elle parait l’être. Les longueurs descriptives, lorsqu’elle s’étend, joue un rôle précis, soit pour ralentir l’action et tenir en haleine le lecteur, soit pour appuyer émotionnellement les affects d’un personnage. Il n’y a pas d’en-soi descriptif, elle est pleine, elle dit quelque chose.
En ce sens le flâneur baudelairien n’en est pas : dans la rue, Baudelaire écrit déjà, il pense à ce qu’il va retenir de la rue, à ce qu’il va en faire, à ce qu’il va construire sur la base d’observations qui ne passent pas mais s’impriment. Il n’est pas simplement dans une contemplation de la vie vouée à l’obsolescence mais dans l’élaboration de l’intensification de la vie en en retenant la sève, selon la conception que Marcel Proust nous a délivrés de la littérature, avec manifeste paradoxal à la fin du Temps retrouvé : « la vraie vie, la vie enfin découverte et éclaircie, la seule vie par conséquent réellement vécue, c’est la littérature ». La vie la plus intense, donc la plus « vraie », celle que l’on retient, c’est bien aussi celle que l’on consigne à la manière de Perec, par le style, « car le style pour l’écrivain, aussi bien que la couleur pour le peintre, est une question non de technique mais de vision ».
Que ce soit dans ce livre ou dans vos romans, Paris prend une place particulière et semble toujours former une toile de fond. La ville est-elle une source d’inspiration ?
D’instinct elle l’a été. Comme ce dernier ouvrage le précise, je suis née et j’ai vécu à Paris toute ma vie, mais je pense que ça ne doit jamais qu’être un point de départ. Dans un livre à paraître, pour la première fois, je m’éloigne et de Paris et de la France, de nos latitudes tempérées, et même de la ville. Il est intimidant de peindre la nature, de la peindre en description, dans l’acception que j’ai de la description, comme une séquence qui fait sens et nourrit un roman, une description qui en est un personnage. Mais je vois cela comme une étape nécessaire. Cependant je me méfie toujours des grands principes appliqués à l’évolution des envies et des réalisations. Je ne pense pas pouvoir me passer de la ville en littérature, ni de Paris en particulier, elle est pour moi si affective, j’y ai tout vécu ou quasiment. C’est comme un sanctuaire dont on peut s’éloigner mais on y revient toujours.
Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.