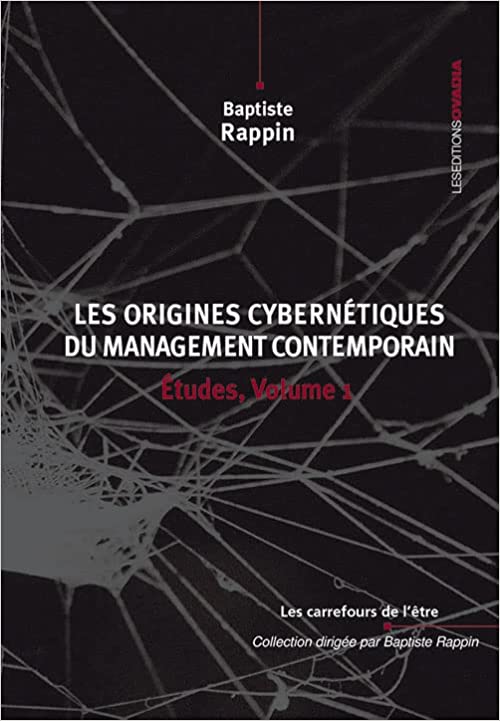Cybernétique : le terme est désuet, sa signification presque entièrement disparue. Pourtant, il conserve comme une aura d’hypermodernité, à laquelle l’imaginaire futuriste qu’il convoque n’est sans doute pas étranger. Il se peut parfois que l’imaginaire soit plus clairvoyant que l’usage, que ce mot n’appartienne non pas au passé mais au présent de l’Humanité et à son futur.
C’est peut-être le cas pour cette discipline oubliée dont la racine se retrouve dans cyberespace, à la pointe de la technologie. Il se pourrait même que ce qui fut en son temps une tentative de révolution scientifique d’une ampleur inversement proportionnelle à son étonnante disparition des mémoires collectives, structure théoriquement la modernité technique comme aucune autre discipline n’en pourrait rêver. C’est en tout cas la thèse de Baptiste Rappin, professeur de philosophie du management à l’université de Lorraine, que plusieurs de ses articles aujourd’hui réunis au sein d’un même volume intitulé Les origines cybernétiques du management (paru aux éditions Ovadia) viennent étayer.
L’auteur a en effet mené une enquête généalogique qui l’a conduit à resituer les origines des théories modernes de l’organisation et du management au sein de la cybernétique, mouvement intellectuel et scientifique interdisciplinaire des années 1940 et 1950, tombé depuis dans l’oubli. Un oubli entretenu par les théoriciens modernes de l’organisation et du management, volontiers tentés par l’amnésie de cette genèse d’où sont pourtant nés tous les concepts qu’ils emploient ; sûrement car, comme le savent les nietzschéens, la généalogie fragilise l’idéologie. En particulier lorsque celle-ci atteint le stade d’hégémonie que l’on peut difficilement contester aux sciences de l’organisation et de l’économie. Au contraire, comme le rappelle l’introduction de cette anthologie, l’œuvre constante de dévoilement de la théologie du courant « panorganisationnel » inscrit Rappin à contre-courant de la majorité des spécialistes des sciences de gestion, qui ne conçoivent leur discipline que par le prisme de l’utilité.
Plus important encore, cette recherche généalogique le conduit également à marquer sa différence avec le mouvement des critical studies qui ne parvient pas à saisir l’idéologie panorganisationnelle dans sa spécificité, en dépit de son ambition critique. Cette spécificité qui réside essentiellement dans le concept biologique – puis cybernétique – d’information. Faute d’avoir su déceler ce rôle central de l’information et des ses manifestations, les critical studies se rendent aveugles au « nouvel esprit du capitalisme »(titre du livre de Boltanski et Chiapello) qui caractérise la société moderne de l’information et se condamnent ainsi à manquer leur cible.
Information et organisation : à la source cybernétique
Comprendre ce nouvel esprit c’est comprendre son origine, que l’auteur identifie dans la cybernétique. La cybernétique est une mouvance intellectuelle qui prend son essor grâce aux conférences Macy des années 1940, réunissant plusieurs scientifiques spécialistes dont l’ambition n’est rien moins que de fonder une nouvelle matrice conceptuelle, pouvant servir de base unificatrice à l’ensemble des sciences, « dures » comme « humaines ». Cette refondation interdisciplinaire puise largement dans la biologie, en particulier le concept d’organisation.
L’autre concept central que le mouvement cybernétique emprunte aux sciences physiques est celui d’information, dont la mise en relation avec le premier constitue le geste fondateur de la cybernétique. Norbet Wiener en donne la définition suivante : « Information est le nom qui désigne le contenu de ce qui est échangé avec le monde extérieur à mesure que nous nous y adaptons et que nous lui appliquons les résultats de notre adaptation. Le processus consistant à recevoir et à utiliser l’information est le processus que nous suivons pour nous adapter aux contingences du milieu ambiant. »
C’est la thermodynamique, ainsi dépassée, qui permet à la cybernétique d’articuler ces deux concepts. L’information en effet n’est autre que le substrat des échanges thermodynamiques : elle est le « contenu » qui ne se résume pas au contenant (l’énergie) et ne peut se mesurer. C’est également la thermodynamique et la réinterprétation de son deuxième principe qui permet à Wiener de la définir négativement comme l’inverse de l’entropie : « Tout comme la quantité d’information dans un système est la mesure de son degré d’organisation, l’entropie d’un système est la mesure de son degré de désorganisation ; l’un est simplement le négatif de l’autre. » Comme le souligne Rappin, l’in-formation doit ici être comprise comme une mise en forme, s’opposant à l’entropie, c’est-à-dire à l’indifférencié.
L’information et son accumulation, l’organisation, constituent respectivement l’arché et le télos de la cybernétique. Néanmoins, tout n’est pas information, car même elle n’échappe pas à l’entropie. Le contenu d’un message peut en effet se perdre dans le « bruit », concept des sciences de la communication passé sans effort à l’économie classique grâce à la cybernétique. Intervient alors le dernier concept angulaire de la cybernétique : la boucle de rétroaction (ou feedback) qui permettra le plus haut degré d’organisation possible en contrôlant l’information dans le but d’éviter sa déperdition. Or, tout modèle de contrôle implique l’établissement de finalités sans lesquelles aucune mesure n’est possible. Ce problème téléologique a le mérite de forcer les théories cybernétiques à expliciter leurs fondements et, en les replaçant dans l’histoire des idées, d’y voir des limites et d’en formuler une critique.
Deux grandes tendances philosophiques semblent pouvoir être dégagées à la lecture des Études de Bapiste Rappin. La première, que l’on pourrait qualifier de pragmatiste conséquentialiste, se positionne clairement par rapport à l’histoire de la philosophie, au moyen d’une relecture binaire de celle-ci, et dont le dépassement aboutit à un positiviste non-dogmatique. La seconde s’en distingue par une ambition systématique, au sens littéral, au terme de laquelle sa philosophie se colore de religion.
Un positivisme moderne
Le premier de ces courants trouve son expression épistémologique dans le knowledge management qui a pensé le concept de connaissance, par rapport à ceux de donnée et d’information. La donnée correspond à l’élément le plus « brut » constitutif de tout phénomène physique, l’information correspond à la mise en relation entre données et agents, et la connaissance aux informations que les agents jugent prioritaires par leur interaction avec le monde. Connaissance est ici synonyme de cogniscience, c’est-à-dire d’activité (cognitive). Elle est interaction d’un agent aux ressources limitées avec la donnée brute et illimitée du monde. Ce décalage entre ressources limitées et matière illimitée conduit à un relativisme à la fois épistémologique et téléologique : la connaissance étant action, sa véracité ne peut se mesurer qu’à ses conséquences.
C’est ce pragmatisme, repris aux américains Dewey et James, qui permet aux théoriciens du knowledge management d’offrir une réconciliation à l’histoire de la philosophie, qu’ils estiment empêtrée dans un stérile dualisme entre rationalisme et empirisme. « Le vrai, c’est tout ce qui se révèle bon dans le domaine de la croyance » (William James) devient « la connaissance est une croyance vraie justifiée » (Nonaka and Van Krogh).

Toutefois, cette conception, dont les tenants comptent jusqu’à l’illustre Wang Yangming, n’est problématique que dès lors que la « justification » d’une croyance n’est établi qu’en fonction de ses conséquences pratiques. Rappin nous montre d’ailleurs que la principale difficulté théorique du knowledge management est également pratique, et réside entièrement dans la question de l’évaluation de l’évaluation. L’évaluation d’une croyance par ses conséquences ne fait en effet que repousser le problème épistémologique à l’évaluation des conséquences. Le problème se pose très concrètement à toutes les organisations modernes dans lesquelles cette évaluation des conséquences n’est autre que le consacré processus de feedback, qu’il revient aux managers d’analyser pour décider des nouvelles finalités de leur organisation.
Le pragmatisme relativiste est donc forcé d’introduire une part de subjectivisme, que le courant théologique congédie par l’édification d’un système d’inspiration religieuse. C’est ainsi au travers d’un détour par la théologie, en particulier la pensée juive de la Renaissance, que la cybernétique parvient au stade de l’unité théorique.
La cybernétique et Dieu
L’ensemble de l’Information organisée, assumant tous les attributs de la perfection divine, y prend le nom d’« Intelligence collective » ou celui que lui a donné le théologien Pierre Teilhard de Chardin : noosphère. Chez ce dernier également, elle est la force qui s’oppose au chaos de l’entropie : « le flot descendant de l’Entropie, doublé et équilibré par la marée montante d’une Noogénèse !…». Cette définition négative explicitement donnée par Wiener permet justement d’éviter l’écueil subjectiviste du knowledge management en abstrayant l’information, et l’Intelligence, de la représentation humaine. L’Intelligence (Collective) est ainsi toute entière en acte, « partout distribuée, sans cesse valorisée, coordonné en temps réel” (Pierre Lévy). Dans les termes de l’entéléchie aristotélicienne, l’Intelligence Collective est à elle-même sa cause efficiente, formelle et finale : Dieu ou « ce qui meut sans être mû » et s’opposant au non-mouvement entropique.
Autre théoricien majeur de la cybernétique, Norbert Wiener la fonde encore plus explicitement en théologie en s’appuyant sur les écrits de Rabbi Loeb, plus connu sous le nom de Maharal de Prague. Or, la conception théo-cosmologique de ce dernier a ceci de particulier qu’elle inscrit la division et la dualité au commencement de l’univers – la deuxième lettre de l’alphabet hébreu, bet, figure ainsi avant la première dans la Torah et est présente dès le premier mot de « commencement » (béréshit). Avant d’être celui, historique, du peuple d’Israël, l’Exil est métaphysique et désigne l’imperfection et l’incomplétude de toute chose suite à la Déchirure. L’horizon eschatologique de la rédemption devient alors celui la recherche de l’Unité perdue, la « victoire de l’un sur la déchirure » (Neker). Cette déchirure, Wiener la transpose scientifiquement à la notion d’entropie, force scindant l’unité de l’univers. Ne surnagent du chaos entropique que quelques enclaves d’organisation, dont la compréhension et la multiplication par l’activité scientifique humaine doit permettre de restaurer l’Unité perdue.
Une différence fondamentale sépare pourtant les théologiens scolastiques de leurs émules cybernéticiens. Scientifiques de formation, les seconds ne sont guère enclins à la spéculation métaphysique et souhaitent opérer la sécularisation des prémisses des premiers. Ils désirent, en d’autres termes, « que ce qui fut théologique devienne technologique (ou anthropologique) » en partant de l’immanence plutôt que de la transcendance, en partant de la Création plutôt que de Dieu. Contrairement aux apparences, cette entreprise n’a rien d’une excentricité sémantique et tout d’un renversement de la tradition de pensée occidentale de l’Un et du Multiple, consacrée par les Grecs.
La cybernétique ou la modernité sophiste
Dans la pensée grecque traditionnelle, cristallisée dans le néoplatonisme d’un Plotin, la suprématie est normalement accordée à l’Un sur le Multiple. Du Principe premier émane une infinité de manifestations (le Multiple), lesquelles constituent autant de traces du Principe premier. La discipline philosophique grecque consistait ainsi pour une bonne part à identifier ce que Platon nomme le korismos, la « coupure » – et le lien – entre la manifestation visible et le principe qui la fait advenir à L’Être.
La pensée cybernétique refuse de voir cette coupure : en ne donnant, par la méthode scientifique, la priorité qu’aux phénomènes, elle prend fait et cause pour le Multiple. Et ce, malgré le maintien de l’horizon d’un principe d’Unité divin. Ou, plus précisément, parce qu’il est un horizon et non un lien. Au lieu de voir dans les phénomènes organisés la Trace d’un principe divin premier, la cybernétique entend reconstituer et remonter ce principe en collectionnant les phénomènes multiples comme autant de morceaux d’un vase à recoller. L’Unité semble bien sous-tendre cette opération et pourtant elle en est perpétuellement absente, indéfiniment ajournée. La cybernétique est en fait une idéologie du report, de la « différance » (au sens derridien). Les phénomènes n’émanent pas de l’Unité, ils en constituent une infinité de signes, dans laquelle le sens coule sans jamais se fixer.
La référence à l’Unité et à Dieu masque en réalité un parti pris pour le Multiple. Voilà la conclusion et le reproche que lui adresse Baptiste Rappin. Pour cet héritier de Platon, la gigantomachia peri tès ousia conserve une actualité brûlante et les tenants du Multiple, autrefois mieux connus sous le nom de sophistes, n’ont jamais été aussi nombreux. Le triomphe de l’organisation cybernétique n’est autre que celui d’Hippias.

Avec le Multiple triomphe le mouvement. À l’âge cybernétique, il prend la forme très concrète de l’information circulante, de l’Intelligence Collective dont l’effectivité matérielle se réalise au sein des systèmes d’information, selon l’intuition fondatrice de la cybernétique assimilant le cerveau humain à un ordinateur. Son hégémonie, déjà confortablement assurée, menace de faire disparaître tout un pan de l’être-au-monde qui avait irrigué les civilisations humaines, la réflexion (ou représentation).
La réflexion, qui caractérisait l’intelligence pour les Anciens au point de désigner l’usage de cette dernière, pourrait ainsi proprement disparaître au sein de la fluidification généralisée induite par la cybernétique. Pour l’Intelligence Collective cybernétique, toujours déjà en acte, réaction et pro-action, la réflexivité est un obstacle à la connectivité – c’est-à-dire à l’interaction (avec l’environnement). La re-présentation, enfreint le seul horizon cybernétique du Bien, l’accumulation de l’Information organisée, et relève en cela de son principe opposé : l’entropie.
La disparition de la réflexivité entraîne également la disparition de la conscience et du sujet. Le penseur Pierre Legendre avait déjà identifié ce risque de « désubjectivisation » moderne dans l’abolition de cet « écart imaginaire » entre les corps (ré)agissant et les représentations abstraites. Pour cet anthropologue cher à notre auteur, c’est l’écart entre son corps propre et les images projetées, qu’il commence à produire par le langage, qui constitue le petit être humain en sujet. Or, le projet cybernétique vise précisément à l’abolition de tous ces freins à l’interaction que sont la distance, l’écart, la délimitation et même la définition. L’absence de définition, caractéristique du sophiste pour Platon (cet être « ondoyant aux cent visages ») hante ainsi la cybernétique depuis son concept originel d’information, qui n’est nul part défini, sinon négativement.
En creux s’esquisse l’homme du futur cybernétique, dont Rappin trouve la meilleure approximation actuelle dans la figure de l’homo sacer du philosophe Giorgio Agamben. Au temps de la Rome antique, ce terme désignait un individu exilé par la société, qui le privait de ses droits et l’excluait de sa loi. Or, toute Loi exige une distance – celle de la représentation -, une limite entre les faits et leur jugement. La fluidification cybernétique abolit justement toute limite de cette sorte au profit d’un état d’urgence permanent. À terme, son utopie est celle d’une société sans lois, une immense voie de fait contre laquelle aucun droit n’est opposable.
Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.