À Beyrouth, en septembre 1982, des milices chrétiennes libanaises, massacrent avec la complicité de l’armée israélienne des centaines de femmes et d’enfants palestiniens dans les camps de réfugiés de Sabra et Chatila, au cours d’une prétendue chasse aux terroristes. Jean Genet, âgé de 72 ans, est le premier Occidental à pénétrer dans le camp après l’hécatombe. Si son soutien à la cause palestinienne était férocement ancré dans son cœur depuis déjà quinze ans, ce qu’il découvre alors le convainc de publier un texte radical par lequel il sublime la passion qui le consuma toute sa vie durant : l’amour des damnés.
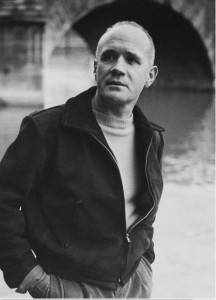
Sur la route de Damas à Beyrouth, Jean Genet voit défiler les innombrables panneaux rédigés dans la langue de l’occupant, en caractères hébreux, effroyables à ses yeux, et qui lui causent « la même souffrance que lorsqu’on pouvait voir des caractères gothiques à Paris durant l’Occupation ». Il est l’indéfectible ami des terrassés, des condamnés et des victimes, quels que soient leurs torts, quels qu’aient été leurs crimes. Envoyé par ses parents dans un bagne pour enfant avant même d’être adolescent, puis engagé dans la légion étrangère aux cotés de crapules et truands du monde entier, l’âge et la gloire ne sont pas parvenus à affadir la haine intime qu’il a sans relâche nourrie à l’égard des honnêtes gens. Il a conservé intacte la compassion instinctive à l’égard des damnés de toutes terres, ainsi qu’une fraternité dévolue envers les criminels, fussent-ils des miliciens allemands occupant Paris : « J’aime ces petits gars dont le rire ne fut jamais clair. J’aime les miliciens. Je songe à leur mère, à leur famille, à leurs amis, qu’ils perdirent tous en entrant dans la Milice. Ainsi j’eus, pendant trois ans, le bonheur délicat de voir la France terrorisée par des gosses de seize à vingt ans. »
À rebours des injonctions formulées par l’éthique moderne, qui place la tolérance au rang de vertu absolue, Jean Genet n’y voit qu’un trait de caractère un peu mou, anesthésiant, et qui dissimule à peine le relativisme bourgeois dont elle regorge. Il s’en saisit avec rage pour mieux la retourner contre le conformisme qui l’a sécrétée, il la pousse à l’absolu, la radicalise jusqu’aux derniers horizons admissibles, la contraignant à accepter les travestis vieillissants de Pigalle, les matelots défigurés par la bassesse de leur âme, et même les ébats homosexuels d’Adolf Hitler se soumettant aux assauts physiques d’un jeune Parisien. Puisque le catéchisme exhorte à aimer les deux larrons qui entourent le Christ dans son supplice, à pardonner au fils prodigue et à avoir pitié des assassins, bref, à voir de la beauté jusque dans la fange la plus épaisse, alors il faudra bien que la France bourgeoise accepte que l’officier qui commanda le massacre d’Oradour-sur-Glane « a fait ce qu’il a pu – beaucoup – pour la poésie, et ayant bien mérité d’elle, mérite [son] admiration ». La victime aux pieds de laquelle se jette Jean Genet n’est pas celui qui meurt sous la mitraille des armées, mais le prisonnier, celui qui ne peut fuir ni sa geôle ni son destin, depuis Maurice Pilorge, le condamné à mort qui lui inspira l’œuvre du même nom, jusqu’au milicien contraint d’accepter son devoir macabre et de l’honorer.
D’octobre 1970 à avril 1971, Jean Genet se rend en Jordanie, où il découvre de l’intérieur le mouvement de libération de la Palestine, ses combattants prêts à en découdre, leurs attitudes parfois terrifiantes et parfois attendrissantes, mais surtout la conviction avec laquelle ils servent la cause de leur peuple. À l’inverse de certains contemporains, il ne fait en aucun cas partie de cette aristocratie littéraire qui, à grand renforts d’érotisme homosexuel, ne retranscrit des soldats sur lesquels elle pose un regard libidineux que la beauté des corps, sans jamais s’émouvoir de la beauté de leur combat. Dans Quatre heures à Chatila, le poète fait coïncider la beauté des révolutionnaires avec la noblesse de leur cause. « L’affirmation d’une beauté propre aux révolutionnaires pose pas mal de difficultés. On sait – on suppose – que les enfants jeunes ou des adolescents vivant dans des milieux anciens et sévères, ont une beauté de visage, de corps, de mouvement, de regards, assez proche de la beauté des feddayin. L’explication est peut être celle-ci : en brisant les ordres archaïques, une liberté neuve se fraye à travers les peaux mortes, et les pères et les grand-pères auront du mal à éteindre l’éclat des yeux, le voltage des tempes, l’allégresse du sang dans les veines. » Si la cause des Palestiniens le saisit au cœur avec tant de force, c’est que cette fois, les prisonniers dont il s’éprend sont des innocents, et que leur bourreau est un État tout entier, et non plus une assemblée de juges aigris. À cette époque, il est en contact avec Yasser Arafat, figure de la résistance érigée en épouvantail absolu du terrorisme par Israël, mais également avec Leïla Shahid, qui est la première à l’entretenir des événements politiques en cours au Moyen-Orient et à le tenir au fait des enjeux de la guerre qui est en train de se dérouler au Liban.
Le choix de la littérature politique contre l’insuffisance de la poésie

Dans des œuvres antérieures, Jean Genet s’est déjà illustré par un militantisme politique plus ou moins explicite, notamment dans Le Condamné à mort ou Notre-Dame-des-Fleurs, principalement dirigé contre les institutions, en tête desquelles « l’industrie de la Justice ». Cette fois, la démesure des événements lui en donne la certitude, la poésie ne suffira plus. L’évocation des destinées individuelles prisonnières d’un monstre dont elles révèlent tour à tour l’absurdité et la violence ne suffit plus : il ne veut se résoudre à une simple description des atrocités dont ses yeux de vieillard sont témoins. S’il ne renonce pas pour autant à rapporter ces scènes infernales que jonchent les cadavres mutilés, il affirme être conscient qu’elles ne sont qu’un détail, et les traite comme tel. « Pour moi comme pour ce qui restait de la population, la circulation à Chatila et à Sabra ressembla à un jeu de saute-mouton. Un enfant mort peut quelquefois bloquer les rues, elles sont si étroites, presque minces et les morts si nombreux. Leur odeur est sans doute familière aux vieillards : elle ne m’incommodait pas. Mais que de mouches. Si je soulevais le mouchoir ou le journal arabe posé sur une tête, je les dérangeais. Rendues furieuses par mon geste, elles venaient en essaim sur le dos de ma main et essayaient de s’y nourrir. »
D’ordinaire si magistral lorsqu’il balance son esprit des plus singulières précisions jusqu’aux vérités les plus absolues, l’écrivain s’avoue ici vaincu par son propre procédé. La réalité du conflit est incommensurable à la littérature – ou du moins, à une littérature qui entendrait rendre compte de la vérité de la guerre dans sa totalité. En effet, alors que les assassins qui peuplaient les prisons fantasmées de ses premières œuvres étaient avant tout des « victimes insolentes, voleurs intolérables aux juges et aux marchands », engagés dans un face à face humain et tangible, les Palestiniens sont un peuple menacé d’éradication par un État, une multitude anonyme aux prises avec un fantôme. Il lui faut donc renoncer aux images et au style, et Jean Genet n’hésite pas à recopier des articles de journaux ou à retranscrire ses conversations monotones avec les habitants hagards, survivants miraculeux dans cette « ville en miettes et par terre, parcourue, soulevée, portée par la pesante odeur de la mort ». Dans Un captif amoureux œuvre posthume dans laquelle il reviendra plus violemment encore sur son attachement aux Palestiniens et à leur cause, l’écrivain parle de « cet obstacle littéraire qui [lui] fut posé en Palestine ».
Conscient de la complexité du problème auquel il se confronte, Jean Genet l’est tout autant de la singularité de l’ennemi auquel il s’attaque. Il le voit avant tout comme une ombre menaçante, planant au-dessus de Beyrouth, prête à y déverser sa terrible pluie d’acier. Mais, plus encore, il le nomme et le perçoit essentiellement comme une puissance coloniale, identique à celles contre lesquelles il s’était déjà battu auparavant. « En 1917 le coup d’Abraham est réédité. Dieu était déjà la préfiguration de lord Balfour. Dieu, disaient et disent encore les juifs, avait promis une terre de miel et de lait à Abraham et à sa descendance : or cette contrée, qui n’appartenait pas au dieu des juifs (ces terres étaient pleines de dieux), cette contrée était peuplée des Cananéens, qui avaient aussi leurs dieux, et qui se battirent contre les troupes de Josué. (…) L’Angleterre, en 1917, ne possédait pas encore la Palestine (cette terre de miel et de lait) puisque le traité qui lui en accorda le mandat n’avait pas encore été signé. »
Israël, « sainte inquisitoriale et vengeresse »

Jean Genet note froidement cette déclaration de Menahem Begin, alors Premier Ministre israélien, face à la Knesset : « Des non-juifs ont massacré des non-juifs, en quoi cela nous concerne-t-il ? ». L’écrivain sait, pour l’avoir vu, ce que les médias et l’Histoire mettront du temps à admettre : si les phalangistes chrétiens se sont acharnés pendant plusieurs heures sur des milliers de civils palestiniens, mutilant le corps d’un grand nombre de leurs victimes et s’amusant à défigurer leurs dépouilles, c’est bel et bien Israël qui a laissé les milices pénétrer dans Sabra et Chatila. Il va même plus loin et affirme que ce sont les responsables militaires israéliens qui ont ordonné le massacre, les milices chrétiennes n’opérant que comme sous-traitants. Il clame par ailleurs sa confiance en l’Histoire et se convainc qu’un jour la vérité sera connue de tous et la justice rendue – mais celui qui était alors le chef des Phalanges libanaises, Elie Hobeika, sera assassiné devant chez lui en 2002, deux jours avant l’ouverture du procès contre Ariel Sharon visant à déterminer le degré d’implication de l’État israélien dans ces massacres.
Jean Genet refuse le doute. « Le sang ne ment pas », écrit-il dans Un captif amoureux. « Que veut Israël ? Détruire les Palestiniens. Il tue des hommes. Il tue des morts ». Son jugement radical lui valut plusieurs accusations d’antisémitisme, dont la plupart furent habilement lancées contre lui après sa mort, faisant artificiellement rejaillir à dessein ses écrits sur l’Occupation. Pour l’heure, dans le dédale de ruines qui l’entoure, Jean Genet serait prêt à abandonner toute la renommée littéraire qui est la sienne, et à laisser derrière lui l’Europe entière. « Quand on songe aux précautions dont on s’entoure en Occident dès qu’on constate un décès suspect, les empreintes, l’impact des balles, les autopsies et contre-expertises ! À Beyrouth, à peine connu le massacre, l’armée libanaise officiellement prenait en charge les camps et les effaçait aussitôt, les ruines des maisons comme celles des corps. Qui ordonna cette précipitation ? ». À ces interrogations, on lui oppose l’absurdité d’un engagement stérile. Pourquoi un écrivain tiendrait-il à connaître la véritable motivation et le véritable commanditaire d’un génocide se déroulant à des milliers de kilomètres de ses faubourgs parisiens ? La question agita bien moins la critique lorsque Malraux ou Hemingway s’engagèrent durant la guerre d’Espagne, sans davantage de nuance ni de modération. Jean Genet refuse de se justifier. C’est en tant que damné qu’il s’exprime, et c’est par fraternité dans la misère que son empathie se mue en révolte. Lui, le voleur condamné, arpenteur du Pigalle nocturne, crachant aux pieds des rentiers de Montmartre, sent se raviver une dernière fois, bien des années après sa jeunesse insoumise, la flamme du combat qui avait toujours brûlé en lui. Il n’est pas un écrivain engagé, mais un enragé écrivant.
C’est contre la résignation qu’il soutient le terrorisme, en l’appelant comme tel, sans honte, et contre la soumission qu’il se bat pour que les masques tombent. Car plus encore que la bestialité des soldats, qui a pu l’émouvoir par le passé, c’est la lâcheté des décisionnaires qu’il exècre de toute son âme. À ses yeux, Israël entier est coupable. Que l’on trouve des bons comme des mauvais dans chacun des camps, et qu’il doive y avoir de « bons Israéliens », tel n’est pas son problème : qu’ils se chargent eux-même du tri. Jean Genet refuse la nuance politique qu’il accuse de sans cesse complexifier les faits plutôt que de les expliquer, et de multiplier les encombrements de la retenue et de la lenteur, sauf lorsqu’il s’agit de tirer dans le tas. Il refuse de diriger sa haine contre la droite israélienne, ou contre Tsahal et ses armes. Que les bouchers soient des généraux de la droite radicale n’arrange que mieux la gauche et les modérés, qui s’en lavent les mains. « Les Français ont l’habitude d’employer cette expression fade « le sale boulot », eh bien, comme l’armée israélienne a commandé le « sale boulot » aux chrétiens libanais, les travaillistes ont fait accomplir le « sale boulot » par le Likoud, Begin, Sharon, Shamir. »
Dans le fond, le texte de Jean Genet demeure profondément littéraire, et même s’il revêt dans certaines de ses dénonciations les plus véhémentes des airs de pamphlet, il conserve une constance poétique et une certaine forme de tendresse, qui en font assurément l’un des écrits les plus inspirés de l’auteur. Interdit de territoire aux États-Unis, il avait déjà soutenu publiquement, quelques années auparavant, le mouvement des Black Panthers. Cet engagement, plus méconnu et délibérément ignoré par ceux qui l’accusèrent de ne réserver son indignation qu’à Israël, est pourtant la preuve même qu’il fut avant tout un compassionnel féroce, un mercenaire sans nuances, prêt à assumer les parti-pris les plus intransigeants, et qu’il ne choisissait pas les victimes dont il épousait la cause, mais les bourreaux dont il combattait les appétits. « Israël rase Chatila. Il n’est pas absent de la spéculation immobilière sur le terrain aménagé : c’est cinq millions anciens le mètre carré encore ravagé. Mais « propre » ce sera ? » Son seul et éternel adversaire fut la force mystérieuse entravant la route des hommes vers eux-mêmes, les divisant, et les éloignant sans cesse plus dangereusement de l’amour.
« Âmes de mes tués ! Tuez-moi ! Brûlez-moi !
Michel-Ange exténué, j’ai taillé dans la vie
Mais la beauté Seigneur, toujours je l’ai servie. »
