Les occasions ne manquent pas, dans le débat public actuel, de s’interroger sur les ressorts du racisme et de l’antiracisme. Romain Gary s’attaque au sujet dans Chien Blanc, roman publié en 1970, où il parle de son expérience du premier à Los Angeles pour mieux décrier les motivations du second, avec distance et humour.

C’est dans l’Amérique des années 1960 que Romain Gary plante le décor de Chien Blanc, roman autobiographique où l’auteur, ancien consul général de France à Los Angeles, aborde les aspects de sa vie aux côtés de Jean Seberg, icône hollywoodienne et actrice engagée pour les droits civiques des Noirs américains. C’est alors l’Amérique des émeutes de Watts, Baltimore et Chicago, de Martin Luther King, du président Johnson et de sa « Great society ». Gary observe d’une position privilégiée cette période où le pays sort en douleur de la ségrégation : il est plongé, par l’entourage de sa femme – adhérente de longue date de la NAACP (Association nationale pour la promotion des gens de couleur) et soutien des Black Panthers – dans l’engagement antiraciste du tout-Hollywood. Son roman Chien Blanc, publié en 1970 chez Gallimard, est l’occasion pour lui de compiler ses observations sur cette époque, sur cette lutte pour les droits civiques et ceux qui y participent, et particulièrement sur le gotha de Beverly Hills qu’il côtoie et qui embrasse passionnément – et médiatiquement – cette cause.
La rencontre du narrateur avec Batka, un berger allemand qu’il trouve devant sa porte un jour de février 1968, marque le point de départ de cette fresque ayant pour toile de fond une société américaine prise entre racisme et antiracisme. La relation qu’il tisse avec ce chien sert de fil rouge au récit. L’animal est un « chien blanc », c’est-à-dire un chien élevé dans le sud ségrégationniste des États-Unis, « spécialement dressé pour aider la police contre les Noirs ». Romain Gary le recueille et entreprend de le rééduquer. Dès les premières pages du récit, le lecteur est amené à discerner deux éléments dans la réflexion de l’auteur : premièrement, Batka est une allégorie de la haine. Deuxièmement, l’entreprise de sa rééducation porte la notion d’espoir et de rédemption. La haine est présentée comme un conditionnement, un dressage, qui peut être réversible : c’est par le dressage que Batka est devenu un « chien blanc », et c’est par le dressage qu’il sortira de cette condition. En filigrane, une réflexion sur l’éducation – le dressage de l’homme – émerge de cette histoire. Un certain humanisme, héritage philosophique pas moins délaissé alors qu’aujourd’hui, affleure à chaque étape du roman : une foi en l’homme éclairé, extrait de la peur, de la haine et de l’obscurantisme par le savoir. Le roman s’inscrit ainsi parfaitement dans l’œuvre romanesque de Romain Gary : du personnage de Morel, protecteur d’éléphants au temps des indépendances africaines dans Les Racines du ciel (1956) à celui d’Ambroise Fleury, artisan rêveur sous l’Occupation dans Les Cerfs-volants (1980), on retrouve pour trame cette réflexion sur l’Homme libre, penseur, délivré des chimères de son époque.
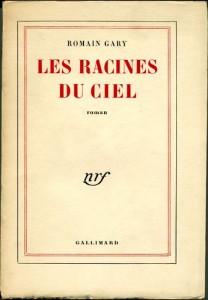
Dans Chien Blanc, Romain Gary évacue rapidement la question des ressorts du racisme américain des années 1960 : « Je suis en train de me rendre compte que le problème noir aux États-Unis pose une question qui le rend pratiquement insoluble : celui de la Bêtise. Il a ses racines dans la plus grande puissance spirituelle de tous les temps, celle de la Connerie. » L’esclavage est à ses yeux un trait commun aux Américains qu’il rencontre, qu’ils soient noirs ou blancs, tant ces derniers sont, « depuis des siècles », « esclaves des idées reçues » dans leur rapport au monde.
L’intérêt de la critique qu’émet Romain Gary dans Chien Blanc est ailleurs cependant ; elle réside certainement dans sa façon de renvoyer dos à dos le racisme d’une part, et l’antiracisme télégénique et incantatoire d’autre part, comme postures aux modalités semblables sinon identiques, ayant besoin l’une de l’autre pour exister. Si ces idées reçues, « moules qui enserrent les cerveaux, pareils à ces sabots qui déformaient jadis les pieds des femmes chinoises », sont évidentes chez les uns, Gary s’emploie à les souligner chez les autres, les vedettes militantes qui entourent Jean Seberg, en dépeignant un aréopage d’esprits bornés, inquisiteurs et sectaires.
Critique précoce de la société médiatique
Dans Chien Blanc, le narrateur ne manque pas non plus de mettre en cause les motivations des activistes hollywoodiens. Il s’interroge sur la culpabilité dont ils semblent volontiers s’accabler pour légitimer leur engagement, « cette vieille façon de s’acheter une conscience en battant sa coulpe ». Il fait un portrait au vitriol de ce que l’entourage de sa femme compte en adeptes de l’autoflagellation : « Le signe distinctif par excellence de l’intellectuel américain, c’est la culpabilité. Se sentir personnellement coupable, c’est témoigner d’un haut standing moral et social, montrer patte blanche, prouver que l’on fait partie de l’élite. » C’est en décrivant les réunions qu’organise Jean Seberg à leur domicile que Romain Gary se fait le plus mordant : « ma maison […] est devenue un véritable quartier général de la bonne volonté libérale blanc-américaine. Les libéraux, au sens américain du mot – en français, le mot qui me semble s’en rapprocher le plus est “humanitariste” ou plutôt “humanitaire” – l’envahissent dix-huit heures sur vingt-quatre […]. C’est la permanence des belles âmes. » Le narrateur décrit les « organisations-groupuscules » créées dans le but de soulager « non pas les Noirs, mais les Blancs […] les soulager de leur argent, et soulager leur conscience ». Ces organisations sont dépeintes en véritables parasites de la cause à laquelle elles se greffent, « qui n’ont d’autre activité ni d’autre but que d’assurer la survie économique de leurs “comités directeurs” ». C’est un antiracisme d’apparat, essentiellement destiné à flatter des réputations, qui est ici présenté par le narrateur. Son point de vue, qui se veut extérieur et détaché, renforce l’intensité de la critique : « Je sais qu’il y a dans les “bons camps” autant de petits profiteurs et de salauds que dans les mauvais. »

Chien Blanc porte également une analyse très actuelle des effets de la société médiatique, pourtant naissante dans les années 1960, sur le débat public. Ainsi, à la faveur d’une discussion avec Bobby Kennedy sur les risques qu’il encourt dans sa campagne électorale de 1968, Gary s’exclame : « il faudrait faire une étude profonde de la traumatisation des individus par les mass media qui vivent de climats dramatiques qu’ils intensifient et exploitent, faisant naître un besoin permanent d’événements spectaculaires […] le vide spirituel est tel, à l’Est comme à l’Ouest, que l’événement dramatique, le happening, est devenu un véritable besoin. » Il voit dans les médias le moyen pour les activistes qu’il décrit de « transférer leur névrose personnelle hors du domaine psychique, sur un terrain social qui la légitime. Ceux qui cachent en eux une faille paranoïaque se servent ainsi des persécutés authentiques pour se retourner contre “l’ennemi”. » La force de cette critique est évidente quand, en faisant allusion aux réunions militantes qu’organise sa femme, où chacun rivalise en envolées bienveillantes, l’auteur perçoit un « fanatisme en vase clos » qui n’est pas sans rappeler les tempêtes médiatiques successives qui ponctuent l’actualité en 2015.
Une impression ressort à la lecture de Chien Blanc : l’antiracisme hollywoodien des années 1960 dépeint par Romain Gary a fait œuvre de démocratisation, tant son expression paraît courante au lecteur d’aujourd’hui. On ne peut qu’être familier, de nos jours, de l’antiracisme incantatoire du mainstream culturel, parodie télégénique d’un juste combat. Parodie si grossièrement maladroite –en amplifiant inconsidérément des propos souvent ineptes et insignifiants – et vindicative – en prétendant sonder jusqu’aux arrière-pensées – qu’elle semble céder de bon gré du terrain à l’ennemi pour conserver ses prétentions morales.

C’est dans cette « autofiction » qu’est Chien Blanc que Romain Gary révèle certainement le plus clairement la finesse de la critique qu’il porte sur les malaises de la seconde moitié du XXe siècle. Il y place le lecteur face à une situation binaire pour mieux l’en extraire par le haut, par une réflexion sur ce qui façonne le rapport à l’autre, dans une approche heuristique de la littérature. Le lecteur est amené à interroger les évidences, à en analyser les fondements et, in fine, à mettre en doute son expérience de l’époque. Chien Blanc fait ainsi écho, à plusieurs égards, à Black Boy, le roman autobiographique de Richard Wright publié en 1945, où l’auteur dépasse les questions raciales de sa jeunesse par la littérature : « L’important n’était pas de croire ou de ne pas croire à mes lectures, mais de ressentir du neuf, d’être affecté par quelque chose qui transformât l’aspect du monde. »
