Serge Berstein enseigne à l’Institut d’études politiques (IEP) de Paris. Membre des conseils scientifiques de la Fondation Charles de Gaulle et de l’Institut François Mitterrand, il est l’auteur d’une Histoire du gaullisme et il a récemment codirigé le livre Fascisme français ? (CNRS éditions). Il est revenu pour PHILITT sur la place qu’a joué la bataille de Verdun dans la vie du général de Gaulle.
PHILITT : Le 2 mars 1916, le capitaine de Gaulle est fait prisonnier à Verdun. Que sait-on de son expérience de guerre durant le premier conflit mondial ?

Serge Berstein : L’expérience de guerre du lieutenant, puis capitaine de Gaulle semble au total assez négative. Il est entré dans le conflit mû par un élan patriotique en tous points conforme à « l’union sacrée » proclamée par le président de la République, Raymond Poincaré, mais aussi avec le désir de faire ses preuves au feu, si bien qu’il ne se ménage guère, pas plus qu’il ne ménage ses hommes. Aussi, dès le premier engagement, le 19 août à Dinant dans les Ardennes, il est blessé à la jambe. Rétabli, il subira une seconde blessure, à la main, cette fois le 10 mars 1915. Mais c’est à Verdun, le 28 février 1916 que le pire se produit. Chargé de tenir le fort de Vaux, l’un des objectifs essentiels des Allemands, il y est surpris par une violente attaque ennemie. Pour se dégager, il tente une percée qui échoue. Blessé d’un coup de baïonnette, il s’évanouit et tombe aux mains des Allemands. Sa captivité se prolongera jusqu’à l’armistice, ponctuée d’innombrables tentatives d’évasion qui échoueront toutes. La rage au cœur, le capitaine de Gaulle n’a pas joué le rôle qu’il espérait dans la Grande guerre.
Quel rôle a joué cette expérience combattante dans la pensée stratégique du général de Gaulle, développée pendant l’entre-deux-guerres dans des livres comme De la discorde chez l’ennemi ou Le fil de l’épée ?
On ne saurait dire que l’expérience combattante de de Gaulle, officier d’un rang modeste et durant une période limitée du conflit, ait pu avoir une influence sur sa pensée stratégique. Ce sont plutôt les loisirs forcés occasionnés par ses séjours à l’hôpital suite à ses blessures et ses longs mois de captivité où il suit avec passion des événements auxquels il ne participe pas qui vont le conduire à une réflexion a posteriori sur la conduite de la guerre à un niveau stratégique. De fait, son premier ouvrage, La discorde chez l’ennemi (1924), attribue la défaite de l’Allemagne au fait que les pressions exercées sur le pouvoir civil par les militaires, au nom d’analyses à courte vue fondées sur les seules opérations, ont interdit au premier d’agir en fonction de conceptions plus globales mettant en jeu l’ensemble des conditions matérielles et morales permettant au pays de l’emporter. Il en tire la conclusion que seul le pouvoir civil est en mesure de coordonner toutes les forces de la nation et d’assurer la direction supérieure de la guerre, les militaires ayant pour charge la conduite des opérations. On peut également considérer que l’ouvrage paru en 1932, Le Fil de l’épée, est le résultat de ses réflexions du temps de guerre, mûries par les conférences qu’il donne en 1925-1927 à l’École de guerre. Il s’y intéresse à la qualité du commandement, exercé par le « chef » qui doit être un « homme de caractère » dont il dresse le portrait idéal (qui a toutes les caractéristiques d’un auto-portrait). Et bien qu’il s’agisse uniquement dans ce livre du chef militaire qui n’a pas à rechercher d’accommodements avec l’opinion, il est clair à ses yeux que ce qui convient à l’armée serait bénéfique au pays.
Sa capture lors de la bataille de Verdun a été instrumentalisée durant la guerre d’Algérie par les partisans de l’Action française pour discréditer la politique algérienne du père de la Ve République. On a alors accusé de Gaulle de s’être lâchement rendu à l’ennemi. Comment est née cette polémique et de quelle manière a-t-elle été exploitée par l’extrême droite ?
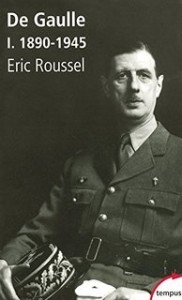
Jusqu’en 1966, soit cinquante ans après les faits, la seule trace historique que nous possédions sur cet événement sont les trois citations (dont deux signées par le général Pétain) exaltant la conduite héroïque du capitaine de Gaulle, citations dont ce dernier admettait qu’elles dépassaient quelque peu la réalité. L’accusation de s’être rendu sans avoir été blessé repose sur deux articles de journaux publiés l’un dans le journal Sud-Ouest en avril 1966, relatant les propos d’un agriculteur qui a combattu à Douaumont, l’autre quelques jours plus tard par l’hebdomadaire d’extrême droite Le Nouveau Candide citant un soldat allemand qui aurait recueilli la reddition d’un capitaine en bonne santé. Comme l’écrit Eric Roussel dans son excellente biographie de de Gaulle, aucun de ces documents n’est vérifiable. Mais ils contrastent tant avec ce qu’on sait de l’enthousiasme guerrier de ce dernier qu’ils ne peuvent que susciter le plus grand doute sur leur véracité. En tout cas, ils ont été du pain béni pour ses adversaires d’extrême droite et, au-delà, pour tous les nostalgiques de l’Algérie française, en particulier dans l’armée, qui ne lui pardonneront jamais l’indépendance donnée à l’Algérie.
Quelle place joue la commémoration des 50 ans de la bataille de Verdun en 1966 dans la réconciliation entre la France et l’Allemagne voulue par le général de Gaulle ?
Il est peu douteux que le rapprochement avec la République fédérale allemande, grande puissance économique européenne, mais État mineur sur le plan politique en raison de son statut de vaincu de la Seconde Guerre mondiale, constitue un objectif majeur pour le général de Gaulle. Il voit en effet dans l’axe franco-allemand un moyen pour la France de jouer les premiers rôles en Europe (à condition de tenir à l’écart le Royaume-Uni). Aussi a-t-il multiplié les efforts pour se concilier le chancelier Konrad Adenauer, depuis son invitation à Colombey-les-deux-Églises en septembre 1958 jusqu’au voyage triomphal que lui-même accomplit outre-Rhin en septembre 1962, en passant par l’émouvant pèlerinage commun des deux hommes à la cathédrale de Reims en 1962. Mais en 1966, cette politique a déjà échoué. Le plan Fouchet destiné à créer une Europe politique a échoué en 1962, le traité de l’Elysée signé entre la France et l’Allemagne en 1963 pour consolider l’axe franco-allemand a été détourné par le vote du Bundestag qui montre que l’Allemagne (comme les autres membres du Marché commun), choisit la supranationalité et l’alliance américaine plutôt que la prépondérance française. De surcroît, le remplacement à la Chancellerie en novembre 1963 d’Adenauer par Ludwig Erhardt, beaucoup moins bien disposé envers un rapprochement avec la France qui signifierait un éloignement des États-Unis contrarie les projets du général. Dans ces conditions, on peut considérer que le discours de Verdun qui se termine par un appel à une « coopération directe et privilégiée » avec l’Allemagne représente une tentative de relance du rapprochement franco-allemand.
Lors de son discours de 1966, le général de Gaulle défend le rôle du maréchal Pétain durant cette bataille sous les applaudissements des anciens combattants. Verdun marque la rencontre entre ces deux destins opposés de l’histoire de France. Peut-on parler d’une relation d’admiration réciproque malgré l’épisode de la Seconde Guerre mondiale ?

Il ne faut pas faire dire à de Gaulle ce qu’il ne dit pas. Il rend hommage aux qualités de chef et d’organisateur dont Pétain a fait preuve, comme commandant de la IIe Armée dans la conduite des opérations en empêchant les Allemands d’enfoncer le front français à Verdun. Si bien que, comme ancien combattant lui-même, s’exprimant en leur nom, il n’entend pas contester la gloire acquise à cette occasion par le futur maréchal. Mais c’est aussitôt pour rappeler que cette vérité ne doit pas occulter les « défaillances condamnables » commises par ce dernier « dans l’extrême hiver de sa vie, au milieu d’événements excessifs » et alors qu’il était atteint par « l’usure de l’âge ». Sans doute sur ce dernier point lui accorde-t-il des circonstances atténuantes, mais qu’on ne saurait identifier à une quelconque admiration. N’a-t-il pas déclaré en d’autres lieux et à ce propos que « la vieillesse est un naufrage » ? Et on sait ce que l’auteur de La discorde chez l’ennemi pense de l’intervention des militaires en politique, alors qu’il a dénoncé en 1961 leur « savoir-faire expéditif et limité ».
Quel regard portez-vous sur les commémorations du centenaire de Verdun ? Comment la mémoire de la guerre a-t-elle évolué depuis la grande commémoration de 1966 ?
Il est clair que, depuis le tournant de 1966, Verdun est devenu, plus qu’il ne l’était alors, l’épisode le plus symbolique, du moins en France, du caractère terrible et acharné de cette guerre puisque durant 20 mois deux millions d’hommes y combattirent, laissant sur le terrain 200 000 morts et 500 000 blessés pour des gains de terrain dérisoires et éphémères. Si de Gaulle, sans oublier sa volonté de rapprochement avec l’Allemagne, peut commémorer la capacité de la France à résister ainsi aux coups les plus durs et appeler en conséquence les Français à consentir les efforts nécessaires à la grandeur du pays, c’est plutôt aujourd’hui l’appel à l’entente franco-allemande pour écarter le retour d’un conflit qui n’a laissé que des vaincus et l’idée de l’inutilité d’une gloire si coûteuse qui me paraît s’imposer.
