Dans Les derniers jours de Drieu la Rochelle, Aude Terray relate les ultimes mois de la vie de l’écrivain phare de la collaboration, de son suicide raté d’août 1944 à celui réussi de mars 1945. La dernière vie de Drieu pousse au paroxysme les mystères de sa personnalité, qui fascinent aujourd’hui plus que son œuvre. Car ces mois de planque et de dépression mettent en tension toute les ambiguïtés de ses rapports à l’engagement intellectuel, aux femmes et à la mort.
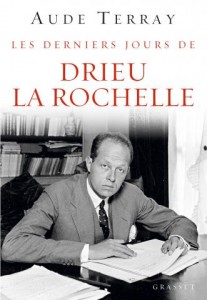
Rarement autant de tragique et de pathétique se sont retrouvés dans un même être à la fois. Il est vrai que Pierre Drieu la Rochelle a vécu à une époque où les événements ne permettaient pas aux médiocres de se cacher. Né en 1893 dans une famille dont il détestait le père et méprisait la mère, il a fait partie de la génération des « 20 ans en 14 ». L’expérience de la Grande Guerre, comme PHILITT l’avait écrit, sera destructrice pour le jeune homme ; il en reviendra avec une haine de son propre corps, souillé par la maladie et le manque d’hygiène, le rejet de son époque, où l’on s’envoie de la ferraille dans la tête pour se battre, et l’obsession de la décadence – sorte de synthèse entre son corps dégradé et l’aversion à son époque.
Trente ans plus tard, c’est cette obsession de la décadence qui l’a jeté dans une impasse : Drieu s’est fourvoyé dans tous ses engagements. Après avoir quitté les surréalistes dans les années 1920, il s’est converti au fascisme après les émeutes du 6 février 1934 et a adhéré un temps au parti du collaborationniste exalté Jacques Doriot, le Parti populaire français (PPF). Surtout, il est devenu la principale figure de la collaboration intellectuelle en tant que directeur de la Nouvelle revue française (NRF) de Gallimard – que son ami et ambassadeur nazi à Paris, Otto Abetz, considérait comme l’une des trois puissances du pays, avec le Parti communiste français (PCF) et la haute finance. À la fin de la guerre, il fait le constat amer de son manque de lucidité politique et, après Hitler, est un temps tenté par Staline.
Les Alliés reprennent du terrain et, à l’été 1944, leur victoire ne devient plus qu’une question de semaines. Chaque jour accable un peu plus Drieu, qui tente de se suicider le 11 août 1944 en ingérant du luminal. C’est en décrivant ce « suicide féminin, propre et lent », qu’Aude Terray commence sa biographie de l’ultime Drieu, dans un livre qui a la qualité de replonger avec fluidité dans sa vie antérieure et de dresser un tableau du Paris intellectuel de la période.
Rendez-vous ratés avec la mort
Une fois de plus, Drieu a pathétiquement raté un rendez-vous avec la mort. Il en a pourtant eu beaucoup. Notamment durant la Grande Guerre, comme il le racontera dans La comédie de Charleroi (1934), lorsque, enfermé dans un cabanon, harassé par des jours de marche sous un soleil de plomb, il ôte sa chaussure pour placer son orteil sur la gâchette de son fusil chargé et regarde le trou du canon. « Je tâtai ce fusil, cet étrange compagnon à l’œil crevé, dont l’amitié n’attendait qu’une caresse pour me brûler jusqu’à l’âme. » Quelques mois plus tôt, en 1913, il voulut se jeter dans la Seine après avoir raté l’examen final de Sciences Po – lui que ses camarades voyaient comme le major assuré. « Vaticinations autour du sujet qui n’est ni posé, ni traité. Style atroce » et 8,5/20 : voilà l’humiliante récompense de sa composition d’histoire sur les traités de 1815. C’est cet échec qui précipita son engagement dans l’armée, doublant la mobilisation de 1914.

Une histoire tirée de l’enfance de Drieu résume son rapport ambigu avec la mort. En vacances dans la maison de ses grands-parents, il s’attache à une poule qu’il appelle Bigarette. Un jour, pour la « nettoyer », il lui arrache les écailles des pattes et la tue. Il écrira plus tard qu’il a découvert ce jour-là sa capacité à faire le mal et les sentiments de honte et de culpabilité – son père le sommant de s’expliquer le soir même en lui exhibant le cadavre. L’obsession hygiéniste du corps et le sadisme de faire souffrir un être aimé, déjà ancrés dans son enfance, seront deux moteurs qui détermineront son rapport aux femmes.
Et il en eut beaucoup. Beloukia – comprendre Christine Renault, la femme du constructeur automobile –, les deux sœurs Ocampo, Kiszia la dernière maîtresse, Olesia Sienkiewicz, sa seconde épouse… En cet été 1944, un ballet d’anciennes – et actuelles – conquêtes s’occupent de « l’homme couvert de femmes ». Surtout une : Colette Jéramec. Sa première épouse, par ailleurs scientifique à l’Institut Pasteur, est d’un dévouement absolu. C’est elle qui s’occupe de lui pendant son séjour à l’hôpital américain de Neuilly-sur-Seine après son suicide manqué d’août, qui organise son exfiltration vers la demeure de campagne de Noel Haskins Murphy, une riche américaine que Drieu a sauvé des camps, dans la vallée de Chevreuse où il passera l’essentiel de ses derniers mois. Colette supporte ses sautes d’humeur, sa santé de plus en plus chancelante et, surtout, son mépris.
Aragon, adulé et détesté
Il faut dire qu’elle a un double défaut : elle est juive et bourgeoise. Soit le type de femme que Drieu a toujours recherché et qu’il a en même temps toujours abhorré. Le coup le plus dur qu’il lui portera est, à coup sûr, le personnage de Myriam dans Gilles (1939), dans les traits de laquelle elle se retrouve. Mais Colette sait aussi qu’elle a une dette inextinguible envers Drieu : il a joué de ses relations pour la faire sortir, avec ses deux enfants, du camp de Drancy d’où elle devait être déportée en Allemagne.
Durant ses derniers mois, Colette est omniprésente. L’écrivain, lui, broie du noir. Sa santé empire, il s’entend de moins en moins avec celle qui l’accueille et, surtout, il a peur. Les mois passent et l’épuration se met en place, notamment sous l’égide du Comité national des écrivains (CNE) qui publie des listes noires. Aragon en est le puissant secrétaire général. Avec Colette, Aragon est l’autre relation clef de la vie de Drieu. C’est d’ailleurs sa première femme qui lui présente le jeune étudiant en médecine, en 1916.
À travers son amitié avec Aragon, il se lie avec les surréalistes qu’il quittera au bout de quelques mois – sans doute était-il trop sérieux pour eux. Et rompra avec l’auteur communiste du même coup. Leur amitié fut ambiguë, et peut-être même homosexuelle, laissa entendre l’auteur d’Aurélien. Surtout, il jalouse le succès littéraire d’Aragon. L’aigreur s’est en particulier aiguisée en 1937, lorsque lui essuyait les critiques acerbes pour Rêveuse bourgeoisie tandis que son ancien ami cueillait le Renaudot pour Les beaux quartiers. « Je l’ai admiré, je l’admire encore, mais ce qu’il est à travers ce qu’il écrit me répugne profondément : cette chose femelle […] », écrivait Drieu dans son journal en 1944.
L’éternel Gille(s)
Malgré sa réclusion, il trouve encore la force de se lancer dans des projets littéraires : Les mémoires de Dirk Raspe, biographie inspirée de la vie de Van Gogh en qui il voyait un compagnon, et Récit secret, une énième introspection. Mais ses projets tâtonnent, l’ennuient et il les couche dans la douleur. À l’image de sa carrière, où Drieu a voulu toucher à tout mais ne s’est imposé en rien. Tiraillé entre la poésie, le roman, le théâtre et l’essai, « il s’en veut de s’être toujours dispersé en jonglant avec les genres », souligne la biographe.

Tragique et pathétique. Là se croisent les deux fils qui ont tissé la vie de Drieu, ce mégalomane qui a passé sa carrière littéraire à jalouser les grands et qui n’a jamais écrit le roman qu’il ambitionnait. Une question se pose, capitale : Drieu était-il un grand écrivain ? Ses œuvres et leur postérité en apportent la réponse : il n’est qu’un petit parmi les grands. Un jeune poète prometteur et remarqué avec son premier recueil, Interrogation (1917), qui ne fut jamais à la hauteur de son ambition – être de la trempe des Malraux, Aragon, Céline… En rappelant que Drieu était fasciné par le Gilles de Watteau dans lequel il s’est reconnu, Aude Terray évoque une clef de son œuvre. Devant ce tableau, écrit-elle, « il s’est contemplé des heures ». Comme dans ses livres, où il ne s’est en somme que regardé lui-même en inventant d’innombrables doubles – la plupart du temps nommés Gilles (ou Gille) – expérimentant sa propre relation à la mort, aux femmes ou à la guerre. Il n’est jamais parvenu à mettre son talent au service d’une ambition littéraire supérieure à sa personne.
Tragique et pathétique, Drieu l’est aussi face à son destin, dans ces derniers mois de guerre. Il a eu le courage de refuser une extradition, comme Louis-Ferdinand Céline et Alphonse de Châteaubriant. L’exil le dégoûte ; il a trop le sens de sa responsabilité intellectuelle. Mais il ne pousse pas la bravoure jusqu’à choisir l’une des deux solutions qui s’offrent à lui : se rendre et assumer lors d’un procès certainement joué d’avance, ou se suicider une fois pour de bon. Son procès, il en a pourtant rêvé dans L’Exorde, l’un de ses tout derniers textes. « Oui je suis un traître. […] Oui, j’ai été d’intelligence avec l’ennemi. […] Mais nous avons joué. J’ai perdu. Je réclame la mort. » Aurait-il eu le cran de tenir ces propos lors d’un procès ? En ne choisissant pas, Drieu agit une nouvelle fois à rebours de l’héroïsme qu’il fantasme.
« Auto-épuration »
S’il devait advenir, il sait que son procès serait un symbole car il est la figure de la collaboration intellectuelle. Toutefois, la pression faiblit un peu, fin janvier 1945, lorsque Charles Maurras échappe à la mort. L’idéologue de l’Action française – qui avait piqué Drieu en le méprisant dans les années 20 – a seulement écopé d’une réclusion à perpétuité et d’une dégradation nationale. Mais la condamnation à mort de Robert Brasillach, exécuté le 6 février malgré l’intervention de plusieurs écrivains dont François Mauriac, plonge Drieu dans la détresse.
Désormais revenu à Paris, planqué une nouvelle fois par les soins de Colette, il se morfond seul dans son appartement du XVIIe arrondissement. Il vit désormais comme un reclus – les sorties dans la rue devenant trop risquées – et passe ses journées à noircir des pages blanches et fumer. La lecture du Figaro, le 15 mars, le sort de sa torpeur pour l’envoyer dans le néant. Il y apprend qu’il fait l’objet d’un mandat d’arrêt. Le lendemain, sa domestique Gabrielle le retrouve gisant au milieu de trois tubes de gardénal, dans une odeur de gaz. Drieu est dans le coma ; il mourra une heure après.
Même pour sa mort, Drieu a oscillé entre le tragique de l’intellectuel tirant les leçons de ses fourvoiements et le pathétique du froussard effrayé par la prison. De tous les titres de journaux qui se réjouirent du décès – Le Populaire saluant une « auto-épuration » –, François Mauriac montra une nouvelle fois son sens de la mesure en signant dans Le Figaro un article évoquant « l’amère pitié » inspirée par cette « fin de bête traquée ». Une manière de montrer que, pour juger le cas Drieu, l’essentiel réside dans l’interprétation du niveau de l’eau dans le verre. À moitié vide, ou à moitié plein.
