Le diplomate français Dominique Decherf a terminé sa carrière comme ambassadeur au Rwanda puis à Djibouti entre 2004 et 2010. Ses souvenirs africains ont paru sous le titre Couleurs (éditions Gabodé, 2012). Il a également publié une biographie de référence sur Jacques Bainville, Bainville, l’intelligence de l’histoire (éditions Bartillat, 2000) ainsi que l’intégralité du journal inédit de l’historien de l’Action française, La Guerre démocratique (éditions Bartillat, 2013).
PHILITT : Jacques Bainville était un fin connaisseur de la culture germanique. Toute idée germanophobe lui était étrangère mais pourtant la question de la menace allemande reste obsessionnelle dans son œuvre. Comment est né chez lui cet intérêt pour l’Allemagne et comment analysez-vous le rapport ambivalent qu’il entretient avec ce pays ?

Dominique Decherf : On a du mal à se représenter aujourd’hui l’engouement intellectuel pour l’Allemagne tout au long du XIXe siècle. Bainville, né en 1879, et de Gaulle, né en 1890, appartiennent à ces générations pétris de langue, de littérature et d’histoire allemandes. Ce qui fait question est au contraire le brutal effondrement de cet attachement. Alors que quatre cinquièmes des collégiens français apprenaient l’allemand comme première langue après 1871, à peine 15% aujourd’hui et le déclin continue. Le fait le plus bizarre est que ce renversement se soit produit aux alentours des années 1960 en pleine réconciliation franco-allemande. L’allemand est mort de sa renaissance. Le souci allemand ayant disparu, plus personne ne devait désormais s’en instruire. Du coup les Allemands nous sont devenus le peuple le plus étranger au monde. On ne comprend plus ce qui s’y passe. On ne lit plus ce qui s’y publie, ni livres ni journaux pourtant si intéressants. On ne peut plus y converser avec personne sinon par le truchement de l’anglais. La chute du mur de Berlin, par le même paradoxe, nous a rendu notre orient proche encore plus lointain. Dresde nous est plus étrange que Shanghai. Comment comprendrions-nous aujourd’hui nos penseurs, écrivains et historiens du XIXe siècle et début XXe sans ces clés allemandes dont nous sommes aujourd’hui démunis ?
Bainville n’a jamais une seule minute détourné son attention de l’Allemagne, pas tant de la ligne bleue des Vosges dans une volonté de revanche, obnubilée par la question de l’Alsace-Lorraine – quoique de lointaine origine familiale lorraine -, devenue une volonté défensive qui débouchera sur la ligne Maginot, mais des Allemagnes, où tout se décide entre Francfort, Stuttgart, Munich, Hambourg et Berlin. Difficulté supplémentaire pour nous Français jacobins de comprendre une Allemagne vraiment fédérale. Jusqu’à aujourd’hui cette clé n’est pas à négliger, y compris dans la revue de presse, car chaque grand organe de presse a une base régionale différente. D’année en année, le jeune Bainville est allé de l’une à l’autre de ces métropoles. Nous sommes bien mal avisés aujourd’hui de négliger ces subtilités. Résultat : la France qui a tout misé sur une relation ultra-personnalisée, ultra-centralisée, au sommet, est absente à peu près partout de la réalité allemande. Ce fossé entre les deux pays sidérerait Bainville. Et l’inquiéterait pour l’équilibre européen, sa préoccupation majeure.
On connait l’influence intellectuelle réciproque entre Maurras et Bainville. Quelle fut celle de Bainville sur la pensée maurassienne concernant les questions internationales en général et la question allemande en particulier ?
L’influence de Bainville sur Maurras est à l’évidence une influence réciproque. Bainville disait encore à la fin de sa vie qu’il avait « tout reçu de Maurras sauf la vie ». Et pourtant combien de proches n’ont-ils pas dit combien Bainville avait manqué à Maurras après sa mort en février 1936 ! Bainville avait apporté à l’Action française sa compréhension de l’Allemagne, que les jeunes pré-fascistes français qui le respectaient tant car il les impressionnait ne tardèrent pas, après lui, à juger datée, surannée devant l’avènement d’un Reich unitaire, d’un État totalitaire, monstre inédit. Bainville était aussi sans doute le seul économiste classique ou « orthodoxe » qui ait adhéré à une Action française encombrée de relents anarcho-syndicalistes devenus corporatistes (Valois). La Bourse fut son école de formation. Il voulait convertir à la monarchie les classes moyennes et les « capitalistes » à la monarchie. En vain. Il a eu plus de succès du côté de Poincaré puis de Rueff. Enfin Bainville était partisan de l’entente cordiale contre l’option pré-souverainiste de la « seule France ». Il aurait reconnu dans le « tory » Churchill le Clemenceau de la seconde guerre. Par honnêteté, il est juste d’ajouter qu’il aurait sans doute eu plus de mal à suivre de Gaulle. Mais sait-on jamais ?
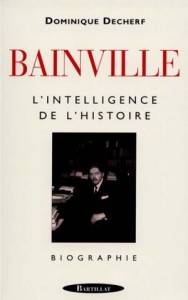
Pour Bainville, un des plus grands torts de la République est d’avoir éveillé le sentiment national allemand et permis la réunification des territoires germaniques. Cette obsession pour la question germanique est-elle l’élément central de sa conversion à la cause monarchiste et son hostilité à la République ?
L’unité de l’Allemagne était d’abord une idée napoléonienne, commencée sous le Premier Empire et réalisée sous le Second. À la mort de Bismarck en 1898, Bainville redécouvrit la pensée profonde du chancelier de fer dès 1873, à savoir que seule une France monarchique appuyée sur le Saint-Siège était capable de former des alliances conservatrices qui isoleraient l’Allemagne et prépareraient la revanche, peut-être même sans guerre. Il n’est pas faux d’affirmer que c’est Bismarck plus que Maurras qui le convertit à la monarchie. Il était monarchiste avant de rencontrer le second.
En 1918, la victoire de pays démocratiques face à des régimes monarchiques est en contradiction totale avec les idées de Bainville sur les relations internationales et sur la faiblesse supposée de la république dans une guerre. Comment analyse-t-il cette victoire qui s’oppose si fermement à ses conceptions politiques ?
C’est la menace et, a fortiori, la guerre allemande qui avait fait de la Troisième République une quasi-monarchie. Ce qu’il a appelé la monarchie de guerre a trouvé son incarnation d’abord dans Clemenceau puis dans le commandement unifié de Foch. Bainville cherchera à prolonger cet esprit après la victoire. Il espérera brièvement en Mangin plus qu’en Lyautey, pourtant fidèle lecteur de Bainville (mais non de Maurras). Son ouvrage sur la Troisième République puis son hommage académique à Poincaré au siège duquel il fut élu en 1935 dénotent une grande objectivité. Déjà en 1920, il terminait son livre Les conséquences politiques de la paix par le souhait que la Troisième République ne finisse pas par un « contresens, comme la seconde avait fini ». On peut inférer de là qu’il se serait tenu éloigné de la « révolution nationale ». Admirateur de Joffre, de Foch et de Lyautey, il ne fut jamais proche de Pétain.
Dans Les Conséquences politiques de la paix (1920), un livre présenté par François Furet comme un des ouvrages « les plus critiques et les plus lucides de son temps », il analyse les erreurs commises par les dirigeants européens dans la négociation du traité de Versailles. En quoi cet ouvrage est prophétique ?

Les Conséquences politiques de la paix est le livre le plus clairement et méthodiquement prophétique des quinze années qui se sont écoulées de 1920 à 1935. Toutes les phases du redressement allemand ont été décrites dans le détail. Toutes sauf une : le personnage de Hitler et le caractère de la révolution nationale-socialiste. L’idée était en l’air, Bainville a utilisé le terme dans un article de 1918, mais le nazisme fut une révolution en soi dans l’histoire allemande. Bainville a su l’analyser comme telle dans les années trente. Il a su à la fois l’inscrire dans une continuité mais aussi en montrer la radicale nouveauté. C’est là son « intelligence de l’histoire » que l’on tire parfois trop du côté du déterminisme, des « lois », alors qu’il sut reconnaître aussi les ruptures, les traits de diachronie, lui le joueur pratiquant l’uchronie pour arriver à l’anticipation des chaînes d’événements autant que des inflexions possibles pourvu que quelqu’un en situation le veuille.
Son analyse de la décadence française sous la République et ses idées d’un nationalisme impérialiste français eut elle un écho de l’autre côté du Rhin ? Servit-elle la propagande nationaliste allemande et nazie de l’entre-deux-guerres ?
Un publiciste allemand adjoint de l’ambassadeur nazi à Paris Otto Abetz, Friedrich Grimm, avait traduit deux œuvres de Bainville pour démontrer l’hostilité foncière des Français aux Allemands, en vertu de la thèse de « l’ennemi héréditaire », depuis le grand Richelieu.
Bainville ne cessa de mettre en garde contre l’Allemagne et de pester contre l’aveuglement pacifiste des socialistes français. Que fallait-il faire selon lui ? La solution qu’il préconisait aurait-elle vraiment pu éviter la Seconde Guerre mondiale ?
Bainville avait exprimé la règle d’or que reprendra plus tard Raymond Aron (auquel il fut parfois comparé) à savoir que politique extérieure et politique de défense doivent être parfaitement complémentaires. Or elles étaient contradictoires dans la France de l’entre-deux-guerres : comment appuyer la Pologne ou la Tchécoslovaquie, nos alliés, sans une capacité militaire offensive ? Comment stationner des forces en-deçà de nos frontières sans la garde du Rhin ? Bainville était hostile à l’évacuation de la Rhénanie. Il avait daté de 1935 la menace parce que le désarmement de la Rhénanie était prévu dans les traités pour quinze ans. Or, non seulement on anticipa l’évacuation, achevée en 1930, mais on ne s’opposa pas en janvier/février 1935 à l’entrée de l’armée allemande dans les territoires évacués. L’histoire montre qu’on aurait pu l’éviter et donc peut-être briser dans l’œuf le militarisme allemand. Nous cumulions une politique extérieure de l’avant avec une politique militaire purement défensive, recette de l’échec.
