Solange Bied-Charreton est journaliste et écrivain. Chez Stock, elle publie son troisième roman, Les visages pâles, une satire de la bourgeoisie catholique française sur fond de Manif pour tous. Souvent comparée à Michel Houellebecq, elle se dit plutôt fille de Perec et de Flaubert. Chez le même éditeur, elle a publié Enjoy (2011) et Nous sommes jeunes et fiers (2013).
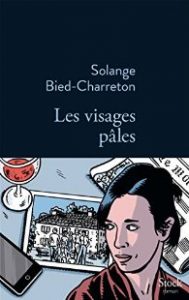
PHILITT : Le titre de votre ouvrage – Les visages pâles – en dit long sur la critique que vous formulez de la société française. Les Français sont-ils exsangues à ce point ? Sommes-nous encore vivants ?
Solange Bied-Charreton : Ce n’est pas un titre qui désigne les Français, plutôt à la fois une génération et un milieu. Il désigne la jeunesse et la bourgeoisie. Mais il les désigne également séparément, le bourgeois d’aujourd’hui étant l’émanation nouvelle de ce qu’il a été, et de ce qu’il a capté, aussi, chez l’antique dominant, chez l’aristocrate. La jeunesse française, elle, est la résultante des Français d’avant. De leur sophistication et de leur sauvagerie. De leur fatigue, aussi. Ce titre désigne, en fait, l’émanation, la génération. Dans mes idées de titres, j’avais aussi retenu le mot « engeance », mais je ne savais pas comment l’habiller. La fadeur et l’anémie, ce que suggère l’adjectif « pâles » : je vois la transmission au-delà de la référence aux colons blancs américains, comme un tampon dont le motif s’émousse peu à peu sur le papier. Quelque chose est, de génération en génération, perdu. Et renouvelé aussi, transformé, sublimé.
Mais mes personnages, eux, sont tournés vers le passé, vers la maison de leur grand-père qu’ils ne veulent pas vendre et qui constitue leur point d’ancrage. Libre au lecteur d’appliquer ce filtre aux Français. À titre personnel, je crois que l’Occident est mort. Je ne m’en lamente pas, bien au contraire, cette agonie ne dure que trop. C’est aussi la raison pour laquelle le conservatisme me rebute, c’est de la nécrophilie. Certains de mes personnages sont d’ailleurs assez nécrophiles. En somme, je crois avoir écrit le roman d’une certaine France qui s’efface et de ceux qui sont incapables de la penser autrement qu’au passé. Ils y cherchent une esthétique, un certain romantisme, mais jamais la vie. C’est également le symptôme d’une époque, d’un temps qui va mal. La grand-messe de célébration du passé ressemble, à s’y méprendre, à celle dite au nom de la toute-puissance du futur. Deux faces d’une même pièce semblent se disputer aujourd’hui un combat aveugle. Or désormais que tout est en ruine, ce n’est ni la macération du passé ni le progrès, dont le rêve prétentieux nous a empêchés de vivre qu’il faut saisir, c’est le kaïros.
Vous vous intéressez particulièrement dans votre livre au mouvement de la Manif pour tous. Le personnage d’Alexandre, emblématique de ce militantisme catholique et bourgeois, semble frappé de vacuité. La jeunesse française est-elle capable de renouer avec de grandes idéologies politiques ?
Le militant de la Manif pour tous n’est pas représentatif de la jeunesse de France. J’ai ambitionné de faire le roman de la bourgeoisie de droite en 2013, et la Manif pour tous étant un phénomène qui a marqué ce milieu cette année-là sur le plan tant politique que sociologique, c’était l’élément narratif adéquat. Il m’a permis de caractériser, de révéler les personnages, en situation et en intention. Ce qui m’a d’emblée frappée, en travaillant sur la Manif pour tous, c’est qu’elle s’inscrit de manière si limpide dans la lignée d’autres mouvements de droite qui ont traversé l’Histoire depuis la fin de la Révolution française. D’abord, elle révèle deux droites, la bourgeoisie (et les résidus aristocratiques), assez frileuse dans l’action ; l’identitaire, populaire, bagarreuse. C’est, encore et encore, la ligne de démarcation entre les émigrés et la chouannerie. Et plus tard, l’Histoire recommence. La référence au 6 février 1934 est présente dans mon roman, avec l’épisode mythifié du récit de l’arrière-grand-père. Je rappelle les chemins des différents cortèges et le déroulé des événements pour bien montrer la fracture sociale, double, qui s’opère dans Paris à ce moment-là. Entre la droite et la gauche d’une part, entre la droite bourgeoise et la droite canaille de l’autre. Cette partition très française ne date donc pas d’hier. Elle est aussi au centre de la trilogie de Marcel Aymé (Travelingue, Le chemin des écoliers, Uranus). Cette quadripatrition consiste en l’existence de la grande et la petite bourgeoisie de manière égale dans les milieux dits « de gauche » et ceux « de droite », si tant est que ces orientations renvoient encore à quelque chose à l’époque où mon action se tient.

Pour en revenir à Alexandre, c’est en effet un personnage empreint d’une vacuité remarquable. Il est, comme Hortense dans son domaine, l’avatar d’un microcosme, et presque rien de plus. Comme Ivan et Noémie étaient ceux de la néo-bourgeoisie dans mon livre précédent. Alexandre est catholique parce qu’il faut l’être, parce que toute la famille de sa mère l’est. Il l’est donc pour des raisons d’appartenance sociale, mais il l’est aussi pour des raisons « identitaires », ce qui lui permet de se démarquer de ce qui n’est pas, ne serait pas français, ne serait pas traditionnellement « de France ». Ce faisant le personnage d’Alex nous renseigne à la fois sur l’assurance (bourgeoise) de la pérennité de l’entre-soi et l’inassurance (de droite) de l’identité. Il est traversé de convictions contradictoires, que l’épithète « libéral-conservateur » suffit à définir. Il reproduit le schéma social et évite le déclassement en devenant ingénieur comme son père et sa mère l’ont voulu pour lui, ce qui lui permettra de s’identifier aux groupe de personnes dont il est issu, sans rupture de ton. Mais il exprime aussi, en résonnance avec les aspirations de la petite bourgeoisie, dont il n’est pas issu mais dont il tire une certaine raison de vivre, l’insécurité de l’identité, la tentation du repli sur soi. Ce qui donne ce cocktail particulier, la version année 2010 de la frange bourgeoise des milieux réactionnaires en France, que nous avons pu retrouver en ses déclinaisons diverses dans les rangs de ce mouvement qui, s’inscrivant dans les mouvements de défense de « la vie », exclut toutefois de ce mot écran ses conditions économiques et sociales, n’ayant jamais eu, ou si peu, à s’en plaindre.
La postmodernité est souvent définie comme une réaction face à la modernité, comme une volonté pour les modernes de renouer avec des éléments traditionnels ou classiques. Le combat de la jeune garde de la famille Estienne pour conserver la Banèra (la maison familiale) est-il un symptôme de cette postmodernité ?
S’agissant de la famille Estienne, tout se joue à une échelle plus réduite sur le temps, dans la France de l’après-guerre. Bien qu’il se positionne à droite, le père, Jean-Michel est, comme le qualifie son fils « un soixante-huitard de merde ». Ce positionnement, que ceux ont réussi finissent directement ou indirectement par adopter, est celui des dominants, de la droite de l’argent, qui trouve son pendant dans la gauche culturelle (c’était peu ou prou le sujet de mon précédent livre, et la passerelle existe, puisqu’Hortense est amie avec Ivan, le personnage de Nous sommes jeunes et fiers). Mais c’est aussi le rappel du constat sans appel de Marx et Engels dans Le Manifeste du parti communiste (1848) : « La bourgeoisie a joué dans l’histoire un rôle éminemment révolutionnaire. » L’âge moderne est celui de la suprématie des valeurs du progrès bourgeois contre l’ancien ordre féodal. Pour faire vite, ce qui s’oppose à la transmission, c’est l’innovation.
Dans l’histoire de la maison, Jean-Michel joue le rôle du bourgeois, du chambouleur, jusqu’à la caricature, et ses enfants sont les conservateurs. Même le personnage d’Hortense, et ce n’est pas la seule des contradictions. Si les enfants Estienne sont postmodernes, c’est également, et même surtout à cause de cela, de ces contradictions incessantes entre volonté d’innovation, d’existence indépendante, de liberté qu’ils ont en commun avec Jean-Michel, et rattachement à une lignée, mystification du passé, d’un lieu du passé (la Banèra), qui cristallise leur nostalgie mais joue également le rôle de garde-fou mental, d’exil rêvé, qui leur permet de tenir le coup dans leur vie compliquée, instable, à Paris. Raoul Estienne, le grand-père, est la version humaine, patriarcale de cette émanation. Raoul est le passé, le « c’était mieux avant ». Son existence même vient témoigner de la pâleur de leur visage (ce n’est qu’en se comparant à Raoul qu’Hortense, Lucile et Alexandre sont des visages pâles). Pour autant, la vision qu’ils ont de Raoul, de la maison et de la France même, est forcément faussée car Raoul lui-même était probablement le visage pâle de son grand-père.

De manière générale, vos personnages sont souvent médiocres et pathétiques – « une génération d’informes et tristes nains ». Est-ce un choix romanesque ou considérez-vous que ces types psychologiques vous sont imposés par la réalité ?
Je ne sais pas si mes personnages sont en général médiocres et pathétiques, j’essaie de créer des personnages réalistes. À la fois ambitieux et vains, fidèles et frivoles, traversés par des éclairs de lucidité et aveuglés par leur quotidien. Je n’ai pas une vision sombre de l’existence, pas du tout, mais je tente de ne pas en avoir une vision idéalisée. C’est seulement comme ça que je vois les gens, médiocres et pathétiques si vous voulez, plutôt limités, de bonne volonté et fragiles, je dirais. Je suis de l’école de Flaubert, de celle de Maupassant, je ne veux pas de personnages sublimes, ni dans la bonté ni dans l’exécration. Je veux peindre des gens que je pourrais rencontrer, que j’aurais pu croiser dans une entreprise, dans le métro. Au passage je ne veux pas non plus les juger, ou prendre parti, je n’ai pas à cœur de produire un discours sur la société, ou une morale sur les comportements. C’est l’écueil le plus récurent que l’on retrouve dans la presse et les conversations de salon, s’imaginer qu’un romancier a quelque chose à dire quand celui-ci a seulement quelque chose à écrire.
Pour en revenir aux personnages, Balzac a entamé le prestige du héros, de l’idéal chevaleresque peut-être, avec Rastignac, arriviste, avec César Birroteau, spéculateur, avec d’autres personnages encore. C’est que Balzac introduit le quotidien, cette « bataille inconnue qui se livre dans une vallée de l’Indre entre Mme de Mortsauf et la passion », comme il le dit dans la préface de la Comédie humaine. C’est aussi la volonté retrouvée d’un Perec, quand il écrit dans L’Infra-ordinaire que « les journaux parlent de tout, sauf du journalier. Les journaux m’ennuient, ils ne m’apprennent rien ». Ce qu’il veut raconter, en tant que romancier, c’est « ce qui se passe vraiment ». Sans doute est-ce la modernité – la post-modernité aura accru le phénomène – qui a poussé la littérature occidentale à flirter davantage avec le réel que l’idéal, avec l’humain que l’hagiographie. Vous retrouvez la même chose en peinture, il a fallu des siècles pour que la représentation ne soit pas une simple stylisation mais un effort pour se rapprocher de la transparence. Je ne considère toutefois pas cette orientation comme un « progrès », surtout en peinture. Je pense qu’on a perdu beaucoup de beauté et de splendeur depuis l’invention de la perspective. Mais ce qui se passe entre Cimabue et L’enterrement à Ornans de Courbet, c’est bien la possibilité de représenter le médiocre et le pathétique, autant que le sublime et l’enchanteur, c’est peut-être aussi la liberté de ton et de sujet. Et cela correspond à une définition du réel. C’est elle qui m’intéresse.
Votre pessimisme et votre ton vous ont valu d’être comparée à Michel Houellebecq. Trouvez-vous cette comparaison pertinente et, si oui, l’assumez-vous ?
Les journalistes manquent de références ou plutôt ont-ils à cœur d’établir des repères rassurants, simples et démocratiques. Or j’ai commencé à lire Houellebecq parce qu’on me comparait à lui quand est sorti mon premier roman, en 2012. J’ai aimé certains de ses livres, surtout la poésie, mais cette comparaison est un non-sens journalisitique de plus, c’est drôle mais arbitraire et ça énerve sans doute Michel Houellebecq lui-même d’entendre ici et là qu’on lui cherche des enfants. Je crois que j’aimais écrire comme le premier Perec, celui des Choses, car ce livre m’a obsédée adolescente. Ensuite je suis allée chercher l’influence directe de ce Perec sur le plan stylistique (au passage je suis d’avis que c’est le style qui délivre une vision du monde et jamais vraiment l’inverse), le Flaubert des romans aigres, Madame Bovary et L’Éducation sentimentale, mais cela s’est fait dans ce sens. Il semble que Michel Houellebecq soit un lecteur de Perec, ce qui pourrait expliquer ce rapprochement répétitif et incongru. Mais je comprends aussi les critiques, il n’y a peut-être pas assez de romanciers qui, en France, s’intéressent à la société et son évolution, creusent le sociotype, aiment tourner en dérision ces vaches sacrées que sont par exemple les jeunes, le divertissement, le confort, la réussite sociale ou l’humanisme.
Crédit photo : Louise Oligny
