Si le roman noir s’inscrit historiquement dans la logique d’une pédagogie puritaine où l’épouvante a vocation à juguler les passions du lecteur, le genre a pu influencer bien des âmes se réclamant du catholicisme. L’esthétique gothique où l’atroce s’unit au sublime prolonge l’énergie prométhéenne contenue dans le romantisme. Le roman noir nous livre ainsi le secret de l’âme mélancolique : « Le goût des larmes est le goût du sang qui devient raffiné », écrivait Ernest Hello.

La théologie romaine nous enseigne que le satanisme met en scène une caricature du Christ. « Singe » de Dieu selon saint Jérôme, Satan parodie la Passion, sous couvert d’effroi et de mélancolie, pour mieux occulter la Résurrection et nous détourner de l’exigence chrétienne : l’union avec le Christ. L’appel à la sainteté invite le chrétien à se dépouiller du vieil homme pour revêtir l’homme nouveau, transfiguration qui ne revient certainement pas à anéantir le corps, temple de l’Esprit. En profanant volontiers une telle croissance spirituelle, le catholique romantico-noir croit de toute son âme que le Christ s’est incarné avec le péché.
Jésus-Christ a certes pris sur lui les misères humaines mais l’Église reste formelle sur ce mystère : Il n’a pas péché. Dès lors, si Dieu vient à nous, ce n’est pas pour nous tirer vers le bas mais bien pour nous élever jusqu’à Lui et ainsi accomplir l’union d’amour entre notre intelligence et notre volonté. En pariant au contraire sur l’absence de Dieu en tant que sanctification, cet imaginaire d’un Dieu en négatif néglige le mot de Pascal selon lequel « Dieu se cache à ceux qui le tentent, et se découvre à ceux qui le cherchent », sans jamais réaliser la mise en garde de Maurice Blondel : « Il n’y a pas plus de vide hors de Dieu qu’il n’y a de vide en lui. »
Dieu des morts, non plus des vivants, le Christ est avant tout, aux yeux du catholique gothique, un Christ errant. Selon son esthétique décadente, le dépouillement de Dieu dans son humanité, la kénose, n’obéit pas à cette métamorphose vivante et assomptive que constitue la logique du salut, mais à une dégénérescence macabre. Ce n’est plus un dépouillement, c’est un reniement ; ce n’est pas un ressuscité, c’est un mort vivant. Il en va de sa delectatio morosa, sensiblerie doloriste livrée à « la jouissance de [son] propre délire » selon Pierre Klossowski (Sade, mon prochain). Peu lui importe, au fond, l’exhortation de Saint Paul (Rm. VI) : « Demeurerions-nous dans le péché, afin que la grâce abonde ? Loin de là ! […] Que le péché ne règne point dans votre corps mortel, et n’obéissez pas à ses convoitises. »
Le péché original
Dans l’univers gothique, l’expérience du mal s’offre davantage comme la voie privilégiée d’un salut authentique. Avec sa présence nébuleuse, le Christ d’outre-tombe n’a plus rien à voir avec le Sauveur qui écrit sur le sol pour contourner le péché de la femme adultère et des pharisiens décidés à la lapider ; Dionysos a remplacé le Crucifié, le voilà désormais guérissant le mal par le mal.
Assurées que Dieu écrit droit avec des lignes courbes, ces âmes errantes ont fini par croire que le Tout-Puissant se manifestait nécessairement dans le sang et les larmes au risque d’oublier que le Seigneur enjoint les pas de ses disciples à « rendre droits les sentiers tortueux » (He. XII, 13). Jouer avec le feu est l’occasion de renoncer à la « vraie obéissance » et à la « droiture » réclamées par saint Paul (Rm. VI, 16), lesquelles ne sont pas le conformisme bourgeois, contrairement à ce que prétendent ces iconoclastes adolescents, mais fidélité d’autant plus vivifiante qu’elle engage tout un corps.
Convaincu d’être indispensable à la divinité, cet orphelin de Dieu convertit le don de l’existence en sa propriété selon un désir d’exclusivité assurément vampirique. Il ne veut pas être aimé mais préféré. Il veut être possédé. Pour retrouver l’étincelle divine qu’il croit détenir depuis les origines, il s’anéantit jusqu’à privilégier l’humeur noire, le mauvais sang, digne des sarments secs que le Christ jette au feu (Jn. XV). En confondant le feu de l’Enfer avec celui du Purgatoire, il se coupe de la relation avec Dieu… et se fait l’esclave du diable. La ligne courbe éclate alors en fureur poétique, trahissant une fascination devant le scandale d’autant plus affectée qu’elle consacre paradoxalement toute son énergie à transgresser la paix, pourtant véritable don divin et « tranquillité de l’ordre » selon saint Augustin. Chez ce chrétien frénétique, le pardon n’est plus reçu comme l’exercice de la miséricorde mais comme une indifférence face au péché.

Couvert de cendre, ce chrétien-là se veut plus chrétien que le Christ, dissolvant la métamorphose paulinienne dans la chute. Alors que le Christ se sacrifie pour les autres, lui se sacrifie pour lui-même. Obtenir le salut revient ici à se perdre. Son sacrifice, c’est son sacrilège. En intériorisant le désespoir, il confine à la vexation satanique qui inverse l’espérance chrétienne : le surhomme, sépulcral avec son cœur de pierre, remplace l’homme nouveau au cœur de chair glorifié dans son humilité. À force de se prélasser dans le vice suprême, il se condamne à la statue de sel. Infesté de blue devils, la solitude l’enivre comme un élixir de longue vie. L’ascèse est le moyen de ciseler un aristocratisme spirituel, gonflant son amour-propre : le péché, qu’il pense ainsi isoler à sa guise, s’élève ici en puissance majestueuse, plus sanctifiante que la grave allégresse des saints.
Ce n’est surtout pas de sa faute, nous soupire-t-il, il ne sait pas vraiment ce qu’il fait, il en va de son bon cœur qui l’absout déjà de tout scandale. Intouchable car victime de son détachement, traînant avec lui sa blessure sacrée à l’image du pied-bot de Byron, scellé dans la fatalité. Son héros faustien, Manfred, admet que « rien ne peut exorciser l’âme indépendante, rien ne peut lui arracher le sentiment énergique de ses propres fautes, de ses crimes, de ses tourments et de sa vengeance sur elle-même ; point de supplices à venir qui puissent égaler la justice que se fait à elle-même l’âme qui se condamne. » Il finit par sacraliser ses blessures plus brûlantes à ses yeux que la miséricorde elle-même ; « il m’eut fallu un confesseur digne de mon repentir, et je ne l’ai pas trouvé », écrit George Sand dans Lélia.
Le lyrisme noir ou la passion de grâce
C’est dire si le désir de conversion est ici vécu comme supérieur à la conversion elle-même, au point d’oublier que « les hommes prennent souvent leur imagination pour leur cœur ; et ils croient être convertis dès qu’ils pensent à se convertir. » (Pascal) À mesure qu’elle s’éloigne de tout sacrement, cette âme désolée, au « cœur dur et à la tripe sensible » selon Bernanos, justifie sa descente aux enfers pour mieux écraser la grâce sous une libido dominandi. La théologie définit ce désir vorace comme la « concupiscence » (littéralement : désirer ardemment).
Concupiscence froide, l’apathie consacre la mort spirituelle au travers d’un lyrisme noir et vient en réalité célébrer une passion de grâce. Il ne s’agit pas ici de rendre grâce, par la louange, mais de dérober la grâce, par le désespoir. Plus il brûle, plus ce pharisien de l’âme tourne la Passion en sa grande rivale à jamais inaccessible ; la Croix n’est plus reçue comme la victoire sur le péché, elle est pour lui le péché en acte qu’il reproduit au nom d’une imitation du Christ chargée de jalousie spirituelle. Drapé dans sa Brume de l’Esprit, il pense racheter les fautes commises pour quelques larmes. Élection sur mesure, son désert se substitue au sacrement de pénitence. Plus il se sacrifie, plus il se sacralise : dieu sans Dieu, il s’engrâce. Pathologie du salut en tant que dégoût spirituel, l’acédie épuise alors la grâce agissante pour se coaguler en une âme égarée, possédée par la négation de Dieu et par son oubli radical. Ce n’est pas une écharde dans la chair, c’est une incirconcision du cœur. Cette croix sans Christ ne donne jamais vraiment son corps, mais l’oublie intus et in cute, en peau de chagrin. Un tel martyre avorté condamne, selon la Tradition, au péché contre l’Esprit, le seul qui ne sera pas pardonné, parce qu’il pourrit la volonté en un non irréversible, un esclavage lymphatique et infernal.
Devant la tentation, tous les maîtres de la vie spirituelle sont pourtant unanimes : le véritable courage est de fuir. Nul besoin de la chute si l’âme réclame secours. Bien plus, Dieu promet sa protection paternelle pour que l’homme ne continue pas à tomber ni à se réfugier dans sa chute. À l’encontre de cette brûlure égotiste, l’évidence catholique joue toujours la promesse contre la chute au point qu’« en aucun cas et dans les pires tentations, nul n’est jamais absolument seul. » (Maurice Blondel, L’Action, tome II)
Suspendu à sa solitude comme à sa croix, ce Pierrot noir pétrifie sa volonté propre pour séduire le Créateur. C’est un boudeur de Dieu. Son abandon inconsidéré se veut plus que jamais considéré : c’est une technique, une séduction, une imposture. Il se fait victime pour se faire prier. Ontologie satanique par excellence, une telle bouderie poétique obéit en réalité à une passion de grâce ; il ne s’agit plus ici de recevoir l’action de la grâce mais de la posséder, définissant, au sens strict, une ingratitude, installée dans sa brûlure vaniteuse, son péché original qui fait sien la nuit de l’Esprit. Le catholicisme ténébreux n’est pas eucharistique, il est ingrat. Du haut de son ordure, cet orgueil à rebours traduit une mauvaise foi, toute grasse de larmes, digne des « larmes prostituées qui ressemblent aux sacrifices humains » (Ernest Hello, L’homme).
La Croix sans le Christ

Quand Bloy s’arrête sur la Vierge dans Celle qui pleure, il cherche dans le message de la Salette une résonance apocalyptique. Si la Vierge pleure, de son côté, c’est pour que l’homme cesse de pleurer en raison des mauvais choix qu’il pose, les yeux rivés sur les réalités terrestres, abandonnant la foi et notamment la sanctification du dimanche. Le décor aussi féérique que désertique de la Salette a sans doute aussi beaucoup joué dans son imaginaire.
Ainsi préférait-il la Dame qui pleure de la Salette à la Marie consolatrice de Lourdes, jugée bien trop populaire. En cherchant à jouer la brebis égarée, Bloy sortait de la simplicité biblique. Avec la morgue facile d’un pénitent noir, il disait qu’il commencerait à aimer Lourdes quand un chrétien demanderait à y aller non pas pour être guéri mais pour être couvert de souffrance.
C’était oublier que la guérison spirituelle est elle-même une blessure, la seule qui ne soit pas affectée, la blessure d’un être qui ressent l’excès de la présence de Dieu et qui meurt à lui-même, par-delà les mots, en recevant le don surnaturel de la grâce. À l’envers, jouer la brebis égarée est une façon de mettre Dieu à l’épreuve. En s’éloignant, il choisit son salut. L’impatience de la vision béatifique rompt avec les intermédiaires, trahit plus directement un marchandage où le désir brûlant d’une sainteté à gagner se met en scène par la magie lacrymale. À force de tambouriner, non sans raison, contre les chrétiens qui se croient propriétaires de leur religion, Bloy a fini par se croire propriétaire de Dieu, auto-proclamé prophète s’émancipant peu à peu de la Loi. Toute son écriture est traversée par cette croyance intime.
À partir de ce dandysme mystique, l’essai de Raymond Barbeau, Un prophète luciférien : Léon Bloy, voit dans le Mendiant Ingrat « le bourgeois de l’Abîme d’En-Bas, ayant succombé au premier et au plus fantastique lieu commun du Serpent tentateur : sa frauduleuse divinisation ». Le solo pour un Dieu renvoie plus directement à l’esprit de la bourgeoisie qui se complaît dans le cirque de sa vie intime, avec sa littérature, sa poésie, ses saints, ses monstres. Son christianisme est élitiste. Ce qui l’intéresse, ce sont bien ces âmes monstrueuses, excessivement démonstratives, autrement dit spectaculaires. Parodies du corps glorieux qui se donne, ces écorchés vifs s’oublient dans une parade de corps fiévreux. Sans passé ni mémoire, l’esprit formaliste ne vit rien d’autre que de bluettes qu’il esthétise : sa providence, son apocalypse, son cinéma dans une petite boîte. Seul le mode de vie bourgeois jusque dans sa radicale observance, la bohème, favorise un art de vivre en danse macabre, pour cultiver la démesure du rêve anti-cochon. Le théâtre de la décadence lui offre, par la voie de l’écriture, la condition d’un salut personnel, sa Sola Scriptura : elle accomplit son théorème de l’ouroboros, l’être-de-l’Héautontimorouménos, le serpent qui, hypnotisé par son mythe, « cet amour du cœur pour sa torture » (Edgar Poe, La genèse d’un poème), finit par engloutir les fruits de sa propre condamnation et sucer le « poison noir » de « [son] cœur le vampire » (Baudelaire, L’héautontimorouménos).
Le miroir des âmes anéanties
Le mal se pose ici en remède purificateur. Cette dialectique saturnienne tire son origine, selon Gusdorf, d’un « piétisme spirituel, délié de toute obéissance confessionnelle précise », poussant Carl Schmitt, dès Romantisme politique, à admettre que « cette relation du protestantisme et du romantisme paraît s’imposer ». On se souvient de la lettre de Luther à Melanchton dans laquelle, en refusant de faire confiance à l’action humaine, le réformateur dissolvait la volonté dans le péché au point de le légitimer comme abandon à Dieu : « Nous devons pécher tant que nous sommes ici-bas, car cette terre n’est pas l’habitation de la justice… Pèche donc, mais pèche pour tout de bon, car Dieu ne sauve pas les demi-pécheurs… ; pèche, mais pèche fortement… ; commets, s’il est possible, cent mille meurtres et cent mille adultères par jour. »
Plus directement proche de la mystique libertine du Libre-Esprit, la foi s’unit ici à une annihilation, entraînant engourdissement et, a fortiori, climat d’angoisse. Avec la terreur, Barbey d’Aurevilly entend moraliser son public et conçoit l’épouvante comme « le plus beau des étonnements ». Exercice d’épuration du cœur, le Mysterium tremendum et fascinans est vécu comme un frisson intérieur qui a vocation à susciter la rencontre avec le Tout Autre.
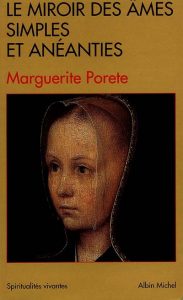
L’amour devient le miroir des âmes anéanties : plus on épouse l’étrangeté avec ce qu’elle contient de laideur visqueuse, difforme ou bossue, plus on croit toucher Dieu en embrassant le bouc. Selon cette dialectique morbide, la négation de soi conduit à la furor amoris, Amour Pur qui recherche la fusion plutôt que l’union, aboutissant à une liaison éminemment dangereuse. Monstres héritiers d’une telle sensiblerie nihiliste, le dandy et la femme fatale, goule qui a délaissé le surnaturel des premiers récits gothiques, rivalisent d’indifférence, singeant les dieux impassibles et leur pouvoir de vie et de mort.
Leur misogynie agressive est un moyen de mettre à distance le corps féminin, lui-même considéré comme un instrument ou réduit à ses crises menstruelles, pour mieux justifier ses éventuelles infidélités, le confortable rapport dominant-dominé, et ainsi occulter sa croissance spirituelle.
Leur froideur de marbre, l’effroi qu’ils cherchent à inspirer, dissimulent une voracité érotique, une libido scientiendi. Serpents les uns pour les autres, du persiflage au sang-froid qu’ils affectent de maintenir, ils dépendent férocement du regard de l’autre comme, de toute son âme anéantie, la béguine s’effaçait dans son Autre, pour mieux y mourir ; de son côté, la mante religieuse se fond dans l’univers de la victime qu’elle va dévorer. Ce désir de mort manifeste à vif une volonté de puissance où le corps est, comme prix à payer, offert en sacrifice, l’un à la non-volonté, l’autre à la débauche, jusqu’à la perdition. Ils confondent le suicide avec le martyre : chez le martyr, le corps se donne ; dans le suicide, il s’oublie.
En crise permanente, l’âme romantique traduit une posture libertine où le sentiment de culpabilité est piétiné dans un éternel « ce n’est pas ma faute ». Le romantisme se révèle alors cache-sexe du libertinage. Son emphase lyrique est au service d’une libido sciendi : « Ma tête seule fermentait ; je ne désirais pas de jouir, je voulais savoir. » confie la Marquise de Merteuil au Vicomte de Valmont dans Les liaisons dangereuses.
En préférant la chute, son risque et sa fuite esthétique, à l’amour créateur qui honore une promesse vivante, la ferveur intellectuelle obéit à une thérapie intérieure non dénuée d’individualisme. Gnostique, il fait de la connaissance de son néant la condition d’un salut. Ce n’est pas dans la vérité qu’il veut vivre, mais dans le savoir de son propre péché. Ce savoir, c’est le reflet de son âme anéantie, prisonnière d’un nihilisme vécu comme lucidité froide sur les choses quand il n’est que luxe de la vitalité et complaisance esthétique vis-à-vis de ses petits péchés mignons, poussant Ernest Hello à casser le miroir de ces tristes sires avec « des éclats de rire capables d’ébranler le monde. Ce bruit est peut-être le seul bruit qui les réveillerait de leur sommeil ».
