L’universalisme est un marqueur de la modernité qui, bien que philosophique et abstrait à son origine, s’est aujourd’hui mué en ambition cosmopolitique concrète. L’idéal d’un gouvernement mondial parvenant à pacifier le globe en l’unifiant semble pourtant, plus que jamais, inactuelle.
L’idée d’un universum politique prenant la forme d’un État mondial n’est pas neuve. Elle a connu son heure de gloire à la fin des années 1940 lorsque, après deux conflits mondiaux, ses partisans ont émis l’idée qu’une solution pacifique durable ne pouvait être, elle aussi, que mondiale. Mais elle n’est pas morte non plus, et l’on rencontre encore quelques défenseurs plus ou moins assumés de cet idéal cosmopolitique, dont l’essayiste controversé Jacques Attali.

Il serait d’ailleurs injuste de condamner a priori cette idée d’unifier l’humanité dans une seule et unique entité politique globale. Il n’y avait, dans l’esprit de ses défenseurs originaux, sans doute aucune des perversions qu’un certain conspirationnisme croit systématiquement déceler. Après la Seconde Guerre mondiale, cet idéal semblait plus que jamais réalisable et, pour beaucoup, souhaitable. Toutefois, le temps a passé et les phénomènes contemporains font apparaître l’inévitable violence qu’il induit. Une violence certainement plus intense que la violence « normale » des relations internationales.
L’indépassable impérialisme
Les tenants d’une unification du monde évoquent trop peu la question du moyen par lequel celle-ci est possible. Il faudra bien qu’une puissance quelconque, par exemple un État, « prenne » le monde et impose sa puissance sur toute sa surface. Qu’il s’agisse d’unir les prolétaires de tous les pays en expropriant les expropriateurs, ou de faire régner la loi du marché, une force doit s’établir et gagner le monde entier pour y établir son ordre. L’hégélien Alexandre Kojève rêvait d’un « colonialisme donnant » capable d’unifier le monde autour d’un capitalisme qu’il espérait raisonné.

En 1955, celui-ci écrivait : « Et dans 10-20 ans, même un ‘non hégélien’ remarquera que l’Ouest et l’Est veulent non seulement la même chose (sans doute depuis Napoléon), mais qu’ils le font aussi. Alors la ‘mise au pas’ sera facile. Tout cela à titre de commentaire de ma formule selon laquelle il n’y aura plus de prise, mais seulement de la consommation ». Son contradicteur Carl Schmitt persistait alors à lui opposer cette évidence : il faut d’abord prendre pour pouvoir partager, exploiter, et finalement donner. Plus de 50 ans plus tard, la prophétie de Kojève demeure, au moins pour une grande part, irréalisée. Si l’État tel qu’on a pu le concevoir a disparu, le monde demeure politiquement divers et fragmenté. Si bien que toute ambition universelle, malgré l’émergence d’une classe consommatrice mondiale (dont les allures de dernier homme coïnciderait pourtant bien avec la fin de l’Histoire), nécessite encore une prise, une volonté de dominer, une violence. Et les stratégies de domination culturelle, par exemple, sont, autant que les stratégies militaires, des vecteurs d’une telle violence.
Parce qu’il y aura toujours — du moins faut-il l’espérer — un irréductible à faire céder, un objecteur à soumettre pour parachever l’unification, l’impérialisme semble être le moyen nécessaire de toute politique à l’échelle du monde. Car on ne peut pas raisonnablement penser que, comme un seul homme, l’humanité entière consente demain à se défaire des particularismes qui sont son patrimoine pour s’unir. Tandis que l’on peut raisonnablement penser que l’impérialisme dont nous parlons est encore à l’œuvre aujourd’hui. Mais on doit aussi et surtout constater que les phénomènes que nous connaissons actuellement marquent l’échec de l’idéal cosmopolitique et en soulignent la dangerosité.
L’État universel ou l’impossibilité de l’exil
La guerre civile syrienne, le renouveau du terrorisme, le développement d’une surveillance massive ou encore la problématique des réfugiés politiques sont les signes de notre temps. On redécouvre que la violence politique n’oppose pas nécessairement des États, mais qu’elle s’insinue aussi en leur sein. On prend conscience de la chance que l’on a de pouvoir fuir, et l’on regarde l’État voisin, pourvu qu’il soit fort et maître de lui-même, non pas uniquement comme un ennemi potentiel, mais aussi comme un refuge possible. Ces perspectives nouvelles, ou plutôt ces perspectives classiques que l’on découvre à nouveau, comptent parmi nos préoccupations majeures et constituent les arguments les plus forts contre l’idéal cosmopolitique.
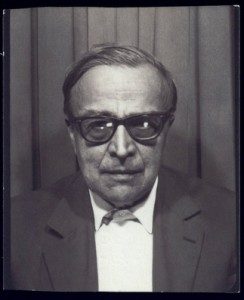
On a d’abord pensé que la multiplicité des entités politiques, c’est-à-dire des États, était néfaste car leur concurrence inévitable occasionnait la guerre. Mais tirer conséquence de cette supposition pour légitimer l’idéal cosmopolitique concret, y compris celui d’un gouvernement mondial issu d’un suffrage littéralement universel, c’est oublier que la concurrence est le revers de la diversité des ordres et des visions du monde, laquelle rend possible l’exil, et garantit la liberté. Or comment trouver le refuge dans un État mondial ? Où s’exiler lorsque c’est le même gouvernement, le même droit, la même police qui règnent sur la planète ? Pour que la liberté de l’homme, en tant qu’individu et non plus simplement en tant que citoyen, soit tout à fait garantie, il doit pouvoir fuir la persécution pour se placer sous l’aile protectrice d’une puissance étrangère ! C’est d’ailleurs là, sans doute, l’un des principaux bienfaits de la globalisation de fait que nous vivons : la facilité avec laquelle tout individu peut désormais rejoindre un ordre politique différent pour échapper à la tyrannie du sien.
Le totalitarisme contre la violence politique
Il est donc heureux que la concurrence entre les États catalyse, exacerbe leur diversité. Car tant qu’il existe une concurrence entre différentes visions du monde défendues par différents États souverains, il y a une place pour l’expression d’une opinion divergente. Or, si un État peut souhaiter garder la paix civile en combattant les séditieux, un monde où les séditieux devraient être éliminés faute de pouvoir s’exiler serait plus tyrannique que toutes les tyrannies existantes dans un monde hétérogène, la tyrannie globale se substituant à une tyrannie locale. La problématique actuelle des réfugiés politiques — radicalement distincte de celle l’immigration massive, même si la confusion perverse est parfois entretenue — prouve que la fragmentation du monde en différentes entités politiques est pour certains la garantie de la survie.

Par ailleurs, si l’État mondial abolirait de facto la guerre classique entre les États, que ferait-il du terrorisme, et de l’éventualité des conflits civils ? Car l’actualité laisse penser que la forme contemporaine privilégiée de la violence politique est incarnée par la figure du partisan, du combattant irrégulier. Or assurément, un État mondial devrait, pour préserver la paix civile, mettre en oeuvre un totalitarisme sécuritaire orwellien dont la violence n’est même pas à démontrer. C’est d’ailleurs un symbole puissant que deux des exilés les plus illustres de nos jours soient les « lanceurs d’alerte » Edward Snowden et Julian Assange. Céder une liberté, de toute façon précaire faute de pouvoir échapper à un État, une police, un ordre régnant sur le globe tout entier, pour s’assurer une sécurité aliénante : telle est l’équation d’un État mondial.
