Maître de conférences à l’Institut d’Administration des Entreprises de Metz, Baptiste Rappin a élaboré une approche phénoménologique des enjeux du management dans le monde contemporain. De l’exception permanente vient de paraître aux Éditions Ovadia et constitue le deuxième volet de sa réflexion sur le système managérial qui se situe aux confluents de la philosophie, de la géopolitique et de la théologie politique. L’occasion de revenir sur l’essence du management pour penser l’arraisonnement du monde par une organisation technicienne.
PHILITT : Pouvez-vous d’emblée nous préciser les raisons d’être d’un tel titre, « Théologie de l’Organisation » ?
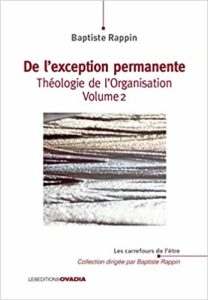
Baptiste Rappin : Aucune société ne peut vivre sans une instance supérieure qui énonce sa Vérité ultime : ce fut le rôle de Dieu, puis de l’État et enfin de la Science. Or cette dernière, dont nombre de philosophes établirent son essence technique, accoucha de l’Industrie, ou encore de la Révolution industrielle, dont le mode de production est le capitalisme (je renvoie ici au Livre I du Capital, aux analyses du courant de la Wertkritik ainsi qu’aux récents ouvrages de Jean Vioulac), et le mode de gouvernementalité des populations le management. Dans ce cadre, l’Efficacité, appelée aujourd’hui « performance » ou encore à l’américaine « efficience » (efficiency), fait foi, elle s’est imposée comme la référence ultime, comme la Grundnorm, qui sert de critère de décision et d’évaluation des actions, que ces dernières soient individuelles ou collectives.
Mais s’il convient d’analyser le management d’un point de vue théologique en raison de l’effet de structure que je viens de mettre en exergue, il est tout aussi important de le faire en raison de sa nature foncièrement messianique. S’engage ici d’une part une observation des champs lexicaux et sémantiques ainsi que des registres d’argumentation, mais surtout une enquête généalogique qui me conduit à souligner l’insigne influence de la religion chrétienne primitive sur les fondateurs de l’industrialisme (Saint-Simon) et du management scientifique (Taylor plus particulièrement). Il s’agit plus précisément d’une foi en des relations fraternelles qui court-circuite les relais institutionnels (Église, État, corps intermédiaires…) au nom de l’ajustement immédiat (en « temps réel ») à autrui.
Pour résumer, la Théologie de l’Organisation est un projet de triptyque (le troisième et dernier volet reste encore à paraître et, avant cela, à écrire) conçu selon une tripartition indoeuropéenne tout à fait classique (ontologie, politique, éthique) dont chaque pan est traversé, en profondeur, par les enjeux théologiques soulignés ci-dessus.
Si la société du management est digne de constituer un « fait social total » (Mauss), votre approche entend dépasser une habitude très marxienne en sociologie qui soustrait le réel aux seuls rapports de force économiques. À la place, sans doute inspiré d’un de vos maîtres, Jean-François Mattéi, vous défendez une phénoménologie du Management. Comment légitimer cette méthode et en quoi vous paraît-elle décisive par rapport à la réduction économiste ?
Ce que l’on peut reprocher à un certain nombre de philosophes contemporains, probablement victimes malgré eux de la spécialisation universitaire et du régime de l’abstraction moderne, c’est de ne pas être en prise avec le monde contemporain ou, dit autrement, avec la donation tout à fait singulière de l’être à l’époque de la planétarisation. L’effort de pensée me semble devoir s’orienter vers ce qui est et se donne à nous, afin de rétrocéder de l’effectivité vers sa possibilité, geste qui caractérise la philosophie elle-même. Cependant, comme le souligne à très juste titre Jean Vioulac, la phénoménologie ne peut plus se fonder sur la conception désormais périmée de l’être comme physis, comme naissance, poussée et croissance, mais doit prendre acte de l’artificialité intégrale du monde contemporain façonné de part en part par deux siècles de vagues ininterrompues d’innovations industrielles. C’est la raison pour laquelle le donné phénoménologique est aujourd’hui un construit, et un même un construit technoscientifique, c’est-à-dire un produit ; si je le formule à ma manière, la phénoménologie doit se transformer en une herméneutique des résultats scientifiques à l’origine de la transformation radicale qu’a opéré la révolution industrielle. C’est dire qu’elle doit également se faire généalogie, et reconduire les phénomènes à leur source, ce que ne daignent bien sûr pas faire les auteurs postmodernes qui dissolvent l’histoire dans des séries ou des différances.
Alors quelle est plus précisément cette phénoménologie du Management ? Je la formule de la façon suivante : le mouvement panorganisationnel désigne le double mouvement, chiasmatique, du devenir-monde de l’organisation et du devenir-organisation du monde. Partout, la planète se gorge d’organisations, à tel point que cette dernière devient pour nous un existential. L’être se donne aujourd’hui comme organisation, ainsi que le formule Martin Heidegger dans une lettre à Hannah Arendt : « […], et il m’est apparu clairement que l’ « organisation » relève du cœur inapparent, non pas certes de la technique, mais bien de ce à partir de quoi elle se déploie à l’aune de l’histoire de l’être. »[1]

D’où le questionnement suivant : qu’est-ce qu’une organisation ? L’hypothèse que je formule est que l’organisation est ce qui se substitue au cosmos lors de la révolution scientifique moderne. Le concept est fondateur de la biologie moderne en ce qu’il permet de rompre avec les anciens schèmes de l’histoire naturelle, et sera définitivement thématisé par la cybernétique au mitan du XXe siècle comme une boucle de rétroaction, modèle dans lequel viendra se greffer le management contemporain. Mais le fait le plus notable, c’est que la première extension du concept biologique d’organisation à la société fut opérée par Saint-Simon, le même qui formula le projet industrialiste. Chez lui, il faut d’emblée rapprocher l’organisation du réseau, c’est-à-dire d’un ensemble d’éléments interdépendants dont la fonctionnalité essentielle est la circulation : influx nerveux, irrigation du corps par le sang réseaux de transports, circulation de l’argent dans la société industrielle. Or, le modèle du réseau ne comporte pas de logique de domination, dans la mesure où les acteurs du système se placent sur un pied d’égalité : l’industrialisme consiste à faire advenir concrètement l’égalitarisme révolutionnaire en substituant à l’abstraction juridique le fonctionnement effectif des processus, que Marx baptisa du nom de « Sujet automate ». De ce point de vue, les dispositifs impersonnels d’évaluation, de contrôle et de feedback dament le pion aux schémas de la domination, de la hiérarchie et des rapports de force qui demeurent pourtant, force est de le constater, les réflexes vestigiaux ânonnés par la cohorte des universitaires.
Votre essai souligne bien que nous ne sommes en réalité jamais sortis de l’ère industrielle. On pourrait vous objecter en retour que la tertiarisation du monde avec ses « star up nation » gagnées à la logique du surendettement magnifient la société de consommation en relayant la société de production au niveau de ringardise. Pourtant, l’hubris propre à la société de consommation prolonge selon vous les points les plus saillants de la doctrine de Taylor. Comment comprendre ce glissement ?
Production et consommation sont les deux facettes de la société industrielle. En ce sens, on peut dire que le marketing est au client ce que le management est au salarié : un alignement du désir sur les finalités de l’organisation. Il faut ici prendre la mesure de ce qui s’est passé il y a deux siècles et que soulignent aussi bien Olivier Rey que Jean Vioulac : la révolution industrielle est tout simplement le bouleversement anthropologique le plus radical depuis la révolution néolithique. La période agraire qui s’ouvre avec cette dernière se trouve essentiellement caractérisée par le rapport à l’espace : l’agriculture (le champ), l’écriture (la trace), le marché (lieu de rencontre physique), l’État (son territoire, ses frontières), la métaphysique (ousia, la substance, désigne la propriété foncière), la philosophie (que Cicéron définit comme culture de l’âme), etc., témoignent de ce primat du sol dans l’imaginaire des civilisations néolithiques. L’industrie introduit une rupture, car, en bonne héritière de la cinétique newtonienne, elle privilégie le temps à l’espace : d’où les leitmotivs de la circulation, du flux (tendu), du réseau, du transport, de la mobilité, du nomadisme. Cela signifie donc qu’elle requiert que toutes les anciennes habitudes soient abandonnées, et qu’il devient nécessaire de reprogrammer de nouveaux comportements qui se caractérisent avant tout par l’adaptation à l’exception permanente.

Voici la raison d’être du management comme mode de gouvernementalité propre à l’époque industrielle : le dressage des subjectivités. On pourrait objecter, à juste titre, que toute société nécessite ce dressage, et c’est bien vrai. La spécificité du management, et du marketing qui s’y rattache, est de s’inscrire dans une anthropologie comportementaliste qui ne laisse subsister de l’homme que sa superficialité observable et mesurable. Ces approches, que l’on trouve dans les disciplines du « comportement organisationnel » ou du « comportement consommateur », n’aspirent qu’à l’efficacité (l’implication d’un côté, l’achat de l’autre), en dehors de toute considération pour les processus réels de subjectivisation. C’est à mon sens, et Bernard Stiegler le montre aussi bien que Pierre Legendre, une production massive de zombies, de zombies-producteurs et de zombies-consommateurs.
De ce point de vue, si les modalités techniques ont évolué, si les référentiels épistémologiques ont changé, si la cybernétique a définitivement lancé l’humanité dans le grand bain de l’information et de la connaissance, le projet industrialiste demeure, tel qu’il fut formulé par Saint-Simon. Il s’agissait déjà pour ce dernier de donner la clef du pays aux scientifiques et aux industriels, à ceux que nous appelons aujourd’hui les « experts », et de faire de la France « un grand atelier », ce que notre Président actuel remet au goût du jour et actualise en parlant de la « start up nation ».
Pour penser la modernité, il est convenu depuis Max Weber de mettre en avant un processus de rationalisation du travail. Votre thèse revient sur cet a priori en s’arrêtant sur la logique des affects. Pourquoi, selon vous, la coopération dans l’entreprise a-t-elle une importance capitale dans le mouvement de la sécularisation ?
Tout d’abord, Max Weber a parfaitement raison de voir dans l’avènement de la modernité un processus de « désenchantement du monde ». Nous ne nous arrêterons pas tant que nous n’aurons pas rendu raison de tout l’univers, tant que le réel n’aura pas rendu gorge : c’est le principe de raison, formulé par Leibniz et magistralement analysé par Heidegger dans le livre éponyme. Günther Anders formulait cette métaphysique de la révolution industrielle d’une autre manière, en soulignant que tout dans le monde, y compris l’homme, a vocation à devenir utile et exploitable. Mais la mise sous raison de l’homme exige sa domestication et le redressement de ses désirs, ainsi que nous l’avons vu précédemment.
Il convient encore d’affiner cela. Elton Mayo est connu comme le fondateur de la psychologie industrielle et le père du courant des relations humaines. Son équipe a montré, lors des célèbres expériences menées dans l’usine de la Western Electric Company située à Hawthorne, que l’esprit de groupe, c’est-à-dire l’identification des individus à une norme commune, permettait d’accroître le rendement. Voici ce que l’on retient dans les manuels de management, sans prendre la peine de lire Mayo dans le texte. Car voici son raisonnement. Lisant les anthropologues, et notamment Boas, le chercheur réalise que les sociétés primitives tiennent ensemble car ses membres partagent un ensemble de références communes. Or, cette solidarité et cet ajustement quasi-automatique, car il procède de l’ordre symbolique, volent en éclat avec l’individualisme. Voilà qui est fâcheux : si chaque individu ne pense qu’à lui, cela nuit à la coopération indispensable au travail collectif qui est devenu la norme à l’époque industrielle, et cela conduit en sus à la guerre. Comment faire ? Recréer, par l’intervention du scientifique, la cohésion perdue. On peut alors définir le management comme un ensemble de procédés de facture ingénierique visant à fabriquer artificiellement la coopération. Le paroxysme, souvent comique, est atteint avec la « culture d’entreprise », dont le nom, cela n’aura pas échappé à notre lecteur, est directement issu de l’anthropologie. Cette dernière, une fois rentrée dans le giron du management, change alors de nature : jadis science descriptive basée sur l’observation, elle devient science expérimentale et prescriptive orientée vers l’action et la transformation des mondes sociaux et organisationnels. Elle a plus précisément pour vocation de former les humains à intégrer ce que Taylor nommait le « principe d’exception », c’est-à-dire à s’adapter à l’événement qui vient ; cela nécessite de se débarrasser de toutes les aspérités et de tous les freins statiques, en premier lieu l’identité, qu’elle soit individuelle ou collective.
Enfin, j’ai cité à plusieurs reprises le terme de « coopération ». Je crois qu’il s’agit du concept qui peut définir en propre le projet politique de l’industrialisme, et ce n’est pas un hasard si on le trouve chez Saint-Simon, chez Taylor, chez Mayo et bien d’autres. Plus étonnant : la source d’inspiration de Saint-Simon et de Taylor est la même. Elle est théologique et n’est autre que la religion de l’Amitié, celle des Quakers dont le fondateur de la Pennsylvanie, William Penn, est l’une des figures les plus marquantes. Pour le dire vite, les Quakers considèrent que l’Étincelle divine peut se recevoir directement du Saint-Esprit et qu’elle peut se transmettre de fidèle en fidèle : c’est une théologie de l’immédiation fraternelle que Saint-Simon et Taylor voudront reproduire dans l’industrie et le travail de façon plus générale. Tel est le mouvement de sécularisation qui caractérise le management.

De ce point de vue, la société de la coopération, celle du « vivre-ensemble », serait digne d’une utopie en voie de réalisation en lien direct avec le transhumanisme ?
On peut en effet dire du management qu’il est une utopie en envisageant les deux arguments suivants : d’une part, il est sans site, sans topos, car il est plus porté par une dynamique temporelle, celle de la synchronisation générale des activités humaines, que désireux de s’enraciner dans un lieu singulier ; d’autre part, il résulte de ce mouvement de sécularisation que nous évoquâmes quelques lignes plus haut.
Quel type d’homme est appelé à vivre dans cette utopie ? Saint-Simon l’affirmait déjà, ce qui caractérise l’homme en propre, ce sont ses « capacités », qu’il définit comme l’aptitude à s’insérer dans la logique réticulaire. En d’autres termes, seule la part fonctionnelle et utile de l’homme a sa place dans l’empire industriel, raisonnement que l’on voit réactualisé par la gestion des ressources humaines dans les années 1980 sous le terme de « compétence » et qui a en outre envahi, avec l’aide des sciences cognitives et des sciences de l’éducation, le Ministère de l’Éducation. Mais si ce qui qualifie l’homme est la fonction, alors la porte se trouve ouverte à tous les types d’augmentation : cela commence par la « formation tout au long de la vie », se poursuit par l’installation (« l’implémentation » dans le langage barbare du management) de systèmes d’information et se conclut par la fusion de l’homme et de la technologie dans le cyborg.
Un personnage me paraît tout à fait essentiel pour bien comprendre la logique transhumaniste : Herbert Simon est le père fondateur du comportement administratif qui devint par la suite le comportement organisationnel, il fut également récompensé du Prix de la Banque de Suède (faussement appelé Prix Nobel d’Économie) pour ses travaux sur la rationalité limitée, et figure parmi les fondateurs, dans les années 1950, de l’intelligence artificielle. Comment alors rendre compte de l’unité de sa pensée en embrassant ces trois dimensions du comportement administratif, de la rationalité limitée et de l’intelligence artificielle ? Il s’agit d’une conception cognitivo-comportementale de l’être humain, dont les soubassements sont informationnels, et qui ouvre la voie à la création de techniques de manipulation et de domestication de l’homme. Rationalité limitée : cela signifie que nos capacités cognitives ne nous permettent pas de récolter toute l’information présente dans l’environnement (on parle d’ « information imparfaite » ou d’ « information asymétrique ») et que, quand bien même nous y parviendrions, nous ne serions pas en mesure de la traiter pour rendre une décision optimale. On comprend que Simon s’oppose ici aux économistes néoclassiques qui font le postulat d’une information parfaite et d’une rationalité absolue. Mais l’on saisit également que l’intelligence artificielle a précisément pour rôle de venir combler cette lacune cognitive, d’une part en installant des capteurs artificiels qui pallient les limites de nos sens, d’autre part en créant des algorithmes capables de traiter l’information récoltée de telle façon qu’un cerveau humain ne pourrait le faire. Mais qu’en est-il du comportement organisationnel ? Eh bien, le raisonnement demeure strictement identique : alors que l’intelligence artificielle joue le rôle d’une prothèse extérieure, quand bien même elle se glisserait aujourd’hui sous notre peau, le comportement organisationnel, quant à lui, étudie les différentes formes de prothèse interne : à savoir l’intériorisation des buts organisationnels par l’individu. En effet, une plus grande efficacité de décision est atteinte, eu égard à la performance de l’organisation, quand le salarié a internalisé les buts et les normes de cette même organisation. Ce phénomène, Herbert Simon le nomme « docilité » qu’il définit très précisément comme « la tendance à se conduire d’une façon qui est approuvée socialement et à réfréner les conduites qui vont dans un sens qui est désapprouvé ». La docilité se nomme aujourd’hui, dans les articles et les ouvrages de comportement organisationnel, « implication organisationnelle », « engagement organisationnel », « citoyenneté organisationnelle », « attachement organisationnel », etc., et dans la bouche des gourous, des consultants et des managers : savoir-être, agilité, mobilisation. En conclusion, le management est déjà un transhumanisme cognitif à l’œuvre dans notre quotidien.
Notes
[1] Arendt H. et Heidegger M., Lettres et autres documents, 1925-1975, traduit de l’allemand par Pascal David, Paris, Éditions Gallimard, « nrf », « Bibliothèque de Philosophie », 2001, p. 83 (lettre adressée par Martin Heidegger à Hannah Arendt le 15 février 1950).
