Gallimard a récemment publié un roman de jeunesse de Louis Guilloux (1899-1980), écrit en 1923 et resté jusqu’alors inédit – sans doute à raison. Pourtant, s’il ne tient pas la comparaison avec Le Sang noir (1935), dont il est une sorte de brouillon, L’Indésirable propose quelques aperçus amusants sur la vie de province, ainsi que sur le monde enseignant.
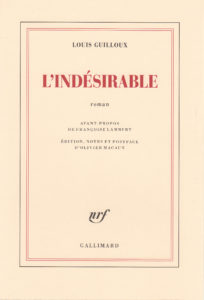
La scène se passe dans une petite ville de province française, c’est-à-dire nulle part. 1917 : tandis que les combats font rage à l’Est, à Belzec, en Bretagne, ceux de l’arrière s’efforcent de prouver tant qu’ils le peuvent qu’ils participent eux aussi à l’effort de guerre. Un brave homme, Lanzer, parce qu’il est professeur d’allemand, occupe un petit poste d’interprète dans le camp de prisonniers voisins. À cause d’un geste de compassion, désintéressé et noble, à l’égard d’une réfugiée alsacienne, il va s’attirer la cabale de toute la ville, habilement orchestrée par celui qu’il croyait son ami, M. Badoiseau, ce dernier y voyant une occasion de se faire valoir, afin d’avancer dans la carrière (les deux hommes enseignent dans le même lycée). Progressivement, tous vont tourner le dos à Lanzer et à sa famille. Même les quelques âmes courageuses de la ville ne pourront empêcher cette mise à l’écart motivée par le ressentiment, quoique maquillée par ces grands mots qui rassemblent les foules, toujours heureuses de communier au sein des mêmes valeurs (c’était alors le patriotisme et les bonnes mœurs bourgeoises ; ce serait aujourd’hui, au choix, l’amour de l’Autre, du Climat, des droits des femmes, de telle ou telle variante sexuelle, et de tant d’autres merveilles).
L’Indésirable est un livre de jeune homme (Guilloux n’a que 24 ans quand il l’écrit), et la satire peut sembler un peu lourde, méchante même pour qui connaît un peu le monde enseignant et peine à y reconnaître une telle accumulation de lâchetés, de bassesses et de mesquinerie. Pourtant, l’auteur met déjà le doigt sur un certain nombre de vérités toujours bonnes à dire – bonnes à dire, parce qu’éminemment désagréables. Il s’agit en effet d’un livre sur la Grande Guerre, mais perçue de loin. Un des personnages, Jean-Paul, revient du front, ressentant éminemment cette difficulté à dire ce qu’il a vécu, comme frappé par l’incapacité dont parlera Walter Benjamin quelques années plus tard dans Le Conteur (1936) : la perte entraînée par la violence des combats de « la faculté d’échanger des expériences ». Cependant, comme en écho à cette guerre indicible, la haine dont la petite ville de Belzec va se trouver agitée donne lieu à une montée progressive de la violence : violence sourde, masquée, calomnieuse, qui va cheminer comme « un cri général, un crescendo public, un chorus universel de haine et de proscription », pour parler comme Don Bazile dans Le Barbier de Séville…

Guilloux a en effet des pages étonnantes pour parler de cette autre bataille, véritable guerre des tranchées poursuivie par d’autres moyens. C’est une guerre « sourde », une « guerre de taupes » : « Les ennemis se rencontrent cent fois par jour, au coin des rues, et chaque fois qu’ils se rencontrent, ils échangent un salut. Ils observent d’autant mieux cette correction, qu’ils appartiennent au même corps, et ont à cœur de n’en point compromettre le bon renom. » La haine du boche (à plus de mille kilomètres du front !) est l’excellent porte-voix d’un ressentiment qui peut enfin s’exprimer au grand jour, parce qu’il s’exprime au nom du Bien. Et cette haine, nous dit Guilloux, donne magiquement vie à toute la ville assoupie, qui s’étire et grogne comme une bête qui redécouvre le goût de vivre, dans le plaisir et la rage de nuire.
Tout cela finira mal, bien sûr. Comme le disait un autre écrivain de sa génération, Georges Bernanos, la bêtise n’est jamais inoffensive, car les imbéciles « aimeront mieux tuer que penser » (Les grands cimetières sous la lune). Dans L’Indésirable, ils ne tuent pas directement, pas véritablement. Ils ne tuent que socialement. Pourquoi en faire plus en effet puisque, à Belzec du moins, cela suffit amplement à triompher ? Ce n’en est pas moins la mort de celui qui s’écarte du troupeau qu’ils visent.
« Tout ce qu’il faut pour que le mal triomphe, écrivait Burke, c’est que les braves gens ne fassent rien. » Dans ce court roman, vaille que vaille, certains essaient de faire quelque chose. Ou, du moins, sauvent l’honneur en refusant de participer à l’hallali. Guilloux a, pour ces quelques personnages rapidement esquissés (bien plus discrets que son Badoiseau, l’ignoble et cauteleux professeur de lettres d’où viendra tout le mal), une remarque dont on peut encore aujourd’hui percevoir la justesse : « On rencontre en province peu d’hommes libres, mais si l’on en rencontre, on voit qu’ils le sont tout à fait. »
Dans un roman aussi sombre et amer, voilà déjà un motif d’espoir légitime.
