De temps en temps, des parents défraient la chronique en refusant de soigner leur enfant parce que sa maladie viendrait de Dieu et parce que lutter contre elle serait un blasphème. En plus de se rendre coupables d’un comportement indigne et profondément contre-nature, ces fanatiques ignorent, ou rejettent, l’enseignement traditionnel des Pères à ce sujet. Ces derniers donnent en effet un sens spirituel profond à la maladie, tout en justifiant pleinement l’usage contre elle de la médecine. Dans son livre Théologie de la maladie, Jean-Claude Larchet propose ainsi une synthèse de cet enseignement des Pères sur la maladie.
« Tout homme bien portant est un malade qui s’ignore », fait dire Jules Romains au docteur Knock. Ironiquement, c’est loin d’être faux, car comme le rappelle le professeur Marcel Sendrail : « La maladie forme la trame de notre continuité charnelle. Même sous le masque de la santé, les phénomènes biologiques outrepassent à tout instant les frontières du normal. C’est, pour les médecins, un fait d’observation courante que des manifestations de caractère morbide se combinent aux actes vitaux les plus élémentaires. » Il rajoute : « Chacune de nos cellules ne se maintient qu’au prix d’une lutte permanente contre les forces qui tendent à les détruire. » La santé n’est donc que le fruit d’un équilibre précaire, qui peut à tout moment être renversé. Il n’y a donc à ce titre rien d’étonnant à ce que la maladie, ainsi que la souffrance physique et psychique qui l’accompagne, soit une expérience que chacun doit affronter dans sa vie. Expérience ainsi universelle, la maladie demeure, malgré les indéniables progrès de la médecine, une interpellation bouleversant toujours à des degrés divers nos vies bien réglées, nous rappelant la précarité de nos humaines existences, et finalement notre propre mortalité. La maladie constitue à ce titre une véritable épreuve que chacun doit tâcher de surmonter.
Donner du sens à la maladie afin d’enseigner au malade comment surmonter l’épreuve que celle-ci constitue est justement précisément l’objet de l’enseignement des Pères. Ces derniers n’ont pas d’opinion spécifique en matière de science médicale. S’ils se réfèrent souvent à la médecine galénique, c’est simplement parce que celle-ci est le cadre de référence de leur temps, rien de plus. Comme le rappelle saint Grégoire Palamas (dans ses Triades pour la défense des saints hésychastes), la Tradition bien comprise n’a aucune opinion ou préférence en matière de médecine et de physiologie. La Tradition enseigne en revanche ce que signifie la maladie sur le plan spirituel. Ainsi, les Pères vont intégrer la maladie à leur conception du combat spirituel, tout en rappelant toujours la nécessité de la combattre également sur le plan corporel.
L’origine métaphysique de la maladie

Dans son homélie Dieu n’est pas la cause des maux, saint Basile de Césarée (330-379) écrit : « Dieu, qui a fait le corps, n’a pas fait la maladie, de même qu’il a fait l’âme mais n’a point fait le péché. » Un millénaire plus tard, saint Grégoire Palamas (1296-1359) écrit dans son homélie XXXI : « Dieu n’a pas créé la mort, ni les maladies, ni les infirmités. » Cet accord à un millénaire de distance témoigne d’une conviction profonde des Pères : Dieu n’est ni l’origine ni la cause des maladies. La maladie n’est donc pas née de la volonté divine, mais est issue d’un dérèglement de la création : le péché ancestral.
En effet, c’est parce qu’Adam a fait le choix d’user de son libre-arbitre pour désobéir au commandement divin que la maladie est entrée dans le monde. On trouve ce diagnostic chez saint Irénée de Lyon (~130-202) dans son fameux ouvrage Contre les hérésies : « [c’est] à cause du péché de désobéissance que les maladies assaillent les hommes. » Treize siècles plus tard, on retrouve exactement le même diagnostic sous la plume de saint Nil de la Sora (1433-1508) qui affirme dans sa Règle : « Après la transgression du commandement, Adam fut soumis à la maladie. ».
La lutte contre la maladie
On le voit, les Pères de toutes les époques affirment donc que Dieu n’est pas à l’origine des maladies, que celles-ci ne sont pas issues de la création bonne de Dieu. C’est par le péché du père ancestral que sont entrées dans le monde la corruptibilité et la mortalité des corps à partir desquelles se développent les maladies. Ces dernières ne sont pas non plus des punitions envoyées à l’humanité par un sordide Dieu vengeur. Aux yeux des Pères, c’est bien, d’un point de vue métaphysique, le diable qui est la cause des maladies, utilisant ainsi, pour le malheur des hommes et des animaux, la corruption et la mort introduites dans le cosmos par le péché d’Adam.

Cette compréhension proprement métaphysique de la maladie ne s’oppose pas chez les Pères à une compréhension physique de celle-ci, fondée sur la science de leur temps. Elle n’empêche nullement non plus les Pères d’intégrer à leurs conceptions la médecine profane. En effet, si les maladies viennent du diable, alors lutter contre elles médicalement devient un véritable devoir spirituel. La médecine est ainsi comprise comme un moyen privilégié d’apaiser les souffrances des hommes, et d’exercer la charité. De nombreux Pères furent d’ailleurs eux-mêmes médecins, et de nombreux autres ont été de véritables pionniers dans le développement des institutions médicales. Saint Basile, par exemple, fit édifier dans un faubourg de Césarée en 370 un véritable hôpital, capable de recevoir et de traiter les malades gratuitement, et doté d’un personnel formé aux sciences médicales et rémunéré par l’Église.
La maladie comme épreuve spirituelle
La maladie est donc intrinsèquement un mal. Comme le souligne Jean-Claude Larchet, « elle apparaît comme une conséquence du péché d’Adam et comme un effet de l’action démoniaque dans le monde déchu, une négation de l’ordre voulu par Dieu lorsqu’Il créa le monde et l’homme ». Mais même d’un mal, Dieu peut sortir un bien (Gn 50.20). Même la maladie peut ainsi servir à l’élévation spirituelle de l’homme. Saint Grégoire de Nazianze (329-390) conseille ainsi à un malade dans sa lettre XXXI : « Je ne veux pas et je ne considère pas bien que toi, excellemment instruit des choses divines, tu éprouves les mêmes sentiments que le vulgaire, que tu fléchisses avec ton corps, que tu gémisses de ta souffrance comme d’une chose irrémédiable ; il faut au contraire que tu fasses la philosophie de ta souffrance, […] que tu te révèles supérieur à tes chaînes, et que tu voies dans la maladie un cheminement supérieur vers ton bien. » Que signifie faire la philosophie de sa souffrance ? D’abord comprendre que le fait même de la maladie est le fruit du péché ancestral et de l’action des démons. Elle est à ce titre un symptôme de la séparation entre Dieu et le monde qu’a engendrée la faute d’Adam. Elle est donc un rappel bienvenu de notre condition déchue, et dévoile à la fois notre besoin de Dieu et le caractère dérisoire de tous nos fantasmes d’autosuffisance et de toute-puissance. Dostoïevski, qui n’est certes pas un Père mais qui a toujours souligné avec force comment la souffrance pouvait aiguiser la conscience, écrit ainsi dans Crime et châtiment : « Un homme sain est toujours un homme terrestre, matériel […]. Mais à peine vient-il à être malade, et l’ordre normal, terrestre, de son organisme à se détraquer, que la possibilité d’un autre monde se manifeste à lui aussitôt et, à mesure que s’aggrave la maladie, les rapports avec ce monde deviennent plus étroits. »
« Faire la philosophie de sa souffrance »
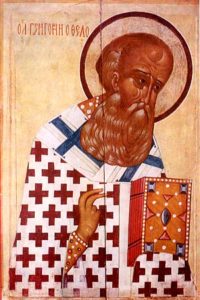
Pour le malade, faire la philosophie de sa souffrance revient donc à discerner en elle, au-delà de ses tourments physiques et psychiques, une véritable épreuve spirituelle qui peut lui permettre de se rapprocher de Dieu. Le malade peut ainsi progresser spirituellement en ne cédant pas aux péchés que peut engendrer la condition pathologique (colère, haine, jalousie, désespoir, obsessions variées…), à l’imitation du Christ qui, lui aussi durant sa Passion, a dû et a su affronter et vaincre les tourments de la chair. Les Chapitres métaphrasés par Syméon rapporte à ce sujet ces propos de saint Macaire d’Égypte (~300-~391) : « À celui qui veut imiter le Christ afin d’être appelé lui aussi Fils de Dieu, né de l’Esprit, il convient avant tout de supporter courageusement et patiemment les afflictions qui peuvent se rencontrer, [notamment] les maladies du corps. »
La maladie est ainsi finalement pour le chrétien une occasion de fortifier sa foi, de progresser sur le plan spirituel. Comme l’écrit saint Cyprien de Carthage (~200-258) dans son texte Sur la mort : « Ce qui nous rend différents de ceux qui ne connaissent pas Dieu, c’est que ces derniers se plaignent et maugréent de l’infortune, alors que pour nous le malheur, loin de nous détourner du vrai courage et de la véritable foi, nous fortifie à travers la douleur. Ainsi, que nous soyons épuisés par un déchirement de nos entrailles, qu’un feu très violent nous consume intérieurement jusqu’à la gorge, que nos forces soient constamment ébranlées par des vomissements ou que nos yeux soient injectés de sang, que nous soyons enfin contaminés par la gangrène et contraints d’amputer notre corps de l’un de ses membres, ou qu’une infirmité quelconque nous prive soudain de l’usage de nos jambes, de notre vue ou de notre ouïe : tous ces maux sont autant d’occasions d’approfondir notre foi. »
En définitive, Les Pères comprennent fondamentalement la maladie dans la perspective du combat contre le diable. L’expérience dramatique qu’elle constitue dans la vie d’une personne peut être une occasion de chute, mais elle peut aussi être une occasion d’élévation. Cette nécessité de lutter contre les mauvais effets de la maladie d’un point de vue spirituel s’accompagne de celle de lutter contre leurs mauvais effets d’un point de vue corporel. L’être humain n’est en effet ni un corps sans esprit, ni un esprit sans corps. Il est un esprit et un corps, une unité à la fois spirituelle et corporelle. Le combat contre la maladie a donc lui aussi lieu à la fois sur le plan spirituel et sur le plan corporel.
