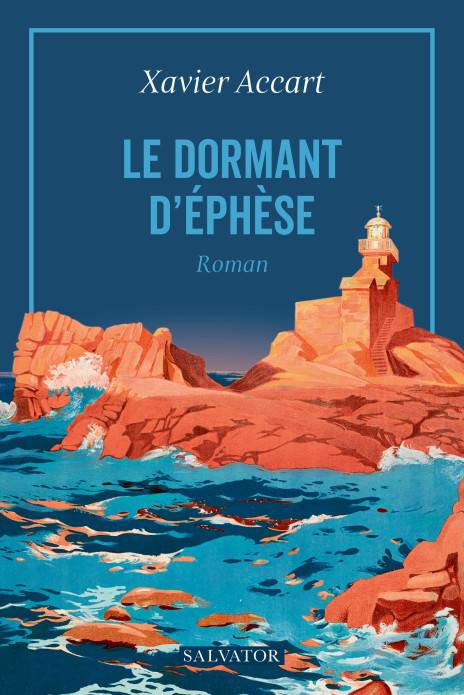Xavier Accart est historien et rédacteur en chef du magazine Prier. Après la publication de son roman Le Dormant d’Éphèse (éd. Tallandier) en 2019, l’auteur en fait paraître une version nouvelle aux éditions Salvator. Ce grand récit met en scène les itinéraires parallèles et les quêtes spirituelles d’un père et d’un fils qui ne se connaissent pas. Renaud, jeune breton engagé contre les expulsions des congrégations en 1902-1903, abandonne sa fiancée enceinte pour échapper à la justice et s’exile à Alexandrie, laissant son fils Malques grandir sans lui dans le Paris surréaliste des années 1920.
PHILITT : La première chose qui frappe, c’est que le récit est foisonnant de détails et de réalisme, très ancré dans le réel et documenté, à la Huysmans. Il y a aussi un côté Abbé Donissian pour le parcours de Renaud. Est-ce que Huysmans et Bernanos ont été une source d’inspiration ?
Xavier Accart : Huysmans pas du tout ! Mais Bernanos oui. C’est latent, ce n’est pas voulu et pensé. Ce que je retiens de Bernanos, c’est l’importance de la communion des saints. Il a cette fameuse phrase à la fin du Dialogue des carmélites : « On ne meurt pas chacun pour soi mais les uns pour les autres. » C’est cette idée qu’on ne fait pas son salut individuellement et seulement pour soi, au contraire : quand l’un s’enfonce il entraîne tout le monde dans sa chute, mais quand il s’élève, il tire les autres vers le haut. On ne peut avancer que dans cette solidarité mystique. Et c’est une des clés du roman.
Est-ce que la volonté d’ancrer le récit dans le réel par ce foisonnement de détails historiques s’inscrit dans la démarche de la quête de vérité des personnages et de quête de sens, en général ?
Pourquoi, alors qu’il y a cette liberté du romancier, inscrire ce récit dans un contexte historique aussi précis, avec des personnages secondaires si documentés ? Il y a trois niveaux de réponses à votre question. D’abord, ce livre qui se déroule de 1903 à 1975 est un pont jeté entre l’ancien monde et le nôtre. Les deux guerres mondiales nous ont fait basculer dans une société totalement autre, des amarres ont été rompues. Ce roman est une façon de rétablir une communication, d’arrimer notre temps à cette époque pleine de sève. Cela est aussi un écho à mon expérience : j’avais une arrière-grand-mère, que j’aimais beaucoup. Née à la fin du XIXe siècle, elle a vécu presque centenaire. Elle m’a dit une fois : « Xavier, j’ai connu trois guerres ! » Je ne comprenais pas quelle pouvait être la première. Elle ne pouvait avoir connu le conflit de 1870… Il s’agissait en fait de la période des expulsions conduites par le gouvernement d’Émile Combes en 1902-1903. Près d’Alençon où elle vivait, les hommes passaient la nuit avec un fusil devant les calvaires pour que les anticléricaux ne les mettent pas à bas.
La deuxième raison est le rapport qui me semble exister entre la génération des hommes nés autour de 1905 et la génération des enfants de soixante-huitards. Malques appartient à cette première classe d’âge que les historiens appellent la « génération orpheline », car elle est arrivée à maturité intellectuelle à la toute fin de la première guerre mondiale et a donc grandi en l’absence des pères qui étaient au front et avec la menace de partir à leur tour vers une mort probable. En entrant sur la scène intellectuelle en 1920, ces jeunes gens ont eu une sorte de rejet profond du monde de leurs pères, ce monde positiviste, scientiste, bourgeois, qui avait conduit à un charnier de 20 millions de morts. En même temps, ils ne se sont pas contentés de tout dissoudre comme les dadaïstes, ils ont eu le désir de retrouver un ordre. Pour certains ce fut le bolchevisme, pour d’autres ce fut la Tradition. Certains se sont tournées vers l’Inde, d’autres vers le monde, non de leurs pères, mais de leurs aïeux, le Moyen Âge notamment. Ma génération (qui n’est pas tout à fait la vôtre), celle des enfants de soixante-huitards, a aussi, pour des raisons différentes, connu un déficit de transmission et de paternité – deux notions très liées qui sont au cœur du Dormant d’Éphèse.
La troisième raison est probablement liée à la spécificité de la spiritualité chrétienne qui imprègne le livre. De par le mystère de l’Incarnation, elle a un sens intense de l’histoire, avec l’idée que Dieu nous parle à travers elle, que le temps est qualifié et qu’il faut être attentifs aux signes des temps. Quelque chose se révèle dans l’histoire et quelque chose se dégrade en même temps. C’était donc important d’ancrer historiquement ce roman, même si réaliser cette alchimie entre le récit que je portais et les événements réels a demandé beaucoup de travail. Il a fallu une longue maturation pour que les choses se mettent en place… et pour que cela ne soit pas forcé, mais paraisse couler de source.
Vous dites que les guerres ont fait basculer notre société, rompant les amarres, et pourtant il est beaucoup question de guerre dans votre roman. Celle-ci semble avoir une nature ambivalente : tantôt elle détruit le monde et l’abaisse, tantôt elle révèle la grandeur des hommes.
Je fais partie d’une des premières générations en France qui n’a pas connu de guerre sur son territoire. L’officier avait jusque-là dans la société française un rôle important (et son absence dans la vie publique, je crois, nous manque aujourd’hui), il faisait partie d’un corps qui conserve et transmet un certain nombre de valeurs et de traditions (mon grand-père maternel, qui était officier de cavalerie, avait fait une conférence sur ce thème à Coëtquidan où mes parents se sont mariés). Dans ma famille maternelle, on parlait toujours des « civils » pour les distinguer des militaires, un peu comme on distingue les « laïcs » des « clercs ». Aussi, cette première longue période sans guerre – dont il faut se réjouir – a certainement eu des conséquences sociales et psychiques.
D’un côté, la guerre est évidemment la pire des choses, surtout la guerre moderne comme l’illustre la longue évocation de la bataille de Bir-Hakeim dans Le Dormant d’Ephèse. On vit durant plusieurs chapitres parmi ce petit reste de Français qui fait face à l’Afrika korps de Rommel, massé pour réduire ce camp retranché. Il y a un moment où Malques, à la faveur d’une accalmie, traverse la position pour aller à l’enterrement d’un ami. Devant le spectacle de désolation produit par le déluge continu de feu et de métal, il prend conscience que l’homme est en train de devenir obsolète face à la puissance technique. En même temps, la Seconde Guerre mondiale suscita un des derniers grands mythes français : celui de la France libre que cette résistance héroïque aux troupes de Rommel illustre… Dans des circonstances dramatiques, les hommes révèlent ce qu’ils portent en eux-mêmes, pour le meilleur et pour le pire. La guerre est ainsi également une épreuve de vérification et de révélation de la qualité des hommes, de leur grandeur d’âme.
Mais plus encore que la guerre elle-même, est abordé dans Le Dormant d’Éphèse la question de la résistance, et en particulier de la résistance spirituelle…
Oui. Une question, qui, à la différence de la guerre, nous concerne de plus en plus. C’est elle qui motive le combat contre les expulsions des congrégations, au début du livre. Il faut voir que ces menées parfaitement légales ont privé la France de ses communautés contemplatives pendant des décennies. En 1903, notamment, les chartreux sont expulsés, ce qui vaut au grand-père maternel de Malques d’être renvoyé de l’armée quand il refuse de participer à cette triste opération. Sachant le rôle essentiel de prière et d’intercession pour le monde de ces contemplatifs, on mesure le drame invisible que ce fut pour notre pays.
La bataille de Bir Hakeim est aussi une résistance au nazisme, qui est perçu par Malques comme l’anti-tradition par excellence, quelque chose de profondément anti-spirituel. À un moment, il assiste d’ailleurs dans le camp à un Kaddich Yatom – l’office des morts judaïque – et il y a ici et là des références discrètes au livre des Maccabées. Un éminent ami à qui j’avais fait lire mon manuscrit m’a dit que cette scène était superbe mais pas crédible. C’est pourtant l’exacte vérité historique, très documentée ! François Broche, qui vient de faire paraître La cathédrale des sables (entièrement consacré à Bir-Hakeim), m’a dit, après avoir relu mes chapitres sur cette bataille, que j’avais bien perçu un moment clé de cet affrontement qui était aussi spirituel. Cette bataille est vécue par le protagoniste comme le combat d’une France mystique, avec un côté Péguyste.
L’autre thème qui structure le récit et que vous avez évoqué concerne le père, ou plutôt son absence. Si elle engendre un déséquilibre, elle provoque une substitution par un père spirituel. On a l’impression d’une dialectique autour de l’absence du père.
La question de la paternité est au cœur du livre, une question brûlante depuis plusieurs décennies et surtout à l’heure où l’on a légalisé le fait de concevoir par les techniques biomédicales des enfants sans père. Ce que je trouve formidable dans un roman, c’est qu’on peut aborder un thème à plusieurs niveaux. Dans Le Dormant d’Éphèse, il y a d’abord la paternité humaine déficiente de Renaud dont l’absence met en mouvement Malques. C’est une sorte d’appel d’air. Il y a ensuite la paternité spirituelle, avec les figures de dom Baz et du Patriarche à Alexandrie – les lieux monastiques ont dans ce cadre une grande importance. C’est enfin la paternité divine, la source de toute paternité, le mystère peut-être le plus profond de tout le christianisme. C’est un grand spirituel copte (lui-même ermite dans le désert égyptien), Matta el-Maskîne, qui souligne que tout ne s’arrête pas pour le chrétien à la résurrection mais culmine dans l’adoption par le Père céleste. Malques, au terme de son itinéraire, va connaître cette neuvième béatitude : « Heureux toi qui est pauvre en paternité parce que tu vas découvrir la paternité divine de façon encore plus intense. »
Parmi les personnages qui interviennent et qui semblent redonner la vie à Malques, incarnant la transmission, il y a la figure, discrète, de René Guénon. On a l’impression aussi que Guénon, qui n’apparaît que peu dans le récit, parcourt en filigrane l’histoire et en particulier l’ermite éthiopien.
Guénon apparaît dans le livre à deux reprises de façon différente. En fait, ce qui m’intéressait c’était, à travers le roman, non de me prononcer sur la vérité de son œuvre mais d’étudier son impact existentiel ; Malques qui rencontre cet écrivain vieille France dans le Paris littéraire des années 1920 va être pris par un guénonisme assez cérébral qui le mène à une catastrophe existentielle. Mais ce sont des réflexions de Guénon sur la signification profonde du Sacré-Cœur qui le pousse un matin, après une nuit bien arrosée, à entrer dans la basilique de Montmartre, ce qui sera le début d’un cheminement spirituel. Ensuite, il y a Renaud qui conduit Guénon arrivant en Égypte au monastère Sainte-Catherine dans le désert du Sinaï, puis le revoyant après le remariage de ce jeune veuf au Caire où il va vivre à la mode islamique. Leur dialogue amicale permet à Renaud d’approfondir par contraste la spécificité de sa foi : la mort de Jésus en croix et la nécessité pour le chrétien de passer par ce chemin. En ce qui concerne la figure de l’ermite que vous évoquez, j’ai toujours été fasciné, sans jamais y être allé et sans vraiment connaître cette tradition, par l’Éthiopie. Il est vrai que, dans la correspondance de Guénon, il est question d’une initiation chrétienne qui se conserve dans quelques monastères éthiopiens, je ne sais si cela m’a influencé. Il y a aussi le fait que l’Église éthiopienne dépendait du patriarcat d’Alexandrie. D’ailleurs, un des maîtres dans la vie érémitique du Père Matta el-Maskîne, dont je parlais plus haut, a été un ermite éthiopien : Abd el-Massih al-Habash.
Vous qui avez écrit une thèse sur Guénon et son influence, sentez-vous que la transmission de son œuvre s’opère de nos jours ? On a vu Houellebecq le citer… On le sent présent aujourd’hui en filigrane (même s’il apparaît peu) de la même manière qu’il est présent de manière implicite dans le roman. Mais on n’a pas non plus l’impression d’un jaillissement de son œuvre aujourd’hui.
Votre remarque est juste. L’influence de Guénon s’est surtout exercée jusqu’aux années 1970. Maintenant elle se répercute sans fin de façon indirecte, comme les ondes d’un caillou qu’on a jeté dans les eaux d’un lac. Il est donc très difficile d’en mesurer l’impact qui est cependant énorme, notamment dans le champ de la connaissance des spiritualités extra-chrétiennes et de l’anthropologie religieuse en général. La plupart des traducteurs du bouddhisme tibétain en France ont utilisé une terminologie guénonienne pour traduire les notions de la métaphysique tibétaine. Pour le Yoga, Tara Michaël, chercheur au CNRS dans ce domaine, dit qu’il y a un avant et un après Guénon comme il y a un avant et un après la Révolution française. Même Michel Hulin, spécialiste du Védânta à la Sorbonne, en parle de façon positive. Pour le soufisme, beaucoup des spécialistes français sont des guénoniens assumés. Certainement sa critique du monde moderne a marqué et s’est conjugué avec d’autres œuvres. J’entendais Marc Fumaroli dire toute son admiration pour Le Règne de la quantité et les signes des temps sur France Culture, un livre qui reste prophétique à bien des égards et auquel on trouve quelques allusions dans Le Dormant d’Éphèse.
Parallèlement à cela, les mentions plus explicites à son œuvre restent souvent très superficielles. Houellebecq l’a cité dans plusieurs de ses romans, mais ne semble pas l’avoir vraiment lu. Dans Soumission, son personnage a fait une thèse sur l’influence de Nietzsche chez Guénon, ce qui est totalement absurde ! Guénon parle une fois de la notion d’éternel retour chez le philosophe allemand, mais de façon sommaire. Je ne suis même pas sûr que Guénon ait jamais lu Nietzsche… Dans le domaine politique surtout, on assiste à des réceptions partielles et partiales, déformées, où la confusion avec Evola que j’ai démêlée dans mon Guénon ou le reversement des clartés est sans cesse entretenue. On le voit chez Steve Bannon, chez Alexandre Douguine, et maintenant Olavo de Carvalho, conseiller de Bolsonaro, mais aussi chez Hakim Bey, écrivain américain soufi qui a théorisé le concept de ZAD… Parmi les écrivains se réclamant de Guénon, il ne semble pas y avoir d’auteurs de grands livres qui pourraient actualiser et vivifier son œuvre. Pour prolonger Le Règne de la quantité, je préfère lire, par exemple, un auteur comme Olivier Rey dont les Heurs et malheurs du transhumanisme ou Une question de taille, me semblent plus intéressants que des digressions sans fin sur les articles du maître…
Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.