Maître de conférences à l’Institut d’Administration des Entreprises de Metz, Baptiste Rappin a développé une approche phénoménologique des enjeux du management dans plusieurs ouvrages, dont Au fondement du Management (Ovadia, 2014) et De l’exception permanente (Ovadia, 2018). Il vient de faire paraître, chez le même éditeur, Tu es déjà mort ! Les leçons dogmatiques de Ken le survivant, essai qui interroge l’idée du déclin de la civilisation à travers l’exemple du célèbre manga.
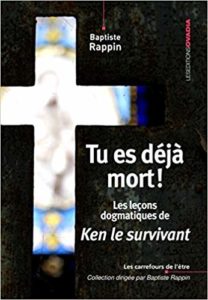
PHILITT : Selon vous, Ken le survivant (Hokuto no Ken en version originale) est le manga qui exprime avec le plus de radicalité le sentiment d’angoisse qui habite les Japonais depuis les catastrophes d’Hiroshima et Nagasaki. Pourquoi accorder cette primauté à l’œuvre de Tetsuo Hara plutôt qu’à d’autres mangas comme par exemple le magnifique Akira de Otomo ?
Baptiste Rappin : Permettez-moi de planter le décor pour le lecteur non averti : le manga est une production à la fois artistique et industrielle qui fait suite à la Seconde Guerre mondiale, c’est-à-dire à l’éclair atomique et à la mise sous tutelle américaine. Cette coïncidence historique n’en est pas une, et la généalogie s’avère, en réalité, une étiologie : le manga tire son origine de ce traumatisme, ainsi qu’en témoigne la situation de table rase qui caractérise tout scenario qui se respecte (décès ou absence des parents, orphelinat, adoption, etc.). Or, parmi les mangas, certains font du monde post-apocalyptique leur paysage : citons comme exemples Gen d’Hiroshima, Violence Jack, Akira, Evangelion, Ken le survivant. Alors pourquoi accorder la primauté à ce dernier ? Sans ternir l’image de Hokuto no Ken, je dirais que les raisons de ce choix ne lui sont pas vraiment intrinsèques, elles ne sont à vrai dire guère esthétiques ni narratives, je pense qu’elles sont liées à la spécificité de sa réception française : grève des comédiens d’Antenne 2, indignation de Ségolène Royal et des élites puritaines, adoption de traductions grotesques… Toute ma génération, celle de Récré A2 et du Club Dorothée, ces bambins des années 1980 qui ont aujourd’hui entre 35 et 45 ans, se souvient de ces vicissitudes et guettait depuis l’opportunité de pouvoir enfin apprécier une adaptation française de qualité. Je rajouterais encore un dernier élément : il y a dans Ken le survivant la mise en scène de traditions martiales (le Nanto et le Hokuto), fascinantes pour l’imaginaire oriental des Européens, qui exacerbent la tension entre la civilisation et les traditions d’un côté, et l’effondrement et la hantise de la disparition de l’autre.
Le fameux « Tu ne le sais pas mais tu es déjà mort » (Omae wa mou shindeiru) de Kenshiro peut-il être considéré comme un slogan collapsologique ? Comme une accusation beaucoup plus radicale que le « Comment osez-vous ? » de Greta Thunberg ?
On pourrait formuler votre question à la manière des éditeurs : de quoi « tu es déjà mort ! » est-il le nom ? Ici encore, un rappel pour débuter : il s’agit d’une phrase que le héros, Kenshiro, prononce alors qu’il vient de presser certains points vitaux du corps de son adversaire, que ce dernier se trouve sur le point d’imploser, qu’il est, au fond, déjà mort mais sans en être conscient. En somme, « Tu es déjà mort ! » désigne une suspension du temps, un prolongement de la vie au sein de la mort, la prolongation de l’existence sous la forme d’un simulacre d’existence. S’il fallait trouver un équivalent à ce slogan dans l’imaginaire occidental, je le trouverais volontiers dans les films magistraux de George Romero qui prit lui-même son inspiration dans le roman de Richard Matheson, I am a legend : le zombie, en effet, est bien cette figure de la survie dans la mort. D’un point de vue philosophique et anthropologique, cette sentence – dans le double sens de maxime et de décision fatale – m’évoque la notion de « délai » qui se trouve au cœur de la pensée de Günther Anders : comme lui, je crois que l’effondrement a déjà eu lieu, qu’il n’est pas devant nous mais derrière nous, et qu’il a pour nom « révolution industrielle ». De telle sorte que nous croyons être vivants – c’est d’ailleurs le rôle du marketing de développer l’expérience utilisateur afin que celui-ci se sente vivre ou, mieux dit, croie se sentir vivre – tout en étant déjà morts : de façon moins imagée et plus concrète, la chute des taux de fécondité des pays dits développés atteste bien que la société industrielle ne fournit plus aucune raison de vivre aux populations qu’elle concerne, et que l’enchaînement des générations s’en trouve tout simplement grippé.

Dans Ken le survivant, la disparition de la civilisation entraîne celle de l’humanité de l’homme et en particulier de sa « dignité ». Pouvez-vous nous dire comment se manifeste cette régression ?
Votre question suppose un postulat anthropologique que je partage pleinement mais qu’il est ici nécessaire d’expliciter. Affirmer en effet que la disparition de la civilisation entraîne avec elle celle de la « dignité » de l’homme, c’est sous-entendre que la civilisation serait la condition de possibilité de cette « dignité », autrement dit qu’il ne peut exister de dignité accordée à autrui que par le truchement de médiations, au premier rang desquels le langage et les institutions. Cette thèse, qui relève largement de l’anthropologie philosophique issue des travaux d’Arnold Gehlen et réactualisée plus récemment par Dany-Robert Dufour, s’inscrit en faux contre toute prétention à saisir l’altérité de façon immédiate : je pense en particulier aux affirmations péremptoires de Jacques Derrida sur l’amitié, ou encore à la théologie du visage que développe Emmanuel Levinas. Quand les structures symboliques s’effondrent, quand la parole disparaît, quand le droit et les rites n’assurent plus la normativité indispensable à toute collectivité, alors se manifeste la régression vers l’animalité sous toutes ses formes : la loi du plus fort bien sûr, bien plus violente que celle décrite par Thomas Hobbes dans son Léviathan car exacerbée par la rareté des ressources naturelles, mais aussi le travail dont Hannah Arendt avait montré, dans la Condition de l’homme moderne, qu’il repose sur la temporalité biologique du corps humain – l’éternel retour du produire et du consommer.
Dans le manga, les grandes étendues de sable recouvrent la quasi-totalité d’un monde dévasté. Dans quelle mesure le sable, au-delà de sa réalité géologique, possède-t-il une dimension symbolique ?
Après l’explosion nucléaire et le travail de sape du temps et du vent, la surface de la planète se couvre en effet de sable : l’étymologie du mot « dévastation » fait d’ailleurs signe vers ce processus d’ensablement, et l’adjectif vastus pointe aussi bien vers le vide que vers le démesuré et même le grossier, trois caractéristiques du désert. Comme toute dimension symbolique, celle du désert s’avère ambiguë et biface : d’aucuns voient dans cette étendue indifférenciée un réservoir de possibilités ou encore le lieu d’exercice d’une spiritualité ; sans nier ce premier versant interprétatif, j’ai pour ma part insisté sur l’image de stérilité qui lui colle au grain si je puis dire. De ce point de vue, le désert est l’antonyme de l’eau et, par extension, de la civilisation : si toute agriculture naît d’un terreau fertile et toute culture d’un esprit fécond, alors le désert représente l’impossibilité de l’édification d’un monde habitable puisque tout y est ramené au seul enjeu de la survie. Mais il me semble qu’une autre dimension du désert est aussi présente dans mon essai, non plus symbolique mais cette fois-ci proprement métaphysique voire théologique : le désert est le lieu de la platitude et de l’horizon indéfini, celui où le Même – le grain de sable – ne cesse de se reproduire à l’identique. « L’Être est » résume parfaitement cette situation, et le lecteur comprend alors pour quelles raisons je puis déceler dans le désert une manifestation spatiale de l’éléatisme (Parménide), de l’univocité (la recherche de l’ens commune qui motive tant Duns Scot) et de leurs héritiers contemporains (comme Gilles Deleuze qui se réclame de ces deux figures dans Différence et répétition).

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Ken le survivant est structuré par une anthropologie pessimiste. Seule la loi du plus fort peut succéder à la disparition des sociétés humaines. Pourtant, Servigne et Stevens ont montré dans Comment peut tout s’effondrer que les premiers réflexes en cas de crise d’envergure sont des réflexes d’entraide et non d’hostilité. Vous précisez bien que Ken le survivant est une « expérience de pensée », mais celle-ci n’est-elle pas caricaturale ?
Précisons tout d’abord comment se présente cette anthropologie pessimiste dont vous parlez : dans Ken le survivant, l’intrigue met sempiternellement aux prises des villageois qui essayent de cultiver une terre irradiée et des pillards qui volent leurs récoltes et les terrorisent. Plus encore, les seconds s’amusent du malheur des premiers sous différentes formes : concours de lancer de villageois, colin-maillard avec des jeunes femmes étouffées dès lors qu’elles sont attrapées, obligation pour un villageois de scier la tête d’un autre sous peine de voir sa femme et sa fille tuées sur le champ, etc. Bref, les exemples de ce cynisme sadique ne manquent guère, ce qui conduit effectivement à poser la question de la crédibilité d’une telle hypothèse anthropologique. Car il est vrai que Servigne et Stevens lui opposent les comportements de solidarité et d’entraide observés à la suite du passage de l’ouragan Katrina sur la Nouvelle-Orléans.
Plusieurs arguments me permettent pourtant de supporter cette thèse que d’aucuns jugeront peut-être caricaturale : tout d’abord, si Servigne et Stevens mentionnent que des comportements prédateurs furent observés à la suite de la catastrophe, ils les minorent aussitôt pour ne retenir que les faits correspondant à leur optimisme anthropologique. Ensuite, ils tirent d’une situation locale une conclusion générale : or il me semble qu’un effondrement total – la disparition de toutes les civilisations englouties dans une apocalypse mondiale du fait même de la planétarisation industrielle – n’offre pas les mêmes conditions initiales qu’un accident local. Enfin, et surtout, s’il est vrai que je présente le manga comme une expérience de pensée au début de mon ouvrage – propos que je qualifierais donc de méthodologique –, il appert au fur et à mesure du développement que Ken le survivant nous propose une description de notre monde – thèse cette fois-ci pleinement ontologique. Contrairement aux collapsologues qui se préparent au pire, je crois que le pire est déjà advenu, que l’expression « civilisation industrielle » est un oxymore intenable, et que chaque jour qui passe nous fournit la preuve éclatante d’une société qui ne laisse pas de trépasser. « Tu es déjà mort ! » s’adresse par conséquent d’abord à nous-mêmes qui peuplons l’abîme du délai.
Quelle leçon devons-nous tirer de Ken le survivant ? Le but de cette expérience de pensée apocalyptique, où les forts martyrisent les faibles, c’est-à-dire les femmes, les enfants et les vieillards, est-elle de nous rappeler le caractère précaire et indispensable des sociétés humaines ?
On pourrait dire que l’enjeu d’une méditation à propos de Ken le survivant est de faire surgir quelque chose à partir du rien ; comme si, paradoxalement et contre toute attente, l’absence de civilisation pouvait être source de réflexion à propos de la civilisation. Tel est précisément l’objet du chapitre conclusif qui, semblant de prime abord déconnecté des analyses précédentes, en tire en réalité les leçons dans le cadre de la formulation d’une anthropologie philosophique générale. Au fond, qu’appelle-t-on « civilisation » ? Et quels montages symboliques permettent de soutenir cet édifice ? Pour répondre à ces questions, je m’inscris dans la filiation d’Arnold Gehlen, de Lewis Mumford, de Konrad Lorenz ou encore de Dany-Robert Dufour dont les réflexions respectives se fondent sur ce fait biologique thématisé par le savant hollandais Louis Bolk dans les années 1920 : je veux parler de la « néoténie », terme qui désigne le caractère prématuré, et par conséquent démuni, de l’animal humain. Cette précarité de l’enfant humain engendre un ensemble de corollaires – un investissement parental inégalé dans le règne animal, la technique comme prolongement du corps, la cité et ses lois comme seconde nature, etc. – qui tous paraissent émaner d’une même propriété : la parole humaine, qui, Dieu sait que Heidegger y insista, jamais ne saurait se réduire à la communication. Parce qu’ils nous coupent du monde et dématérialisent le réel dans les signifiants, les mots instaurent un écart qui fait de l’être humain un animal par essence inadapté à son environnement, si bien que l’histoire et les œuvres de l’esprit, qui ne sont pas installées dans l’instant mais se transmettent grâce à l’enchaînement des générations, constituent par excellence la patrie de l’humanité. Donnons alors le mot de la fin à Ken le survivant : ce dont témoigne au fond le manga, c’est bien que la barbarie naît de l’éclipse du langage et du primat du corps sur l’esprit, ou de la biologie sur la culture, une double entreprise qu’initièrent les nazis comme le montra Johann Chapoutot dans La loi du sang (paru en 2014 chez Gallimard) et que le néolibéralisme, d’une manière qui lui est propre, prolonge si l’on en croit la très longue et très précise généalogie qu’en propose Barbara Stiegler dans « Il faut s’adapter » (paru en 2019 chez Gallimard).
Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.
