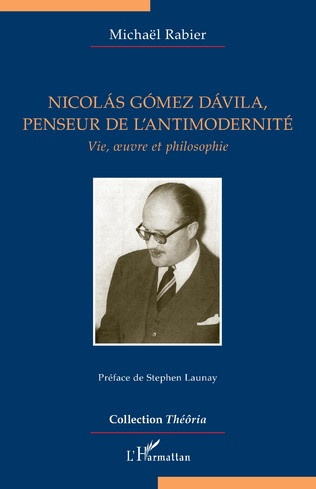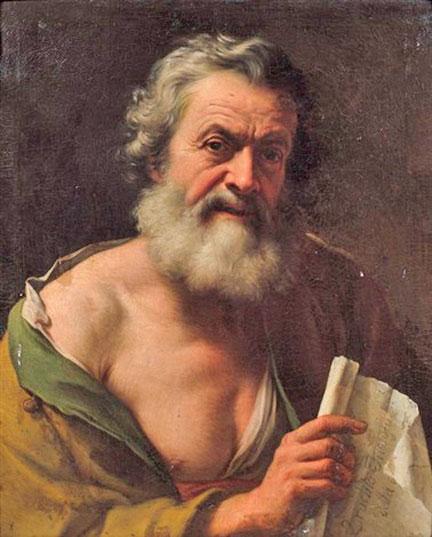Michaël Rabier est docteur en philosophie et membre associé du Laboratoire Hannah Arendt (Lipha) de l’Université Paris XII. Dans Nicolás Gómez Dávila, penseur de l’antimodernité (2021, L’Harmattan, collection « Théôria»), il expose avec érudition la pensée d’un écrivain encore méconnu. Le « réactionnaire authentique » a en effet souffert de sa radicalité philosophique malgré la profondeur de ses vues.
PHILITT : L’œuvre de Nicolás Gómez Dávila a été peu diffusée de son vivant et encore aujourd’hui. Son pays, la Colombie, l’a longtemps ignoré. Et l’Espagne, malgré la langue commune, ne s’est pas intéressée à lui. Il a fallu un éditeur Autrichien, Peter Weiss, pour que son travail soit introduit en Europe via une traduction allemande. Comment expliquer cette réception tumultueuse de l’œuvre de Gómez Dàvila ?
Michaël Rabier : Si vous me le permettez, je commencerai par nuancer votre propos sur plusieurs points. Sa réception n’est pas tumultueuse, mais plutôt paresseuse… Premièrement, en ce qui concerne son propre pays. C’est l’Université qui en Colombie l’a, à quelques exceptions près, longtemps ignoré. La presse elle, a contrario, lui a toujours fait bon accueil, dès la publication du premier volume de ses scholies sans doute parce qu’il connaissait bien le milieu littéraire, et surtout les élites intellectuelles et politiques dont il faisait partie, sans toutefois n’avoir eu jamais de responsabilité.
Deuxièmement, je rappellerai que ce sont d’ailleurs des institutions paraétatiques (qui se substituaient à un ministère de la Culture inexistant à l’époque) qui ont d’abord édité Gomez Davila, sans lesquelles ses carnets de note seraient restés dans l’intimité de son cercle d’amis. Enfin, l’Université étant en Colombie comme ailleurs dans le monde occidental, à la fois très orientée idéologiquement et très conformiste intellectuellement, l’a dans un premier temps ignoré et, dans un second, l’a découvert voyant l’intérêt qu’il suscitait en Europe et Allemagne en particulier. Il est ainsi maintenant beaucoup plus lu et étudié dans les universités, publiques comme privées, grâce aussi à l’influence de Franco Volpi en Colombie. C’est lui qui a incité aux rééditions colombiennes, chez Villegas principalement.
Ce qui m’amène à la dernière partie de votre question. C’est en effet l’éditeur autrichien Peter Weiss qui l’a traduit initialement Europe, détenteur d’ailleurs des droits étrangers par l’amitié qui le liait à l’auteur. C’est grâce à lui que Gomez Davila a été introduit et connu en Europe, a attiré l’attention de Franco Volpi en Italie, et par la suite de Samuel Brussel en France, et enfin – nul n’est prophète en sa propre langue – en Espagne.
Gómez Dávila entretenait une méfiance vis-à-vis de la philosophie qu’il réduisait volontiers à une simple rhétorique. Pourquoi cette critique de la philosophie chez lui sachant que son œuvre n’est pas seulement un exercice littéraire mais bien la défense de vues proprement philosophiques ?
En paraphrasant Pascal, je dirai que se méfier de la philosophie, c’est vraiment philosopher. Cette méfiance, en dehors de son aspect proprement méthodologique, tient certainement à la fois à son scepticisme et à son fidéisme. Méfiant par tempérament des nouveautés philosophiques et des systèmes totalisants de la modernité ou post-modernité. Il s’agit là de la même défiance que l’on trouvait chez certains, dont il est l’héritier, à l’égard de ceux que l’on appelait les « Philosophes » au XVIIIe.
L’ « anti-philosophie », ou la critique des « philosophes » est une caractéristique des penseurs contre-révolutionnaires et réactionnaires – à commencer par Joseph de Maistre – mais aussi des penseurs non-systématiques, existentiaux pour ne pas dire « existentialistes » (Pascal encore une fois, Kierkegaard, Nietzsche, Wittgenstein, etc.). Sa méfiance dans les pouvoirs de la raison, ou du rationalisme, de parvenir, seuls, à une quelconque vérité également. Ici, c’est l’héritier du romantisme, allemand mais pas seulement si l’on se souvient des critiques de Rousseau contre le culte de la science et de la raison de ses contemporains, autre facette des anti-Lumières. À l’instar d’un Pascal et d’un Rousseau ou Novalis, Gómez Dávila place la foi d’une part, puis le sentiment, la sensibilité ou l’intuition d’autre part, au-dessus de la raison et surtout de la ratiocination. Mais par ailleurs et paradoxalement, c’est également un héritier des Lumières et surtout de Voltaire par la dimension critique et même sarcastique de son œuvre, la liberté de sa pensée et le « grand style » de son écriture.
Pour finir, justement à propos de style, ce n’est pas tant la rhétorique qu’il méprise chez certains philosophes que le « jargon » c’est-à-dire, « l’impureté », voire l’absence, de style propre à l’expression technique du spécialiste (je renvoie sur ce sujet au paragraphe 101 du Gai savoir de Nietzsche dédié à Voltaire). Or selon Gómez Dávila, ainsi qu’il l’exprime à plusieurs reprises, la philosophie a besoin, pour sortir de sa routine académique et se revivifier, d’amateurs, de non-spécialistes ou « aficionados » tels que Socrate, Descartes, Hume, Kierkegaard, Nietzsche, etc. Pour lui, ainsi que j’ai essayé de le démontrer dans l’ouvrage en suivant l’interprétation de Pierre Hadot, la philosophie est plus une manière de vivre qu’une profession ; ou, si elle était un métier, ce serait un « métier de vivre » pour reprendre la belle formule de Pavese. Il y a incontestablement une dimension existentielle de la philosophie qui échappe, par définition, aux universitaires.
Le Colombien a choisi le fragment ou, selon ses termes, la « scholie » pour exprimer sa pensée. Il soutient, de manière paradoxale, que cette forme est plus « totale » que le système. Comment comprendre cette affirmation ?
Il faut, je pense, la comprendre à partir du fragment 206 de l’Athenaeum et plus généralement de la philosophie romantique du fragment tel que celui-ci le résume et dont Gómez Dávila est encore une fois l’héritier même s’il emploie un autre terme et s’inscrit dans une autre tradition sur laquelle je reviendrai ensuite. « Pareil à une petite œuvre d’art, un fragment doit être totalement détaché du monde environnant, et clos sur lui-même comme un hérisson », dit ce fragment attribué à Friedrich Schlegel.
Les Modernes, ou plus exactement Postmodernes (Blanchot, Derrida), ont beaucoup glosé sur cette esthétique du fragment en en faisant le signe de l’impossibilité de la totalisation et de la systématisation du savoir et donc de la rupture avec les grands récits classiques : une forme de déconstruction avant l’heure en somme. Ce n’est pas faux mais partial. Le fragment selon les Romantiques et le Colombien selon moi, doit certes être vu comme une totalité en soi, une individualité, mais une individualité organique, celle-ci renvoyant comme une image, en petit, de la totalité entière (le Grand Univers des occultistes), insaisissable. Un peu comme le microcosme serait un reflet du macrocosme. Il est à la forme littéraire ce que l’organisme est aux sciences naturelles et l’on sait que les Romantiques recherchaient ces correspondances partout dans la nature, d’où leur intérêt pour son étude et la Naturphilosophie.
Par ailleurs, cette forme s’avère plus englobante à condition qu’elle s’inscrive également dans un ensemble, dans la mesure où elle permet l’expression de la contradiction ou des tensions qui parcourent la réflexion, par conséquent plus fidèle à l’existence et moins schématique que le système. C’est la raison pour laquelle je ne crois pas qu’il faille distinguer entre ce que Philippe Lacoue-Labarthe et Jean-Luc Nancy nomment le fragment « philologique » et le fragment « littéraire ». Car ce dernier est aussi le signe d’une perte et d’un regret ou nostalgie de la totalité perdue : « Le fragment est le moyen d’expression de celui qui a appris que l’homme vit parmi des fragments », écrit Gómez Dávila. Ici il faudrait rappeler ce que Pascal Guignard évoque dans Une gêne technique à l’égard des fragments à propos de La Bruyère contre les Modernes et Postmodernes et leur interprétation de la forme fragmentaire : « Le fragment est ce qui s’est effondré et reste comme le vestige d’un deuil. Il est la citation, le reliquat, le talisman, l’abandon, l’ongle, le bout de tunique, l’os, le déchet, d’une civilisation trop ancienne ou trop morte. » Comme lui, Gómez Dávila s’identifierait à l’archéologue, l’antiquaire ou le collectionneur des ruines d’une civilisation détruite…
Peut-on considérer que l’utilisation de la scholie l’inscrive dans une certaine tradition philosophique, celle d’Héraclite ou de Nietzsche ?
C’est la raison de son usage du terme peu usité, ou désuet, même en castillan, de « scholie » pour définir sa forme d’écriture fragmentaire. Le terme, – au féminin et avec un « h » – vient du grec skhólion lui-même provenant du terme skholế et signifie une « occupation studieuse », une activité dédiée à l’« étude ». Par extension, les Byzantins se référaient à leurs commentaires des textes comme scholia au sens de « notes en marge d’un texte », alors que les Anciens les nommaient hypomnemata. Mais le développement le plus important dans l’histoire du commentaire se situe au Moyen-Âge, au moment où, avec l’apparition des codices laissant plus d’espace que les volumen (papyrus), les commentaires littéraires se transforment en scholies. Modèle qui s’est ensuite développé à la Renaissance et s’est émancipé en s’éloignant de plus en plus du texte commenté pour devenir un texte à part entière.
Gómez Dávila s’inscrit ici dans cette autre tradition, antique, médiévale et humaniste (au sens des « humanités »), de recueil des pensées passées, commentant l’héritage de la culture occidentale à partir de ses vestiges. Il s’agit donc également d’une œuvre de restaurateur, de lecteur et de passeur, à travers le recours à la citation, l’allusion, la paraphrase ou l’emprunt pur et simple – à la manière de Montaigne qu’il revendique comme son « saint patron » – aux auteurs de la tradition philosophique et littéraire européenne. Par conséquent, il ne prétend pas à l’originalité ou plutôt la nouveauté, prétention typiquement moderne. Et malgré qu’il en ait, il s’inscrit de surcroît, en effet, dans la tradition de l’aphorisme ou des « penseurs de l’éclair » comme les nomme George Steiner, depuis Héraclite jusqu’à Wittgenstein et même Gustave Thibon, Simone Weil, en passant évidemment par les moralistes français, les romantiques allemands, Schopenhauer, Nietzsche dont on sait ce que ceux-ci doivent à ceux-là.
Gómez Dávila voyait dans l’orphisme, et par extension dans Platon, la source de la « Réaction ». Quelle est exactement la nature de cette « Réaction » primitive ?
Si « la Réaction commence à Delphes » comme il l’écrit d’une manière à la fois provocatrice et péremptoire, c’est parce qu’il s’agit d’un ancien sanctuaire orphique, tombeau du Dionysos-Zagreus des Crétois. C’est une réaction « primitive » ou première selon lui car on trouve dans ce courant philosophico-religieux et ascétique du VIe siècle avant J.-C. la première doctrine de la chute et du salut. Or, le fidéiste Gómez Dávila, par sa vision métaphysique, voire même mystique, de la politique estime, pour reprendre une autre de ses scholies, que « [l]a Réaction a commencé avec le premier repentir ». D’une certaine manière le sacrifice de Dionysos-Zagreus, dépecé, préfigure celui du Jésus crucifié. Par ailleurs, les Orphiques croyaient en l’immortalité de l’âme, parcelle de la divinité préservée dans l’homme et par conséquent sauvable malgré son enfermement dans un corps. Cela est possible grâce à une forme d’expiation qui passe par une initiation et une ascèse. On voit ici le lien avec la doctrine platonicienne, Platon ayant été initié au pythagorisme lequel passe pour être une réforme de l’orphisme (Pythagore a eu comme maître une grande figure de celui-ci).
Il faudrait ajouter à cette ascendance religieuse païenne et préchrétienne de la Réaction, une autre plus proprement théologique et judaïque : « Dans la réaction se ramifie et s’étend la notion centrale du judaïsme : la notion de créature. » Il insiste donc aussi sur la transcendance de Dieu et la dépendance de l’homme, son infériorité ontologique et existentielle due à son état lapsaire. Voilà qui fait de lui, en tous les cas, par cette filiation orphique et théologique et même théologicio-politique, un coreligionnaire de ceux que Steiner appelait les « logocrates » (Maistre, Heidegger, Boutang).
Notre penseur distingue clairement le réactionnaire du conservateur. Que reproche-t-il au conservateur, du moins sous sa forme politique ? Et, en revanche, qui est ce « conservateur contemplatif » dont il se sent proche ?
Il est conservateur selon la définition que Steiner donne du conservatisme dans ce texte : « une politique qui découle de la Chute et qui s’efforce d’y faire face ». Il faudrait mieux dire d’ailleurs une « métapolitique » non pas tant au sens gramscien mais maistrien, c’est-à-dire une métaphysique de la politique. Par définition donc il est un « conservateur contemplatif » puisqu’il croit moins en l’action qu’en la conversion. Avant d’agir, si toutefois c’est encore possible, il faut observer, penser, et transformer son esprit plutôt que le désordre du monde. En ce sens, le conservateur contemplatif ou le « réactionnaire authentique » tel qu’il le nomme aussi est l’anti-révolutionnaire par excellence. C’est la raison pour laquelle je le compare à la figure de l’anarque d’Ernst Jünger, notamment tel qu’il est décrit dans son roman Eumeswil. Le conservateur, par rapport à ce réactionnaire qui paradoxalement ne ré-agit pas, a toujours selon lui un temps de retard par rapport à l’Histoire. Le conservateur est, en fait, au mieux un « retardateur » (pardon pour ce néologisme) ; au pire, un réformateur ou un « progressiste paralysé » selon son expression. Dans le premier cas, il résiste noblement à un progrès inéluctable ; dans le deuxième, il s’y adapte lentement. Dans tous les cas, il arrive toujours trop tard… c’est-à-dire après les événements, à moins qu’il soit un Cassandre, mais dans ce cas il sait que le combat est perdu d’avance. Cependant, il sait à quoi s’attendre. En somme, la solution ne se trouve pas dans l’action mais dans la transmission d’un leg, d’une tradition.
Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.