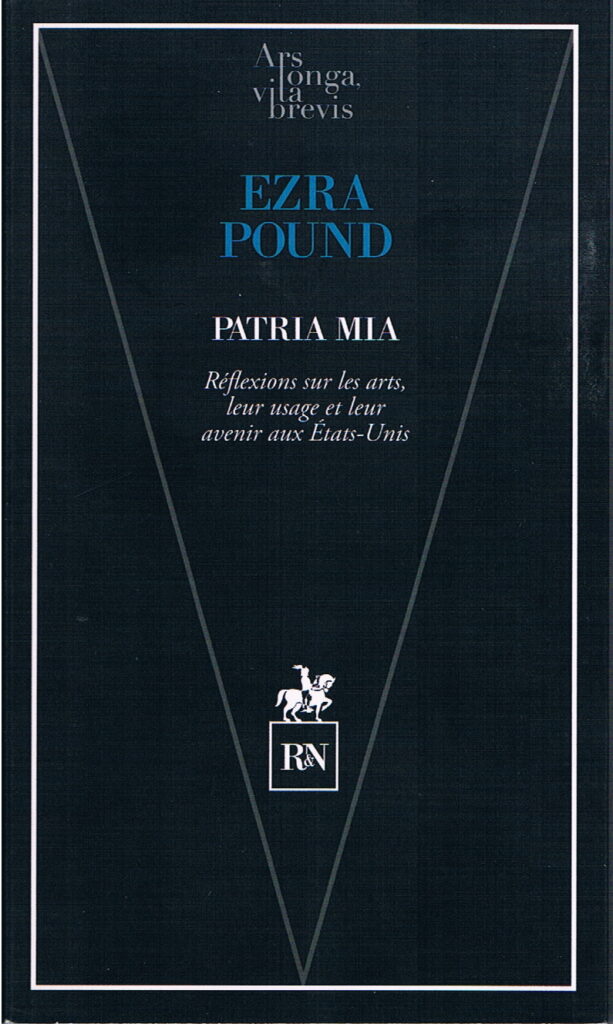Pound n’a pas trente ans quand il se pose la question du futur des arts dans sa patrie. La réponse qu’il donne dans Patria Mia, Réflexions sur les arts, leur usage et leur avenir aux États-Unis (R&N, 2022) est celle d’un homme à la pensée mûre, à l’optimisme lucide, mais devinant, peut-être, les désillusions à venir.
Nulle complaisance à reconnaître, avant toute chose, le mérite immense des éditions R&N. Depuis leurs débuts, elles ne cessent de mettre à la disposition des lecteurs de langue française des ouvrages essentiels pour la pensée, mais malheureusement tombés dans un oubli plus ou moins grand, quoique toujours immérité, ou désormais marginaux par rapport aux courants d’idées les plus répandus.
La publication de Patria Mia d’Ezra Pound (1885-1972) en est une nouvelle illustration. D’abord paru en feuilleton dans l’hebdomadaire londonien The New Age, au début des années 1910, le texte final de Patria Mia est longtemps resté inédit aux États-Unis. Aujourd’hui, le poète Auxeméry met à la disposition du lecteur français ce texte révélateur de l’évolution intellectuelle de Pound.
La question de la culture en général et celle de sa patrie en particulier est l’un des fils conducteurs de sa réflexion. Hanté et habité par l’Europe, où lui-même a vécu la majeure partie de sa vie, Pound n’a jamais renié l’Amérique. Il a voulu pour elle et pour le monde quelque chose de plus beau, de meilleur. Mais à l’image de cette terre peuplée de « nomades », colonisée par les migrants « les plus rudes et les plus énergiques », sa langue semble une sorte de melting pot où cohabitent, suivant les époques, la méticuleuse mémoire des faits et des mots de l’histoire politique américaine et l’appropriation amoureuse de la poésie médiévale ; le confucianisme chinois et l’épopée de la Grèce archaïque. Cela donne à sa poésie une douloureuse beauté et à sa pensée un aspect, parfois, contourné, bizarre, baroque. Le présent livre n’échappe pas à la règle. Le lecteur est certain que l’auteur va quelque part, il le sent, il le sait, mais où ? comment ? par quel chemin ? Le doute est toujours là. Patria Mia n’est pas un texte évident, tout au contraire. Sa richesse n’est pas seulement dans le style et dans les idées, mais aussi dans l’agencement, parfois curieux et troublant, de ces dernières. Nous ne pouvions cacher, ici, cette difficulté que le traducteur a su vaincre, mais que le lecteur doit encore dépasser — il le doit à Pound et à lui-même.
« Je déteste toute éducation qui tend à séparer l’homme de ses semblables », nous dit Pound. Peut-être est-il possible de voir, ici, le résumé de son propos général. L’« Américain de l’instant », c’est-à-dire d’après la fin de la Reconstruction, doit sortir de son provincialisme. En ce début de XXe, sa patrie est à Paris et Londres ce que l’Espagne était à Rome, une province riche et lointaine, nous dit Pound — une province qui n’avait pas, alors, encore donné naissance à son Théodose aurions-nous envie de dire en ce début de XXIe siècle. Une province — l’Espagne, les États-Unis, peu importe — située aux mêmes latitudes que l’Italie. Car Pound se fait un tenant de la théorie des climats et rappelle qu’après tout, New York est sur le même parallèle que Florence et que l’Américain est un homme du midi.
Échappant à l’âge de Ténèbre dans lequel est plongé son pays, l’Américain Pound espère une nouvelle aube — Alba, dit-il, en provençal —, une seconde Renaissance, un ultime Risorgimento. Le respect et l’amour du passé et du sacré ne doivent pas être un frein à la liberté de l’art, à la création. « Les arts sont, quand ils sont saints, succincts », il est désormais temps de devenir facond pour être fécond. Et si Marinetti veut répudier une Venise « exténuée par de morbides voluptés séculaires », eh bien les Américains en reconstruiront une nouvelle, une plus belle, une plus lumineuse sur les vasières du New Jersey.
La plus belle ville du monde
En effet, s’il y a bien pour l’auteur un signe du grand avènement de l’Amérique à la culture nationale, c’est dans l’architecture. Pound est poète, c’est en poète qu’il parle des villes, des buildings, des lumières électriques. Il est difficile de ne pas songer à Lovecraft, ici. L’un et l’autre ne voyaient guère que laideur dans le détail de New York, mais le tout, l’ensemble, la totalité enveloppée d’une nuit percée d’autant de carrés de flammes qu’il y a de fenêtres aux murs des gratte-ciels, leur paraît « égyptien », sublime, cosmique. Cependant, Pound, à la différence du gentleman de Providence, est un humaniste et de ce tableau il tire une leçon optimiste : « Voilà notre poésie […] nous avons soumis les étoiles à notre bon vouloir. »
Alors nous vient une question presque un soupçon. Pound nous dit-il la vérité quand, dans le même texte, il écrit : « J’ai cessé de croire aux utopies » ? Il est possible d’en douter, pourtant, il fait preuve de lucidité voire de cynisme (ou de naïveté — ce n’est pas toujours si différent) quand il dit voir dans les plus riches le moteur possible de cet élan américain vers la culture. Sans aucun doute, il se montre prophète. Il décrit un véritable programme qui se réalisera, ou peu s’en faut, après ce qui sera pour lui « l’énorme tragédie » de 45. Mais ce ne sera pas au profit des arts ou d’un Risorgimento américain. Le mécénat intéressé des Brahmanes de Nouvelle-Angleterre ne libérera pas les arts, il les enchaînera ; il ne mènera pas l’Amérique à poursuivre et dépasser l’œuvre de la vieille Europe, mais contraindra le monde à la sous-humanisation par l’américanisation. A-t-il senti venir cela, plus tard ? L’a-t-il compris à la fin de sa vie ? Est-ce là la raison pour laquelle il a fini les épaules courbées dans une cage de fer ? Qui sait… En tout cas, même le livre fermé, nous sommes bien forcés de continuer à y penser, « doux, calmes et sans mépris ».
Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.