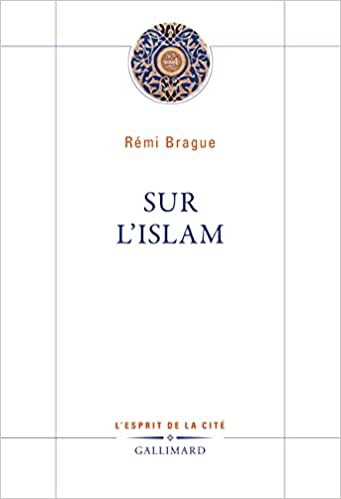Rémi Brague, philosophe arabisant et enseignant, membre de l’Institut, publie Sur l’islam aux éditions Gallimard. Hélas, l’auteur rejoint ceux qui prétendent contradictoirement nous éclairer sur la nature de l’islam tout en admettant (dès la deuxième phrase de ce livre) n’en être « nullement spécialistes ». Sans surprise, l’ouvrage n’est pas convaincant, si ce n’est comme une nouvelle itération de cet exercice imposé : non pas l’islam pour les Nuls, mais l’islam par les Nuls.
Rémi Brague, en tant qu’universitaire, n’est pas dépourvu de qualités, dont celle d’être arabophone ; sa réflexion est mûrie par le temps et il faut lui reconnaître une érudition certaine dans son domaine. Mais c’est hors de ce champ qu’il s’aventure ici, alors même que, de son propre aveu, « pour parler de l’islam avec quelque autorité, il faudrait avoir lu beaucoup plus ». Pourtant pas effarouché pour si peu, il nous livre, au gré de ses presque quatre cent pages, le fruit de ses réflexions, de ses questionnements, mais aussi de ses fantasmes, de ses erreurs parfois et de sa mauvaise foi souvent. Car c’est bien là, nous semble-t-il, la principale originalité de l’ouvrage ; malgré ce trop court avertissement, Rémi Brague enrobe les poncifs les plus éculés sur l’islam, qu’il ressert sans la moindre originalité, avec une apparence savante. Il développe ainsi librement une rhétorique polémique sans éveiller les soupçons du lecteur néophyte.
Alors même que l’auteur affiche son ambition de palier le délaissement par les « islamologues compétents » des présentations générales et du souci de la synthèse en examinant « les rapports entre la théorie islamique et pratique islamique telle que l’histoire en témoigne », on trouve un sommaire très partiel et partial. L’ouvrage est ainsi divisé en quatorze chapitres que l’on pourrait regrouper en trois parties : une première, généraliste, qui interroge des concepts généraux ; une plus théorique sur des points précis de la doctrine islamique, comme la sharia, la loi naturelle et le but de l’islam ; enfin, les sept derniers chapitres sont consacrés à deux grands sujets plus concrets, celui de la violence supposée de l’islam et celui de l’apport de la civilisation islamique à l’Europe que l’auteur minimise voire récuse. Alors même que plus d’un tiers des chapitres sont consacrés à la question de la violence en islam (cinq sur quatorze), l’auteur prive le lecteur de thèmes importants sans justification : le développement des arts, la philosophie politique, le soufisme et les sciences symboliques et spirituelles, dont les contemporains tireraient pourtant le plus grand profit à les redécouvrir : de la science des astres (Ilm al-Nujum) et la physiognomonie (‘ilm-i firāsat) à la science des Lettres (îlmul-huruf) et la science des Nombres (‘ilm ḫawāṣṣ), en passant par la psychologie traditionnelle ou la science des pensées (ilm el-khawâtîr). Pire, l’auteur de la Loi de Dieu semble citer sans cohérence les auteurs qui se rangent au point de vue défendu, conférant parfois au tout l’allure d’un patchwork bigarré à visée polémique : aucune ligne de force, aucun apport scientifique réel, aucune vraie synthèse.
Sur l’islam et sous la ceinture
À la lecture de l’ouvrage, on est d’abord frappé par l’utilisation de sources sans discernement, ou plutôt avec un discernement dissimulé, en contradiction totale avec l’apparence savante de l’ouvrage. Rémi Brague n’hésite pas à invoquer des auteurs en rien représentatifs de l’islam, voire carrément marginaux, dès lors qu’ils appuient ses dires. Ainsi, pour prouver « la radicale impuissance de la raison », il cite longuement Ibn Hazm car « nul sans doute n’a exprimé la fonction de la raison avec plus de pertinence ». Or, Ibn Hazm est l’un des derniers représentant de l’école zahirite, désormais éteinte, qui se caractérise par… une moindre place accordée à la raison. De même, pour montrer que l’islam cherche à détruire tout ce qui « empêche l’homme d’être asservi à Dieu » pour mieux asservir l’homme, il cite Sayyid Qutb, « un auteur récent », sans fournir d’autres précisions, ce qui est singulièrement fâcheux puisqu’il se trouve que Qutb est un des pères du jihadisme. On retrouve également un obscur chiite ismaélien pour justifier l’idée selon laquelle le verset de la tolérance religieuse signifie le contraire de ce qu’il dit littéralement, sans parler des nombreuses références à Ibn Taymiyya, un des pères (quoique sans doute malgré lui) des mouvements dits « islamistes ».
Inversement, certaines autorités sont passées sous silence ou leur propos déformé lorsqu’ils contredisent l’auteur. Ainsi, ce dernier constate, à propos des jihadistes de l’État islamique, que « les autorités religieuses se refusent à condamner autre chose que ceux de leurs crimes qui outrepassent la shariah et à les exclure de l’islam dès lors qu’ils respectent la shariah », alors même que le Grand imam d’Al-Azhar les a explicitement condamnés à mort en tant qu’ennemis de Dieu ce qui, nous semble-t-il, dépasse de quelque peu la condamnation de leurs seuls crimes. Mais ce n’est pas tout : l’utilisation biaisée des références se retrouve aussi du côté des auteurs modernes. On note, sans surprise, un recours abondant aux époux Urvoy, mentionnés parmi « les meilleures présentations générales de l’islam », quoique rangés par plusieurs auteurs parmi les islamophobes (avec Brague, il est vrai). On peut juger de leur neutralité par les questions qu’ils posent dans leurs ouvrages, telles que « l’arabe est-il christianisable ? ». Aucune référence en revanche à Makram Abbès, à Reza Shah-Kazemi ou à Seyyed Hussein Nasr qui ne sont même pas dans la bibliographie, pour ne citer que quelques auteurs importants qui s’opposent aux thèses de l’auteur.
Mufti shades of black
Pire, les versets et hadiths cités font souvent eux-mêmes l’objet d’une interprétation pour le moins personnelle. Ainsi d’un hadith qui semble faire porter les péchés des musulmans sur les gens du livre au jour de la Résurrection. Brague en conclut, à propos de l’utilité sociale des dhimmis, qu’ils « serviront, éternellement, de whipping boys » (bouc émissaire). Pourtant, il suffisait, à défaut de connaître les fondements du droit musulman, au moins de lire l’interprétation de Nawawi, autorité du hadith et sommité juridique qui réaffirme à ce propos le principe de l’individualisation de la peine, y compris dans l’au-delà, pour établir qu’il n’a jamais été question de « whipping boys » que chez Brague. C’est le même Nawawi qui récuse l’idée de la nécessaire humiliation des dhimmis, estimant cette opinion tardive infondée et contraire à la tradition prophétique, ce qui discrédite là encore la position de Brague sur cette question. Il en va de même pour le fondement de la dhimma – qui signifie littéralement la sauvegarde – établie selon Brague par des conquérants pour « vivre du travail des sujets conquis » à travers un impôt spécial, alors même que certains avis répandus, les laboureurs en sont exemptés.
Concernant le fait que la monogamie soit recommandée, Brague se demande si une telle interprétation n’est pas due à l’influence récente des mœurs occidentales, alors que le droit musulman des quatre écoles sunnites a adopté une telle position depuis la période classique. Mieux en tant qu’éminent « non-spécialiste », Brague révolutionne toute la compréhension de la notion de calife en estimant non seulement qu’il faille désormais le traduire par « successeur » et non plus par « représentant » ou « lieutenant », ce qui s’entend encore, mais que le fameux verset de l’investiture d’Adam en tant que « Calife » au jardin d’Eden (dans lequel Dieu annonce aux anges sa décision d’établir un Calife en créant l’homme) doit se comprendre comme signifiant non pas que l’homme est le Calife de Dieu, comme la Tradition et la lettre l’indiquent, mais qu’il est le Calife – donc le successeur – des anges, ce qui signifie qu’il « les remplacera ». La double distorsion opérée, quant au sens du Califat et quant au sens du verset cité, permet donc de comprendre qu’au cœur de la notion de Califat gît secrètement l’idée… de (grand ?) « remplacer un peuple par un autre » (sic) ! En plus de faire dans le fan service le plus débridé, l’interprétation permet d’éluder tout l’aspect métaphysique, auquel Brague est allergique, pour mettre l’accent sur l’idée de domination, qui serait bien au cœur de l’islam, puisque le Califat permet de remplacer les peuples…
Le comble est atteint à propos du fameux « verset de la tolérance » qui énonce : « Pas de contrainte en matière de religion ». L’auteur se demande « s’il s’agit d’une interdiction ou de la constatation résignée d’une impossibilité » avant de trancher évidemment pour la seconde hypothèse. S’il mentionne rapidement l’interprétation de Tabari pour qui le verset interdit de contraindre les « gens du Livre pour peu qu’ils paient la capitation » – mauvaise traduction de l’arabe jizyia, qui n’est pas un impôt par tête et signifie « rétribution » – il cite, là encore, des auteurs marginaux pour conclure, sans scrupule aucun, que « rien dans tout cela ne s’approche donc de ce que nous appelons […] tolérance ». Il est clair que le Docteur Rémi cède la place au moufti Brague chaque fois qu’il peut noircir le tableau. Au demeurant, il s’était donné une grande latitude en vidant de toute consistance l’idée même de « vrai islam », et partant celle d’orthodoxie islamique, en estimant au départ « être tout à fait incapable de fournir un tel critère ». Il ne nous apparaît pourtant pas surhumain, pour un catholique particulièrement, de distinguer ce qui, d’une part, s’inscrit objectivement et historiquement dans la Tradition continue, de ce qui relève, d’autre part, d’une tentative de Réforme via un libre-examen, qui fait dire n’importe quoi au texte.
De la taqya scientifique

La taille imposante des références et de la bibliographie est certainement conçue comme un gage de sérieux. Si elle vise manifestement à donner du poids à l’aspect scientifique, la bibliographie accuse des lacunes importantes : très peu d’auteurs ou d’ouvrages classiques du droit musulman selon les différentes écoles, peu de commentaires du Coran, peu de miroirs des princes, et surtout rien ou très peu sur le soufisme, alors même que nous disposons en France de sommités. De telles absences tendent là encore à appuyer l’idée d’une œuvre très orientée, aux antipodes de ses prétentions à la scientificité. C’est là sans doute le principal écueil de l’auteur : concentrant tous ses efforts sur les écrits polémiques et politiques, il semble ne rien vouloir connaître de tout ce qui touche à la métaphysique en islam et manque par-là même son sujet. D’une part, il cède à la vulgate de la marginalité du soufisme qui serait « absent des débuts de l’islam » et ferait « l’objet d’une tradition de méfiance ». Des auteurs comme Émile Dermenghem ou Alexandre Benningsen ont pourtant bien montré que la réalité historique était inverse. Le premier, auteur du Culte des saints dans l’islam maghrébin (1954) décrivit, il y a un siècle déjà, l’influence profonde et diffuse du soufisme dans la pratique ordinaire de l’islam au Maghreb. Le second montra dans Le soufi et le commissaire (1986) le rôle primordial joué par les confréries soufies chez les peuples musulmans d’URSS, rôle que même les autorités soviétiques ne purent réduire à néant. Aujourd’hui encore, malgré la domination matérielle des réformistes hostiles au soufisme, l’on sait qu’un cinquième des musulmans au moins est directement rattaché à une confrérie.
D’autre part, Brague semble ne pas comprendre le soufisme qui ne serait que « le miel déposé sur les bords de la coupe » du « poison » du légalisme : de ce point de vue, les leçons d’Urvoy, pour qui « le soufisme est le cheval de Troie de l’islamisme », ont été bien apprises… Ainsi, afin de neutraliser Ibn ‘Arabi, qui contredit évidemment tout l’édifice conceptuel de Brague, ce dernier tente de le disqualifier de plusieurs façons. D’abord par le dénigrement, car en le qualifiant de « moniste », l’auteur insinue que le grand maître du soufisme serait un hérétique ; ensuite, en le méprisant, puisque selon l’auteur, Ibn ‘Arabi ne cherchait qu’à « vanter les expériences qui le plaçaient au-dessus des religions », et nullement à « prêcher une quelconque tolérance » ; enfin, et surtout, Brague procède à l’incrimination, en faisant valoir qu’en tant que juriste, Ibn ‘Arabi se serait prononcé en faveur du maintien des « communautés hétérodoxes dans l’humiliation (sic) ». Or, une telle accusation résulte manifestement d’une confusion entre Mohyiddin Ibn ‘Arabi, le « mystique » qui, n’étant pas mufti, n’aurait jamais pu se prononcer juridiquement sur la dhimmitude, et un autre andalou éponyme, Abu Bakr Ibn ‘Arabi, juriste et mufti qui a effectivement écrit sur le statut des dhimmis dans son Ahkam ul-qur’an !
Servir la droite la plus Bête de la fin du monde ?
Si les réponses apportées par l’auteur de La loi de Dieu sont dépourvues de valeur, en raison même de son manque de rigueur, les questions, elles, méritent qu’on s’y arrête. Éludons la question d’un « apport décisif », chicanerie infantile et secondaire. En ce qui concerne les liens entre l’islam et le terrorisme/jihadisme, la réponse a déjà été apportée : contrairement à l’idée avancée d’une « continuité », qui fait le jeu des jihadistes et d’une certaine droite, il y a bien rupture puisque le jihadisme remet en cause la Tradition institué par l’islam. Comme l’a notamment montré Daoud Riffi, le wahabbo-salafisme rejette tous les aspects de la Tradition islamique au profit d’un retour factice aux sources. Concernant l’intolérance, nous renvoyons à Reza-Shah Kezami qui a, là encore, réglé la question. Enfin, question fondamentale : l’islam connaît-il l’idée de loi naturelle ? Il faut d’abord s’élever contre l’idée de shariah comme loi positive, selon laquelle aucune interprétation de la loi n’est possible si Dieu en est l’auteur, ou encore que « Dieu est le seul législateur légitime ». D’une part, Rémi Brague semble ignorer la distinction entre la shariah et le fiqh (qui signifie étymologiquement « compréhension correcte »), soit l’interprétation de la shariah par les hommes. Si l’on définit le droit naturel par sa dualité entre la norme connue et la norme posée, alors la shariah est un type de droit naturel. Linant de Bellefonds soulignait déjà que la vraie source du droit musulman est la doctrine des fuqaha, qui est elle-même une libre réflexion sur les fondements ; il estimait donc que l’œuvre de réflexion l’emportait largement sur les textes sacrés, ce qui règle également la question de la raison en islam. Relevons également que la notion même de loi naturelle est en soi problématique car source d’erreurs, comme l’ont relevé Léo Strauss et Michel Villey parmi d’autres, lui préférant l’idée de droit naturel bien compris.
Enfin, pour répondre au fond du sujet, il suffit de citer « ce mystique » qu’est Ibn ‘Arabi. Au chapitre 262 des Futuhat, « sur la notion de shariah », Ibn ‘Arabi distingue, en s’appuyant sur les sources islamiques, deux voies dans toute shariah : l’une, qui est instituée par ordre d’Allah, et l’autre, qui est instituée par l’initiative personnelle, toutes deux étant valides car bonnes. Surtout, il s’appuie sur plusieurs hadiths pour conclure que « quiconque pratique les nobles caractères se trouve sur une voie légale (shar’) émanant de son Seigneur, même s’il ne le sait pas ». Il donne l’exemple du Prophète qui dit à un homme bienfaisait « tu as déjà pratiqué l’islam (aslamta) par tout ce que tu as fait comme bien (avant sa conversion) ». Ibn ‘Arabi conclut ainsi : « La shariah, si tu ne la comprends pas de cette façon, tu ne la comprends pas du tout. » Certes, on pourrait rétorquer qu’une telle conception n’est pas partagée ; or n’est pas le cas, et pour ne citer qu’un exemple extrême, le juriste hanbalite Ibn Taymiyya, aux antipodes d’Ibn ‘Arabi dont il est presque contemporain (XIIIe siècle), l’a approuvé quant à la shariah. Notons enfin que le fait de revêtir les « nobles caractères » s’entend comme le fait de se revêtir des qualités divines, par quoi l’on comprend que l’essence de la shariah, et donc le « but dernier de l’islam », à l’aune duquel tout devrait être compris, à commencer par ses propres représentants dans une époque où la religion souffre de déviations et de formes sclérosées dont nous aurons à reparler, n’est ni d’ « imposer sa volonté », ni la « force » bête et méchante, mais bien la réalisation des caractères divins de l’homme.
Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.