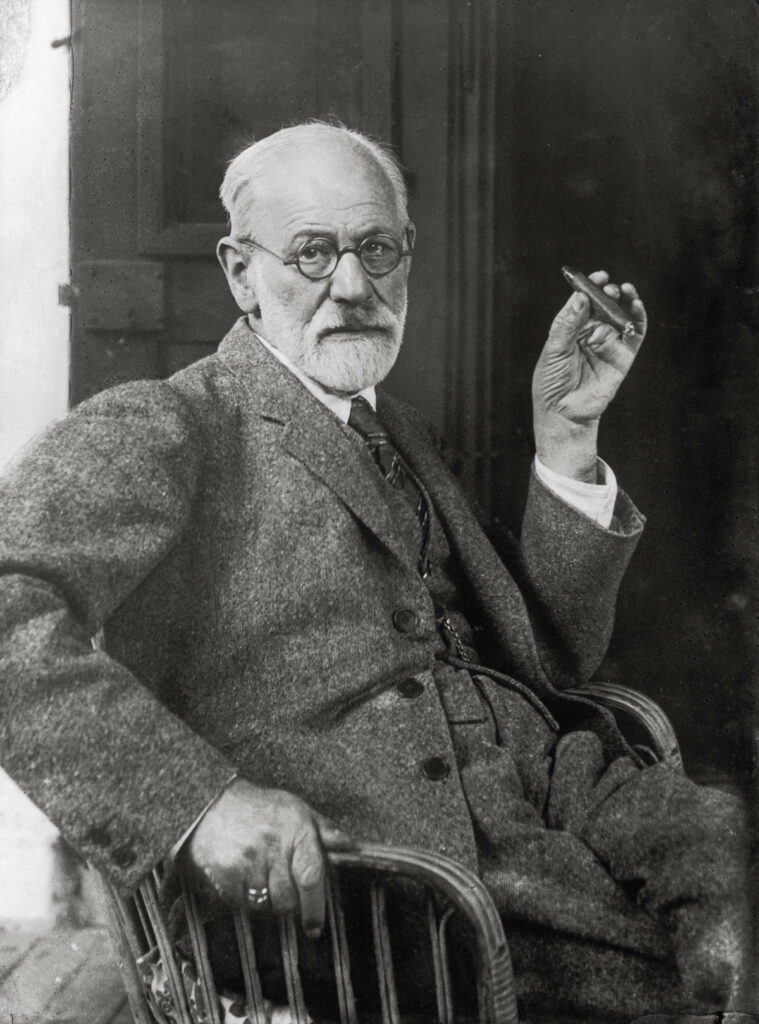La collection Théôria chez L’Harmattan poursuit la réédition de l’œuvre complète du philosophe et artiste-peintre Frithjof Schuon. À rebours d’une compréhension trop théorique et restrictive de la métaphysique telle qu’elle s’est développée dans l’histoire de la philosophie continentale, l’auteur du Résumé de métaphysique intégrale, originairement paru en 1985, l’intègre au développement intégral de l’être humain par un retour aux sources traditionnelles de la spiritualité, par-delà certaines limitations conceptuelles et confessionnelles classiques de la pensée occidentale.
Le Résumé de métaphysique intégrale de Frithjof Schuon suit une tripartition qui conduit le lecteur de l’universel, le « monde des Principes », au particulier, le « monde de l’Âme », en passant par le « monde de la Tradition ». Celui-ci fait la nécessaire médiation entre les deux pôles spirituels qui vont du Divin à l’Humain, dont l’auteur a rappelé l’égale importance quatre ans plus tôt, en 1985, ou, en d’autres termes, de l’absolu au relatif, dont le discernement est le critère essentiel de toute métaphysique rigoureuse selon Schuon. Cette tripartition pourrait passer pour une restauration de la « métaphysique spéciale » qui, dans le Moyen Âge occidental, se différenciait de la « métaphysique générale » par sa constitution progressive en trois sciences : la théologie rationnelle, science de l’être subsistant par soi (Dieu) ; la cosmologie rationnelle, science du monde ; et la psychologie rationnelle, science de l’âme. Pourtant, si Schuon reconnaît volontiers que « la scolastique fut une première tentative – particulièrement réussie – de réhabilitation de l’intellectualité », son exposé ne se borne ni à l’ontologie, cette science de l’Être qui était l’horizon de la métaphysique générale au Moyen Âge, ni non plus au périmètre conceptuel classique de la dogmatique chrétienne.
Schuon reprend le concept guénonien de « métaphysique intégrale » afin d’élargir à la fois verticalement et horizontalement la perspective métaphysique : verticalement, en l’affranchissant de sa limitation à l’Être pour l’ouvrir à l’Infini (au Sur-Être) ; horizontalement, par la mise en place de ce que Patrick Laude nommait un « vocabulaire intertraditionnel », qui enrichit les concepts de la tradition occidentale par ceux des doctrines orientales, aussi bien islamique qu’hindoue, bouddhique et taoïste. Le métaphysicien artiste, qui souligne que « la connaissance, en langage islamique, opère une “dilatation” (inshirâh) », replace ainsi la métaphysique sous le signe de l’élargissement et de la respiration d’un corps et d’un cœur ouverts sur la grande plaine de la vérité.
De la tête au cœur
Le corps et le cœur disons-nous, et non la tête. Ceci peut certes étonner, si l’on se borne à constater la technique conceptuelle qui est requise par tout exposé spéculatif de métaphysique. En réalité, quoique techniquement et propédeutiquement inévitable et rigoureux, Schuon considère que le concept est un moment provisoire, et la spéculation comme un moyen ancillaire, à une compréhension plus profonde, à fois opérative (rituelle et pratique) et intuitive. Pour ce faire, Schuon prend le contrepied de Kant qui inversait la hiérarchie des facultés humaines en concevant la raison comme la faculté suprême, supérieure à l’entendement. C’était oublier que la Tradition, d’Augustin à Thomas d’Aquin, soumettait au contraire la raison, faculté analytique ou discursive associée à l’activité du cerveau, à l’intellect, faculté synthétique ou intuitive associée au cœur (en arabe qalb). L’intellect n’est pas la raison : « normalement, commente Schuon, l’intelligence doit siéger, non dans le seul mental, mais aussi dans le cœur, et elle doit également se répartir dans le corps entier », comme on en trouve un exemple anthropologique chez certains « hommes dits “primitifs”, mais incontestablement supérieurs sous certains rapports aux ultra-civilisés ». Au lieu de cela, « l’Européen, qui a toujours été un cérébral, l’est devenu infiniment davantage depuis un ou deux siècles environ ; or cette concentration de toute l’intelligence sur la tête a quelque chose d’anormal, et les hypertrophies qui en résultent ne constituent pas une supériorité, malgré leur efficacité en certains domaines. »
Contre cette domination rationaliste du cérébral sur le cordial, Schuon réhabilite ce qui à la fois accompagne et fonde la connaissance rationnelle et scientifique : respectivement, l’émotion et l’intuition. Du côté de l’émotion, Schuon récuse la manière que l’on a d’associer l’objectivité au « ton » ou à la « mimique ». Ceci est une erreur, puisqu’il est absurde de « vante[r] l’ “objectivité” d’un homme qui affirme calmement et froidement que deux et deux font cinq », et d’ « accuse[r] de subjectivité ou d’émotivité l’homme qui réplique avec indignation que deux et deux font quatre ». La vérité est en fait que l’objectivité « est indépendante de la présence, ou de l’absence, de l’élément sentimental » du sujet, puisqu’elle dépend au contraire de l’adéquation, ou non, du jugement avec l’objet. Certes, Schuon avertit combien les passions peuvent altérer l’intelligence, de sorte que le « sens péjoratif » de l’émotion se justifie quand elle « détermine la pensée » ; mais il invite aussi à faire droit à son « sens neutre, quand l’émotion ne fait qu’accompagner, ou souligner, une pensée juste ». C’est pourquoi la connaissance est psychologiquement solidaire de l’amour, et l’amour une forme de connaissance : dans un certain ordre de cas, en effet, « l’émotion ou le sentiment est un mode d’assimilation », car « d’une part, nous admirons une chose à juste titre parce que nous la comprenons ; d’autre part, nous comprenons une chose admirable en l’admirant, c’est-à-dire que notre admiration élargit et approfondit notre compréhension première. »
Du côté de l’intuition, Schuon montre comment la « pseudo-gnose rationaliste » contemporaine, en séparant la connaissance et l’amour, a réduit l’intelligence à son aspect purement analytique, objectiviste, se trouvant exclue des états du sujet. Réciproquement, le sentiment s’est alors trouvé exilé hors des critères de vérité et d’objectivation. Rationalisme et sentimentalisme se justifient donc l’un l’autre ! Contre ces opposés gémellaires, Schuon retrouve l’origine intuitive, à la fois synthétique et intégratrice, de l’intelligence : « dire que la volonté libre et la sensibilité morale font partie de l’intelligence de l’homo sapiens, signifie qu’il n’y a pas de connaissance métaphysique conséquente et plénière sans la participation des deux facultés volitive et affective ; connaître tout à fait, c’est être. » La connaissance nécessite la participation de toutes les puissances de l’être, qu’elle constitue et transforme entièrement. Contemporain de l’« intuitivisme » russe (интуитиви́зм), Schuon prolonge ainsi l’intellectualisme de son maître français René Guénon, qui, contre le rationalisme et le sentimentalisme, enseignait, dans son Introduction Générale à l’étude des doctrines hindoues, que « l’acte de la connaissance présente deux faces inséparables : s’il est identification du sujet à l’objet, il est aussi, et par là même, assimilation de l’objet par le sujet : en atteignant les choses dans leur essence, nous les “réalisons”, dans toute la force de ce mot, comme des états ou des modalités de notre être propre ».
Perspectivisme
En soutenant cette doctrine de la réalisation par la connaissance, Schuon ne se contente pas des limites inhérentes au réalisme aristotélicien. Pour être intégrale, la métaphysique doit en effet retrouver le sens des proportions, qui fait défaut lorsque l’on oublie trois notions : « premièrement celle de “Relativité” universelle (Mâyâ), deuxièmement celle de “point de vue” de la part du connaissant ; et troisièmement celle d’ “aspect” en ce qui concerne le connu. » L’essence que l’homme est capable de comprendre, il ne la saisit pas sous une seule perspective, mais sous la pluralité de ses aspects, du côté de l’objet, ou de ses points de vue, du côté du sujet. Schuon apprend des doctrines de l’Inde le caractère pluriel ou perspectif de l’existence, enseigné dans le Moyen Âge chrétien par des philosophes tels que Nicolas de Cues (sur les « conjectures » par lesquelles on étudie le monde) ou son disciple Charles de Bovelles (qui contemplait la réalité à travers la multiplicité de ses degrés).
Le réalisme perspectiviste de Schuon constitue donc à la fois une ontologie et une épistémologie des perspectives : la réalité est plurielle, comme est plurielle la façon qu’ont les créatures de la comprendre. Ni moniste ni relativiste, Schuon considère que le centre unique de la vérité se laisse connaître par la diversité des rayons partant de la périphérie. La théologie des religions s’en trouve alors réévaluée : « la religion elle-même présente ce caractère à l’égard de la vérité totale, ce qu’exprime précisément le terme bouddhique Upâya, que l’on pourrait rendre par “stratagème spirituel” (Kunstgriff en allemand) ou par “mirage salvateur” », par lequel Dieu se laisse connaître, au sein de chaque religion, à travers une « Idée-force » qui les définit. Par exemple, le christianisme se fonde sur l’idée-force du nom du Christ, par l’emploi duquel on signifie que « le mystère de la manifestation salvatrice prime tout » : en ce contexte, au point de vue de la foi chrétienne, « il n’y a qu’une seule vérité décisive, à savoir que “Dieu est devenu homme afin que l’homme devienne Dieu” », selon l’adage des Pères de l’Église, ce qui suffit à comprendre en quoi la prétention du chrétien est légitime lorsqu’il affirme qu’hors de l’Église, pas de salut. En revanche, l’islam se fonde sur une autre idée-force : celle du nom d’Allah, qui exprime le « postulat du Dieu-Un », autrement dit l’ « évidence fulgurante de l’Absolu, du Principe unique, indivisible, inviolable et invincible ». Cette dernière implique la « certitude absolue de l’absolue ».
Dans ces conditions, on peut se demander comment s’explique le fait que le chrétien et le musulman moyens soient a priori convaincus de la vérité exclusive de leur propre religion. En fait, l’explication psychologique par la malhonnêteté n’est pas satisfaisante. En soulignant le jeu des « idées-force » qui définissent l’identité de chaque religion, Schuon justifie métaphysiquement l’incommensurabilité des systèmes religieux. Si les individus peuvent accidentellement accéder au point de vue d’autres croyants au point d’en embrasser un nouveau, il n’en reste pas moins que « chaque religion est un système, non seulement dogmatique, mythologique et méthodique, mais aussi cosmique et eschatologique. » Or, il est logiquement évident qu’ « on ne peut pas mesurer les valeurs d’un système avec les mesures d’un autre système ». Cette incommensurabilité des systèmes religieux permet à Schuon de justifier humblement la pluralité inamissible des voies d’accès à la vérité divine, par opposition à l’indifférentisme et au relativisme profanes à l’égard de la vérité : « Reconnaître la validité de toutes les religions est certes une attitude louable, à condition que ce ne soit pas au nom d’un psychologisme qui réduit le surnaturel au naturel, à condition aussi qu’on exclue les pseudo-religions et les pseudo-spiritualités ; ce qu’un certain “œcuménisme” semble ignorer. Universalisme n’est ni “humanisme” ni indifférentisme. »
Psychologies
Pour comprendre les diverses hiérophanies ou manifestations du sacré ainsi que la possibilité d’en faire l’expérience au cœur de l’être, Schuon s’oppose vigoureusement au réductionnisme psychologique, qui prétend expliquer la genèse des phénomènes religieux par d’obscures causes psychiques : « ce qui est nouveau dans la psychanalyse et qui en fait la sinistre originalité, c’est le parti pris de réduire tout réflexe ou toute disposition de l’âme à des causes mesquines et d’exclure les facteurs spirituels ». Schuon s’oppose en effet tout particulièrement à la psychanalyse, à une époque où son déficit de scientificité n’égalait pas encore son prestige tenace. Bien des indices montrent que la psychanalyse est une tentative contradictoire et dangereuse de remplacement de la religion. Or « tout argument psychanalyste […] passe à côté du problème, car la question qui se pose n’est pas de savoir quel peut être le conditionnement psychologique d’une attitude, mais bien au contraire quel en est le résultat. » C’est là ce qui la différencie essentiellement de la psychologie traditionnelle. Spirituellement, ses conséquences peuvent être désastreuses : « au lieu d’abolir le péché, elle abolira la mauvaise conscience, ce qui permet d’aller sereinement en enfer ».
À cette façon parodique de concevoir l’introspection, Schuon oppose donc son original : celui de la psychologie traditionnelle, « qu’on appelle “examen de conscience” [dans le catholicisme] ou, chez les musulmans, “science des pensées” (ilm el-khawâtîr), ou « investigation » (vichâra) chez les Hindous ». Selon ces pratiques psychologiques traditionnelles, « pour se guérir l’homme doit détecter [s]es complexes et les traduire en formules claires, il doit donc devenir conscient des erreurs subconscientes et les neutraliser au moyen d’affirmations opposées ». La psychologie traditionnelle se comprend donc comme « science des vertus et des vices », ce qui explique d’ailleurs la polysémie du mot « moral » qui reçoit une double signification psychologique et éthique selon ses usages. Ainsi, dans la mesure où le « monde de l’Âme » tient sa réalité du « monde des Principes », la psychologie en contexte traditionnel se justifie par sa fonction spirituelle, qui est la culture de l’objectivité vis-à-vis de soi-même : « l’intelligence se combine étroitement avec la vertu dans la mesure où, étant fidèle à sa nature intime, elle est “objectivité”, donc détachement et impartialité ». Ainsi « l’homme doué d’objectivité possède par là même la faculté de se regarder comme s’il était un autre ». Être vertueux, c’est être subjectivement objectif : c’est interroger la bonté et la malice de ses pensées et de ses actes, afin que, réalisant progressivement l’unité de la pensée, et l’unité entre la pensée et l’action, l’homme réalise dans le microcosme de son âme la divine Unité qui, dans le macrocosme, ordonne et illumine l’univers entier.
Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.