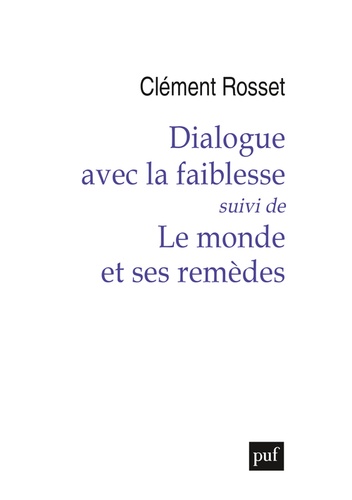Philosophe pessimiste et joyeux décédé en 2018, Clément Rosset est notamment l’auteur du Réel et son double (1976). Dans Dialogue avec la faiblesse (PUF), texte inédit rédigé entre 1960 et 1961, le penseur tributaire de Nietzsche et Schopenhauer prend le contre-pied de vingt siècles de christianisme : la morale, loin d’aider les hommes, les affaiblit en envoyant une fin de non-recevoir à un réel à jamais tragique. Partisan de la vertu éthique, à entendre comme force face à la dureté du monde, Rosset nous encourage à embrasser l’existence en dépit de toutes ses vicissitudes.
D’emblée, Rosset procède à une généalogie de la « pensée morale » : farouchement attachée à son bien-fondé, cette dernière est adoptée par l’opinion occidentale commune sans qu’elle soit remise en cause. Débutant avec Platon, cette vision du monde considère l’immanence comme défaillante : l’ici-bas ne suffisant pas, le disciple de Socrate fait de ce dernier un pâle reflet d’un monde parfait, celui des Formes. Quant à Kant et Rousseau, héritiers du christianisme, ils cherchent à fonder une morale du devoir-être à opposer à l’état des choses.
Rosset, s’il critique cette trajectoire philosophique pour son aspect émollient et mensonger, reproche également à celle-ci sa prétention à l’objectivité : la morale universelle pourrait être fondée en raison. Or, il n’en est rien. Le penseur tragique attribue ce penchant moraliste à une passion humaine fondamentale : la peur. L’idée qu’il puisse y avoir un réel déplaisant et injustifiable demeure un scandale pour le commun des mortels. Afin de pallier à cet affect, le religieux, le philosophe, en somme, tous les pourvoyeurs de sens, cherchent à tout prix à subordonner le réel au rationnel. La terreur ressentie face à un donné, stricto sensu, anarchique doit passer, et pour cela tous les moyens sont permis, y compris les plus délirants.
Rosset préconise de se heurter à l’être dans toute sa souveraineté, sans user de biais moraux : ce qui est est, ce qui n’est pas, n’est pas. Il y a dans le désir humain un certain nombre d’aspirations qui demeureront à jamais insatisfaites : c’est ce que l’auteur nomme le tragique. Fondamentalement seul, l’homme bâtit des communautés reposant sur la sympathie pour se prémunir du chaos originel ; fondamentalement mortel, il nie cette dernière par un certain nombre d’artifices dont la résurrection. Cette béance, ce manque à jamais présent, ne peut être supportable pour l’homme moral qui ne lutte pas contre ce qui le détruit.
La morale, loin d’être louable et objective, tire sa sève de ce que le philosophe nomme « l’instinct de faiblesse » que nous trouvons dans les Évangiles : « Nous ne résistons pas au méchant » (Évangile selon Saint Matthieu). Procédant à une inversion des valeurs, ces écrits ont porté un coup de grâce à la dureté éthique des paganismes adhérant au réel sans détour. Il a fallu opposer à un monde défaillant un monde plus juste : la bonté, élixir très puissant, est encore une façon de s’étourdir dans le but d’occulter l’irréconciliable inhérent à l’existence.
À ses yeux, la pitié, l’idée de mérite et l’humilité mène l’Occident à sa dérive. La première paralyse celui qui l’éprouve et le conforte dans sa faiblesse. La seconde détruit l’innocence du devenir puisqu’une action peut être libre, ce qui accrédite l’idée de péché ; prise dans un réseau causal totalitaire, l’action d’un individu est toujours soumise au jugement. Prenant sa source dans le platonisme, cette logique se durcit dans le freudisme et le marxisme, pour qui chaque acte trahit un inconscient psychique ou de classe. Enfin, l’humilité est comparée à un poison : cette conception du « qui-perd-gagne » demeure un miroir aux alouettes anti-tragique. Plutôt que de forcer les foules à supporter la difficulté d’un donné déchiré à jamais, l’humilité, pensée casanière, mène à la stase et à la poltronnerie généralisée. Contre ces tentations, Rosset nous appelle à renforcer notre orgueil : loin de la vanité qui attend l’approbation des autres, celui-ci met en permanence l’amour-propre à l’épreuve de ce qui est.
En outre, l’incompatibilité suprême entre nos aspirations et le réel est la mort : immorale par essence, elle est ce mur suprême du donné qui ne peut être ramassé dans aucun arraisonnement humain. À ce sujet, le philosophe met en lumière le rapport pathologique que la civilisation occidentale entretient avec celle-ci : occultée voire niée, elle est dissoute dans une société consumériste qui fait du monde un parc humain anti-tragique. Également, le transhumanisme, pariant sur l’immortalité possible de l’Homme, représente de façon caricaturale cette tendance de notre société marchande.
Enfin, Rosset n’épargne pas une lâcheté parmi d’autres, celle du scepticisme : déçu par l’amour, l’ancien amoureux veut s’épargner le tragique de celui-ci en dévaluant ce sentiment. Or, le penseur accorde toute sa place à la force des sentiments : une vie pleinement humaine doit comporter des aspirations très fortes puis des déceptions. En somme, il s’agit de prendre le réel « en pleine tête ».
Éloge de la dureté
Loin du « tout ce qui est réel est rationnel » hégélien, Rosset éclaire la misère de notre condition : la mort nous ramène à notre animalité, au fait que nous soyons une chose. Dépendant d’un ordre sans fondement, nous n’avons pas d’autre choix que d’adhérer à une nécessité contingente. Or, ce qui fait notre fierté, c’est notre capacité à surmonter la honte première devant notre impuissance : paradoxalement, cet affront du tragique et de notre insignifiance nous pousse à la plus grande des responsabilités : « J’accepte d’être homme avec toutes les charges et douleurs que cette situation comporte – j’en assume la responsabilité. »
Ce qui fait de nous des hommes, c’est de rester droit et fier malgré la tragédie dans laquelle nous sommes jetés : ce surpassement de la honte se retrouve dans les initiations anthropologiques. Avant de faire pleinement partie d’une communauté humaine, les individus sont souvent soumis à de rudes épreuves. Cependant, ce rapport au tragique a été malmené par de nombreux siècles de pensée morale qui a mis au cœur de notre civilisation un « manque éthique » : celui-ci a hissé la faiblesse devant la honte au rang de valeur occidentale suprême. Afin de sauver la fierté nécessaire pour affronter la dureté de ce qui est, nous devons accepter la honte pour, in fine, la surmonter. Il faut, dit Rosset, avoir « honte devant la honte » et retrouver notre antique candeur. À la manière de Nietzsche, l’auteur critique le socratisme et le christianisme qui ont mené à la fébrilité dont nous souffrons.
À l’opposé des tendances actuelles, l’auteur fait une apologie étonnante de la dureté envers soi-même, et de ce qu’il nomme la vertu, dont il faut rappeler qu’elle renvoie originairement à la force (vir). Afin d’ancrer sa réflexion dans les débats de son époque, Rosset brocarde avec véhémence les conséquences de la pensée morale au sein de l’éducation : corrompus par un rousseauisme souhaitant épargner les enfants de la difficulté de l’instruction classique et considérant l’apprentissage des fables comme un moyen de pervertir l’enfant naturellement bon, les élèves baignent dans une atmosphère intellectuelle émolliente qui leur épargne la difficulté nécessaire à l’apprentissage. Par exemple, l’exclusion progressive des humanités grecques et latines des programmes scolaires en raison de leur élitisme supposé corrobore le propos du philosophe.
Rosset nous avertit des conséquences néfastes de ce genre de travers : le réel était, est, et restera tragique, et toutes les tentatives pour contrer celui-ci resteront à jamais infructueuses. Ainsi, ce qui est ne change pas mais notre manière d’assumer la difficulté de l’existence peut être modifiée en forgeant notre caractère.
Cette volonté échevelée de faire plaisir à tout prix, présente aussi dans l’éducation des jeunes Américains, peut amener au pire : à force de vouloir noyer les enfants sous le sucre et le miel, la négativité propre à notre condition ne peut que ressortir sous des formes effroyables. Rosset donne l’exemple parlant d’un jeune enfant qui a assassiné ses parents qui voulaient à tout prix lui faire plaisir. Non sans provocation, l’auteur dénonce une civilisation qui crève de bonheur : si d’aucuns attribuent la baisse de la natalité et l’augmentation de la dépression à la difficulté sociale, Rosset l’impute au contraire à une tyrannie morale qui exacerbe le bonheur au détriment de la joie tragique.
Enfin, une autre conséquence accompagne cet effondrement du tragique en Occident : la perte de la pudeur et de la fierté. Trop auguste, la première contredit cette philosophie hédoniste qui meut les peuples empreints de progressisme anti-tragique ; quant à la seconde, elle est ruinée par l’humilité excessive de nos contemporains qui n’ont plus honte devant la honte.
Soyez heureux : tout va mal
Peu enclin à la croyance naïve dans le libre-arbitre, Rosset nous rappelle notre place infime dans un ordre intemporel sans commencement ni fin, à l’intérieur duquel nous sommes placés d’office : en effet, le philosophe nous compare à des esclaves sans maîtres ; nous sommes d’emblée dépendants d’un tout gigantesque et dénué de principe. Ainsi, toute idée de finalité consciente devient risible : « Je me retrouve tout seul, maille imbécile d’une chaîne dont j’ignore si elle a seulement un commencement et une fin, si la nécessité qui se moque de mon vouloir est seulement empreinte elle-même d’un vouloir quelconque. »
Si le thuriféraire de la liberté contemporaine peut se retrouver désœuvré face à de telles conclusions, l’auteur nous fait part de son respect pour ce que nous nommons communément « les valeurs traditionnelles ». Pris dans une immense trame acosmique, l’individu concret en chair et en os est d’abord un être en lien avec ses racines, sa famille, sa femme et avec son pays. Raillé par les modernes, cet enracinement est loué par Rosset qui voit dans cette vie une expression très vive de l’amour de l’existence en dépit de toutes ses tares. L’instinct religieux qui pousse les hommes à dire « ainsi soit-il » accompagne parfaitement cet instinct vital d’acquiescement à ce conte raconté par un fou ne signifiant rien. Cette acceptation de la nécessité qui est à elle-même sa raison d’être est nécessaire à la vie : nous devons abdiquer devant elle pour atteindre la joie. À la différence du bonheur, la joie est donnée de surcroît, elle surgit de nulle part comme une grâce. En somme, le premier est anti-tragique tandis que la seconde prend en compte l’aspect déchiré de l’existence humaine.
La formule « De l’être, rien de plus » résume la position de Rosset : le donné est gratuit, il est un don brut et silencieux. À l’inverse de la moraline, la religion est cette capacité qu’a l’homme d’assumer ce donné chatoyant et muet. Dans ce cadre-là, il est naturel de repérer dans les structures normatives bâties par l’homme de nombreuses tentatives chimériques de faire parler un monde qui demeure fondamentalement étranger à nos aspirations les plus profondes.
Exigeant et roboratif, cet ouvrage de Rosset cherche à battre en brèche la vision morale du monde, « cet enduit qui nous rend imperméable à la grâce » dont parlait Péguy. À rebours de vingt siècles occidentaux marqués par le christianisme, le pessimiste joyeux nous enjoint à embrasser la vertu éthique de la dureté face à l’inéluctabilité du tragique de notre condition.
Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.
Crédits photo : Edouard Caupeil / Pasco