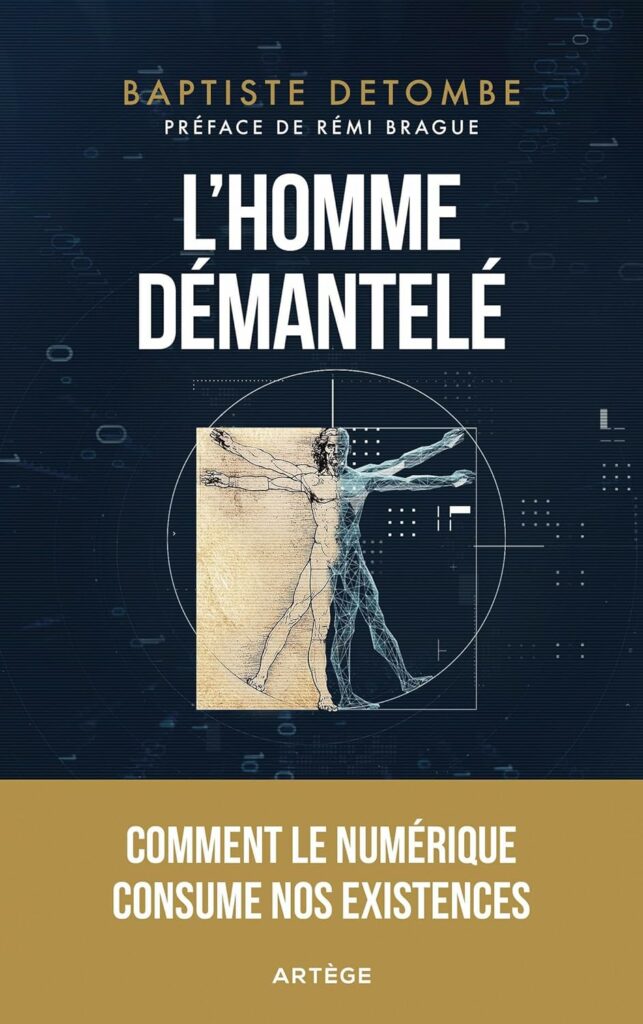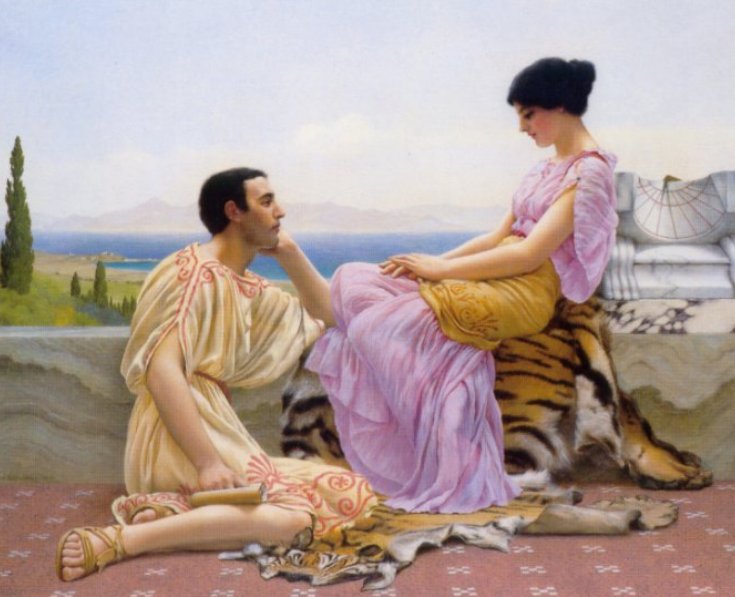Baptiste Detombe est le fondateur du média étudiant Gavroche, et intervient dans les colonnes de certains périodiques sur les questions relatives au numérique. Il a récemment publié L’Homme démantelé (Artège, 2025), dans lequel il tente de déchiffrer l’espace dans lequel se meut notre existence de plus en plus virtualisée, en montrant à quel point la reconfiguration du réel induite par le numérique ronge peu à peu de l’intérieur certaines de nos expériences anthropologiques les plus élémentaires, tant dans notre construction identitaire que dans notre rapport à l’altérité.
PHILITT : Votre ouvrage est sous-titré « Comment le numérique consume nos existences ». Pour commencer, pouvez-vous clarifier ce que vous entendez par « numérique » ? Votre livre embrasse beaucoup de domaines : les réseaux sociaux, YouTube, les jeux vidéo, Google, Amazon, la pornographie… N’y a-t-il pas un flou conceptuel autour de l’idée du numérique ?
Je fais dans cet ouvrage le pari que le numérique forme un tout, un monde à part entière. Or, je ne suis pas le seul à le faire. Le rapport de 2024 « Enfants et écrans. À la recherche du temps perdu » parle bien d’une « migration » du réel vers le virtuel. Nous assistons à l’avènement d’un nouvel espace social dans lequel nous interagissons, établissons des habitudes, fixons des référents. Ce nouveau monde n’est rien d’autre que le produit des excroissances techniques ouvrant à l’homme une réalité impalpable, désensualisée – c’est-à-dire dans laquelle nous ne faisons que peu l’usage de nos sens – qui parvient pourtant à nous happer. Dans cet espace virtuel les frontières ont été abolies, les désirs deviennent illimités et l’instantanéité la norme. Plus encore, le numérique est un lieu d’exposition de soi, de manifestation permanente de sa présence sociale. Même des applications que l’on pensait épargnées suivent cette tendance : Google Maps permet de donner son avis, son évaluation de chaque lieu.
De plus, j’ai volontairement évité les distinctions peu opérantes. Tout l’objectif du livre est de cesser les visions parcellaires parce que centrées sur un épiphénomène, à l’image des nombreux articles ou travaux sur TikTok. Il m’importait de montrer un effet de système. Le monde numérique agit en système, c’est-à-dire, qu’il est enserré dans des règles communes de fonctionnement (captation du temps d’attention, forte proportion de divertissement, propension à montrer des contenus sexuels ou violents, faible charge cognitive des contenus, etc.). Ce système est d’autant plus visible lorsque l’on relève la tendance à l’homogénéisation de l’ensemble des plateformes numériques. Cela s’explique par la dynamique concurrentielle dans laquelle les ces dernières sont entraînées : pour exister, gagner du temps de cerveau disponible, elles n’ont d’autres choix que de répliquer les procédés de captation de l’attention les plus efficaces, comme de flatter les égos pour mieux accrocher. C’est ainsi que les vidéos courtes de TikTok ont débarqué sous la forme de « Réels » dans Instagram puis de « Shorts » sur YouTube.
Des esprits facétieux souligneraient qu’il y a ici amalgame entre les types d’écrans. Encore une fois, je crois que c’est se leurrer de vouloir distinguer ce qui relève de la même substance. Plus de 80 % des familles sont aujourd’hui équipées de télévisions connectées (« SmartTV »), qui sont, dans leurs usages, peu différentes de ce que proposent des smartphones. Le monde numérique avance en bloc pris dans une logique concurrentielle qui le dépasse : les écrans qui ne s’y plieront pas seront inévitablement démodés. En cela, l’avènement du monde numérique relève de la tragédie.
Vous écrivez que l’avènement du monde numérique signe une mutation anthropologique majeure, avec un bouleversement des conditions de vie, d’interaction et d’existence de l’humanité. En quoi le numérique est-il anthropologiquement révolutionnaire ?
Le numérique déjà offre une nouvelle expérience du réel. Ce réel est marqué par deux aspects essentiels : d’abord, il est désensualisé, nous n’y faisons que peu l’usage de nos sens, l’odorat y est banni, le toucher sous-stimulé par la même surface lisse, le regard – confronté aux pixels – reste, de tous les sens, le plus mobilisé. Ensuite, nous vivons dans le monde numérique avec un rapport d’extériorité : nous assistons à des scènes (randonnées dans les Alpes, accidents de voiture, soirées entre amis…) sans jamais en être acteurs. Pour la première fois, nous vivons par procuration à l’échelle industrielle. Tout est perçu moins intensément, moins vivement. Ce vécu numérique est, en cela, structurellement appauvri.
Plus encore, le monde numérique reconfigure notre rapport au réel. Il abolit les frontières entre les contenus et, en cela, favorise une incapacité à se fixer à un référentiel identitaire et social, ainsi qu’à discriminer, hiérarchiser, ce que nous voyons. Le relativisme structurel est aussi la conséquence d’un monde numérique hégémonique, ce dernier étant par définition mouvant et informe. En étant accoutumé à tout voir, plus rien ne nous émerveille, plus rien ne nous choque. D’une anthropologie de l’émerveillement continu face aux phénomènes naturels et humains, nous sommes tombés dans une anthropologie de la lassitude blasée.
Enfin, le monde numérique, fondé sur la mise en avant d’un « profil », nous amène à nous plonger dans la mise en comparaison perpétuelle. Par sa structure même, le réseau, qui est l’essence même du « net », nous sommes contraints à la concurrence sociale généralisée. L’étymologie de numérique, « numerus », qui veut dire « nombre » témoigne de cela : toute notre vie sociale peut être quantifiée désormais. Le nombre d’amis ou d’abonnés que nous avons, autant que notre désirabilité, notre aura sociale. Bref, le monde numérique produit un monde du quantifiable mis au service de la promotion de soi. Seulement, le plus souvent, cela se traduit par la constatation de notre insignifiance.
En ce sens, l’avènement du monde numérique n’est-il pas l’aboutissement logique du projet moderne d’autonomie individuelle ? Le numérique ne permet-il pas de concrétiser le projet de « jouissance paisible dans l’indépendance privée » dont nous parle Benjamin Constant ? Le repli sur soi engendré par le numérique n’est-il pas, en définitive, une forme d’accomplissement désiré par l’individu moderne ?

Tout mon propos dans l’ouvrage est de montrer que l’individualité n’est pas un donné, mais un acquis civilisationnel. Nous le devons en grande partie à l’héritage chrétien. Ce dernier, en faisant du salut de l’âme une opération individuelle dont nous étions pleinement responsables, en individualisant la confession au XIIIe siècle, en promouvant la foi vivante dans le cœur sur le rite, a laissé place à l’avènement de la « personne ». À cela s’ajoute le rôle de l’Église, qui a permis le développement des institutions extrafamiliales à l’image des monastères, et qui a évité la transformation de la famille en clan par l’interdiction des mariages incestueux. Enfin, le catholicisme, en séparant l’autorité temporelle de l’autorité spirituelle, à éviter l’écrasement de l’individu sous le poids d’un pouvoir omnipotent régissant tous les aspects de la vie humaine. Il n’en reste pas moins que le saut de la « personne » à « l’individu » a été accompli lors de la modernité. Il correspond au sacre de l’autonomie et au risque du péché d’orgueil, de l’individualité conçue comme indépendance.
En apparence, le projet moderne d’autonomie a été réalisé dans la révolution numérique. Chacun est en mesure d’inventer son « profil », de choisir ses liens sociaux, de supprimer de son réseau ceux qui l’ennuient, en bref, le réseau devient « électif » et non plus contraint. En outre, absolument toute l’interface numérique est tournée vers le projet individuel : l’algorithme doit plaire à nos centres d’intérêt, la publicité est ciblée selon nos goûts. Nous bénéficions, en somme, d’une vitrine orientée pour notre seule promotion.
De plus, le numérique donne l’illusion de l’omnipotence et donc de l’indépendance. Si tant est que je me perds, Google Maps pourra m’orienter, il ne m’est plus utile de demander mon chemin à quiconque. De la même manière, si j’ai besoin que l’on déménage mon appartement, des applications se chargent de trouver des déménageurs pour me satisfaire, plus besoin de faire appel à des amis. Bref, le smartphone, en répondant à tous nos besoins de manière instantanée, semble nous délier des autres.
Seulement, c’est là que le bât blesse. À mon sens, le numérique se retourne contre le projet moderne qu’il était censé servir. Plutôt que de nous émanciper, il nous incite à nous réfugier dans des identités factices et caricaturées, lassés par le flou identitaire qu’il crée et le relativisme culturel qu’il génère. L’incapacité à s’identifier pousse dans les bras de communautés, elles-mêmes renforcées par le phénomène des « bulles de filtre ». À force d’orienter le contenu consommé selon nos opinions, nous finissons par ne devenir que les moutons de Panurge d’un clan, d’une communauté.
De nombreux symptômes témoignent de notre incapacité à penser singulièrement. Le conformisme des corps qui règne via le bodybuilding est un symptôme d’une intolérance croissante pour la différence, de la même manière que la multiplication des troubles –dys (dyslexie, dyspraxie…) est aussi un témoignage d’une différence en permanence conçue comme pathologique. La norme numérique, parce qu’elle a aboli les frontières de l’espace et du temps, s’impose à nous en permanence et nous rend plus machinaux que nous ne l’avons jamais été.
Le numérique est-il la cause de notre enfermement et de notre déliaison sociale ? Ou est-ce parce que l’homme moderne souhaite avant tout vivre dans l’ « indépendance privée » qu’il a été heureux de trouver des espaces fictifs de sociabilité numérique qui lui ont ensuite permis de se replier sur lui-même ?
Le numérique est venu remplir un vide. Face à l’effondrement des montages symboliques structurants qu’étaient la religion, la nation, la vie villageoise, il a fallu proposer un nouvel idéal vers lequel tendre. La mort des utopies après la victoire pronostiquée, mais aussi fantasmée, par Francis Fukuyama de la démocratie libérale et de la société de consommation, devait se traduire par la recherche frénétique d’un nouvel élan. Les nouvelles technologies ont semblé – un temps – pouvoir remplir ce besoin de sens, former cette nouvelle locomotive à laquelle se raccrocher. Ce qu’il faut comprendre, c’est que la toute-puissance sociale du numérique a été permise par un climat de lassitude, de solitude croissante des individus perdus dans un monde dénué d’imaginaire commun.
Pour autant, la désillusion n’a pas tardé à se manifester. Les connexions multiples que nous faisions sur les réseaux pour créer du lien se sont heurtées à la limite anthropologique des 150 personnes avec lesquelles nous pouvons établir des liens de confiance réciproques au maximum. La dilution des sociabilités de proximité (parents, voisins, collègues…) au profit de liens virtuels n’a pas permis de remplacer la présence éthique de l’autre, toujours incarnée tant par un regard que par un visage. Bref, le lien numérique ne pourra remplacer la présence, intimement conditionnée à une incarnation, ne serait-ce que sur le plan de l’activité hormonale. En effet, face à un écran, en visio, nous ne créons pas ou très peu d’ocytocine, l’hormone de l’attachement.
Si le numérique a été la fausse solution à un problème de grande échelle, il s’avère que désormais il est aussi le moteur d’une solitude chronique. Le psychologue social Jonathan Haidt relève ainsi dans son livre Génération anxieuse que depuis le début des années 2010, soit depuis que le numérique est devenu un phénomène anthropologique par la naissance du couple smartphones-réseaux sociaux, la solitude a augmenté de manière prononcée. Et pour cause, comment trouver goût à la vie sociale physique quand l’écran apporte autrement plus de stimulants qu’une rencontre ? Plus nous nous accoutumons au lien social numérique, au divertissement permanent, moins nous ressentons le besoin d’un lien social réel, autrement plus contraignant.
Le numérique est un objet paradoxal. Au XVIIe siècle déjà, Pascal dénonçait l’emprise du divertissement et écrivait que « tout le malheur des hommes vient de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre ». Désormais, le numérique a engendré un individu qui peut au contraire passer des heures seules dans sa chambre.
L’individu ne passe pas réellement des heures seules dans sa chambre lorsqu’il est connecté au monde numérique. Il vit alors une sociabilité simulée, vécue par procuration essentiellement. Il est comme enfermé dans un simulacre de lien social. L’influenceur qu’il chérit incarne pour lui une figure à laquelle s’attacher, qu’importe le caractère radicalement asymétrique de la relation. Le smartphone impose la permanence de la présence sociale. Lorsqu’il est présent, le reste de la société est présent en lui – mais toujours de manière altérée, ce qui explique la solitude chronique de l’époque. Pour autant, ce que cela révèle, c’est la disparition totale de la séparation public-privé. Nous vivons dans une zone grise, qu’importe désormais que nous soyons dans notre chambre, aux toilettes, en vacances à l’autre bout du monde. Nous subissons en permanence l’injonction de notre consommation numérique et nous sentons souvent obligés d’y répondre en produisant nous-mêmes des contenus qui révèlent notre conformité au groupe. Derrière l’écran, il y a un outil massif de conformisme qui ne dit pas son nom.
Ceci étant, c’est bien parce que l’écran emporte avec lui une part de la collectivité qu’il nous empêche de nous recueillir. Étant en permanence soumis au brouhaha du monde, aux querelles des chapelles ou au divertissement, nous sommes incapables de faire croître une vie intérieure, plus encore, une vie réflexive. Nous n’avons plus l’espace mental pour penser autre chose que notre affairement quotidien imposé par le rythme numérique. Cela donne chair à la citation de Georges Bernanos qui estimait en son temps que la modernité était une « conspiration universelle contre toute forme de vie intérieure ». Notre attention, toujours extravertie, finie par s’épuiser en quêtes stériles. Dans notre chambre nous sommes occupés, mais seulement de frivole.
Vous écrivez que « Ce qui s’envole avec la domination numérique […], c’est surtout la vie pleinement vécue.1 » Vous citez à ce propos la formule de Rousseau dans L’Émile : « L’homme qui a le plus vécu n’est pas celui qui a compté le plus d’années, mais celui qui a le plus senti la vie. Tel s’est fait enterrer à cent ans qui mourut dès la naissance. » En quoi le numérique empêche-t-il cet accès à la vie authentiquement vécue ?
Le monde numérique est un monde vécu extérieurement. Il n’imprègne pas notre mémoire car notre investissement est faible. Et cela ne peut être re-paramétrable, il en va de la nature même du virtuel. Une récente étude du MIT de 2025 montre ainsi qu’un essai rédigé à l’aide d’un support numérique, et plus encore d’une IA, n’autorise qu’une faible activité cérébrale. Par l’usage de cette excroissance numérique, nous accumulons une dette cognitive, se traduisant par une faible empreinte mémorielle des activités que nous réalisons. Le risque ultime, c’est tout bonnement de passer à côté de sa vie. De la voir défiler sans l’avoir vécue. Le scénario de la vie sans aspérités que décrit Jean-Jacques Rousseau n’est autre que le risque majeur de l’époque. Or, une vie manquée, c’est autant de frustration emmagasinée, qui peut tout à fait se déchaîner dans une violence expiatrice. À l’heure du réveil, la lucidité nouvelle face à une existence manquée ne peut que se révéler fatale. Il se pourrait que la forte anxiété et les symptômes dépressifs si significatifs à notre époque témoignent de ce phénomène.
Un autre point, est l’omniprésence du divertissement dans le monde numérique. Cela n’est pas un hasard mais la résultante d’une guerre de l’attention : pour captiver un panel le plus large possible de consommateurs, il faut des contenus à faible charge cognitive. C’est ainsi que le divertissement vient réaliser son étymologie : il nous sépare de nous-mêmes. Nous nous oublions dans un tourbillon de contenus récréatifs. Là aussi il est un risque d’une vie devenue amère à force d’avoir été laissée sur le bas-côté. Encore faut-il néanmoins se détacher de l’écran pour prendre conscience du gâchis monumental qui s’accroît sous nos yeux léthargiques.
La jeunesse est le temps de l’idéal et de la construction de soi. La vingtaine préserve encore des réflexes bourgeois et fait naître, au contraire, un désir d’absolu. Vous écrivez qu’avec l’emprise du numérique, les jeunes « se trouvent réduits au rang docile d’êtres anesthésiés par un divertissement et un plaisir lénifiants.2 » Pourquoi la jeunesse est-elle la principale victime du numérique ? Comment le numérique vient-il supprimer cet élan vital de la jeunesse ? Est-ce dramatique pour le monde ?
La jeunesse a été la cible privilégiée du monde numérique, et j’irais plus loin, la jeunesse a été la cible privilégiée du capitalisme marchand. Cela s’explique aisément : ses préférences ne sont pas fixées, alors la capacité de la publicité à faire évoluer ses habitudes de consommation est importante ; et cette époque charnière est d’autant plus significative que les habitudes fixées à un âge si précoce sont plus difficiles à déraciner. Ainsi, les goûts musicaux se fixent-ils autour de 27 ans, toute la période antérieure est alors propice aux annonces marchandes ! Et pour cause, la jeunesse dispose d’un cerveau plus plastique, en perpétuel reformation, ce qui permet d’agir très précocement sur la capacité à différer son plaisir de court-terme. Plus l’on est sensible à la récompense facile, plus l’on devient un consommateur impulsif et irréfléchi. En bref, le numérique participe à une entreprise de restructuration de la psyché de la jeunesse à la faveur d’une transformation en consommateur vide et lénifié. Le dernier point important, c’est la force grégaire de la jeunesse. La recherche permanente de la validation sociale crée un fort mouvement de mimétisme. Parvenir à influencer la consommation d’un jeune, c’est généralement s’assurer d’un fort effet multiplicateur.
Il n’est donc pas surprenant qu’elle soit la cible d’une captation de l’attention plus agressive encore, comme le révèle Frances Haugen, lanceuse d’alerte du groupe Meta, ayant rendu public nombre de documents internes à la multinationale. Cela se traduit par l’alimentation d’une addiction féroce, qui enlève l’intérêt et l’attrait pour le monde physique, pour l’investissement relationnel, pour les défis personnels et la volonté de se grandir. Je pense qu’effectivement, cela peut avoir des effets dramatiques pour le monde : il faut un élan vital important, celui de la jeunesse, pour éviter de croupir dans une inertie souvent mortifère.
Vous intitulez votre épilogue : « un autre monde est possible ». Un autre monde est-il réellement possible ? Nous savons bien qu’il est plus facile de détruire que de bâtir.
Tout changement est précédé d’une volonté. L’inertie de l’époque est ce qui rend tout discours volontariste inaudible. Pourtant, la seule force politique peut déjà, à elle seule, parvenir à rendre au numérique un périmètre plus supportable sur le plan anthropologique. La mise en place d’un âge minimal pour l’accès aux réseaux sociaux en Australie, l’interdiction des smartphones dans les enceintes des collèges et lycées aux Pays-Bas et en Italie, la « pause numérique » en France pour les écoles et collèges. L’heure de la prise de conscience est passée, désormais il ne reste plus qu’à dérouler le tapis de l’action. Pour cela, rien de mieux qu’une espérance indéracinable, ce fameux « désespoir surmonté » pour reprendre Georges Bernanos, allié à une bonne compréhension des enjeux systémiques qui pèsent sur nous. L’action parcellaire, ici, pourrait même être pire que l’action, décrédibilisant cette dernière par son inefficacité. Enfin, cet autre monde ne sera possible qu’en promouvant une résistance cognitive au numérique. Il faut des êtres qui s’arment pour protéger et développer leur intellect. Le succès de cette nouvelle élite dépendra de la capacité à s’organiser et à se rassembler pour créer de nouveaux liens de sociabilité.
Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.