Le paradoxe du défunt pape François (1936-2025) est qu’il semble laisser derrière lui une Église profondément divisée et affaiblie alors même que son pontificat s’inscrit dans une forme de conciliation et de renforcement de l’autorité de l’Église universelle. C’est que l’Église catholique, sous son pontificat, a vécu un tournant en choisissant d’investir la périphérie et la marge au détriment de la centralité romaine. Ce fut le pontificat de tous les déplacements paradoxaux : du centre romain à la périphérie, par un dirigisme romain ; du clergé vers les laïcs, par une cléricalisation accrue des laïcs ; des normaux vers les marginaux, par une normalisation des marginaux.
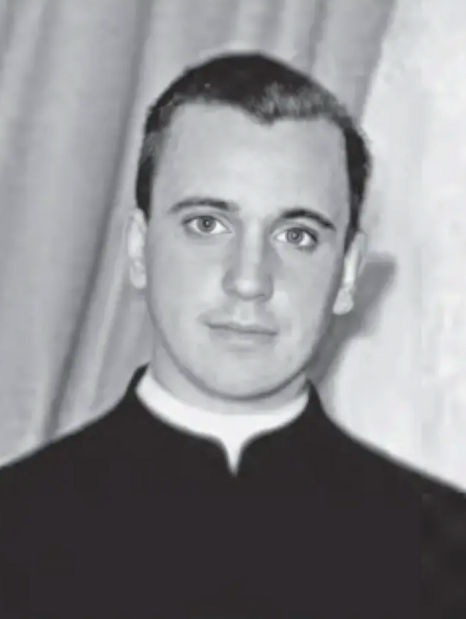
Né en 1936 à Buenos Aires de parents émigrés italiens, José Mario Bergoglio ne s’oriente pas immédiatement vers la vie sacerdotale. D’abord diplômé en chimie, ce n’est qu’à 21 ans qu’il décide d’entrer dans les ordres. Après des études de philosophie et de théologie, il est finalement ordonné prêtre à 33 ans, et entre chez les jésuites à 37 ans. C’est en 1992, à 56 ans, que Jean-Paul II le nommera évêque auxiliaire ; à partir de là, son ascension sera assez rapide : archevêque de Buenos Aires, puis cardinal en 2001, à 65 ans ; Président de la Conférence épiscopale d’Argentine, puis papable à la mort de Jean-Paul II, avant son élection en 2013. La devise qu’il se choisit comme évêque semble déjà annoncer son pontificat : Miserando atque eligendo (« par Miséricorde et par élection »), qu’il insère dans son blason avec l’emblème des Jésuites, dont il reste proche. Surnommé le pape des pauvres, son élection porte une triple rupture : premier pape américain, premier pape Jésuite mais également premier pape qui prend pour nom celui de François en hommage à saint François d’Assise. La singularité du pape François et de son pontificat se présente sous forme d’un paradoxe : en tant que relatif marginal, pape des marginaux pour une Église elle-même de plus en plus marginalisée, il s’inscrit dans son époque, à laquelle l’Église s’adapte. Mais en tant qu’il a également partie liée avec la grande et vieille histoire romaine, en tant qu’italien et en tant que Jésuite, il continue également une certaine pratique du pouvoir et de l’autorité en décalage avec l’ouverture prônée. Le pape François apparaît donc comme un pape jésuite sur la forme mais franciscain sur le fond ; un pape argentin de nationalité mais bien italien non seulement d’origine, mais de tempérament.
Théologie populaire
Le premier acte du cardinal Bergoglio est de se choisir pour nom François, rejouant l’opposition classique entre franciscains et dominicains : là où les seconds, à travers la figure de S. Thomas d’Aquin, le « docteur angélique », ont plutôt insisté sur l’ordre global et la nécessité de la Création, les franciscains, à travers l’autre grande figure intellectuelle du Moyen-Âge, Duns Scot, le « docteur subtil », ont au contraire mis l’accent sur la liberté de Dieu dans la Création et l’inaccessible Volonté divine, dans la lignée de S. François d’Assise qui s’émerveillait de chaque aspect de la Création comme d’un miracle perpétuel. Dès lors, aux yeux du pape François, la liberté divine a pour contrepartie la nécessité de chercher Dieu dans son action concrète, c’est-à-dire dans sa Création. De même que S. François a « écouté la voix de Dieu, il a écouté la voix du pauvre, il a écouté la voix du malade, il a écouté la voix de la nature », le pape François explique avoir choisi ce nom en raison de l’amour du Saint pour les pauvres, de son travail pour la paix et de sa volonté de dialogue, ce qu’il résume ainsi : « Lutter contre la pauvreté, soit matérielle, soit spirituelle ; édifier la paix et construire des ponts » à quoi il faut ajouter « un profond respect pour la Création » ; voilà qui constituent, de l’aveu même du défunt pape, « comme les points de référence » qui ne peuvent se comprendre que dans la volonté de chercher Dieu concrètement et surtout, à la marge. Ainsi la pensée théologique fût-elle repensée par François comme « une véritable connaissance critique en tant que connaissance sapientielle, non pas abstraite et idéologique, mais spirituelle, élaborée à genoux, grosse d’adoration et de prière ; une connaissance transcendante et, en même temps, attentive à la voix du peuple, donc une théologie “populaire” ».
Cette approche franciscaine et populaire est en accord avec la théologie du peuple née de la volonté des évêques argentins de continuer les enseignements de Vatican II en Amérique latine. L’idée principale, évoquée par la Commission pastorale épiscopale argentine et la déclaration de San Miguel de 1969, est que l’action de l’Église ne doit pas seulement être orientée vers le peuple mais aussi et principalement depuis le peuple lui-même. Or la notion de peuple est très ambivalente : si elle vise ici la doctrine du peuple de Dieu telle que formulée par Vatican II et en particulier Lumen Gentium, regroupant l’ensemble des catholiques, laïcs compris, elle concerne aussi le peuple dans un sens plus politique voire sociologique. Sans s’y confondre, la « théologie du peuple » se rapproche donc de la « théologie de la libération », élaborée à la même époque, en Amérique latine aussi, et influencée par les théories marxistes. Elle s’en éloigne toutefois en rejetant les éléments durs du marxisme, en particulier la lutte des classes à laquelle elle préfère la réconciliation de celles-ci dans le modèle universel du Christ. L’archevêque Bergoglio, élève de Juan Carlos Scanonne, l’un des pères de cette doctrine, a donc participé à la formulation de cette théologie, ce qui se manifeste sous son pontificat par son recours à la synodalité, dans sa lutte pour les migrants et l’identité des peuples ainsi que ses positions anticapitalistes.
En particulier, la synodalité repose sur l’idée que tout le peuple de Dieu, laïcs compris, participe à la mission de l’Église. Ce décentrement, qui contraste avec la hiérarchie verticale de l’Église universelle, confère donc une dignité théologique et un rôle particulier au peuple. Désormais, « la réflexion théologique est encouragée à se développer avec une méthode inductive, qui part des différents contextes et des situations concrètes dans lesquelles les peuples sont insérés, en se laissant sérieusement interroger par la réalité […]. Il faut donc privilégier avant tout la connaissance du sens commun du peuple, qui est en effet le lieu théologique où habitent de nombreuses images de Dieu ». Cette méthode interroge pourtant, si l’on se souvient comment la Tradition de l’Église enseigne au contraire que ces images n’en demeurent pas moins blessées et en attente d’une « méthode déductive » de guérison et de restauration. À défaut, on peut être amené à se demander quelle serait la raison d’être de la grâce si Dieu habitait déjà, en toute intégrité, dans les portions du peuple de Dieu. Quoiqu’il en soit, cohérent dans sa démarche, le pape argentin n’hésita pas à nommer des experts laïcs pour guider l’action de l’Église. Ainsi, le nouveau Conseil pour l’Économie est composé de quinze membres dont la moitié sont des experts laïcs de diverses nationalités. Cela implique également une meilleure participation des femmes, d’où diverses réformes adoptées telle que le Motu Proprio étendant aux femmes l’accès au lectorat et à l’acolytat.

Paradoxale centralisation des marginaux
En défendant une ouverture sur l’autre et le monde, en défendant les peuples et les pauvres, le pape semble adopter une théologie de la marge ou de la frontière : « L’Église est appelée à sortir d’elle-même et à aller dans les périphéries, les périphéries géographiques mais également existentielles : là où résident le mystère du péché, la douleur, l’injustice, l’ignorance, là où le religieux, la pensée, sont méprisés, là où sont toutes les misères. » Cette théologie, venue du premier pape argentin et du premier François, peut se lire comme la revanche des marges qui, intra-européennes (Ajaccio et Marseille face à Paris), sud-américaines, pauvres, ex-colonies, accèdent enfin à la centralité du pouvoir. Or, paradoxalement, la victoire politique entraîne nécessairement la défaite idéologique dès lors que le marginal perd cette qualité en accédant au centre de décision. C’est là que le premier pape jésuite prend le pas sur le pape franciscain et argentin.
En effet, l’intégration de la périphérie et des marges à l’Église au nom de sa catholicité s’est souvent faite avec autorité. C’est là paradoxalement un des traits les plus saillants du pontificat du cardinal Bergoglio : son autoritarisme, en vue de l’universalité. Il se trouve que ce sont là deux traits que l’on retrouve chez les Jésuites. La Compagnie de Jésus, fondée au XVIe par Ignace de Loyola, est née après les grandes découvertes et la conquête des Amériques. L’ordre procède donc d’un double impératif : connaître les populations indigènes pour mieux leur annoncer l’évangile et permettre leur rattachement à la centralité romaine. Chez le pape François, les références ignaciennes sont légion, notamment dans l’encyclique Dilexit nos du 24 octobre 2024. Le nom même, François, pourrait aussi faire référence à François Xavier, l’autre fondateur de l’ordre. Chez l’argentin, la doctrine Jésuite se manifeste à la fois par l’accent placé sur l’acceptation des autres cultures et l’affirmation de l’autorité de Rome.
Ce double mouvement s’illustre dans la question rituelle. Les jésuites sont en effet connus pour s’être opposés aux autres ordres lors de la querelle des rites. Cette dernière s’inscrit dans le cadre des missions menées à la périphérie du monde européen, notamment en Chine et au Japon. La controverse portait sur le degré d’adaptation et de tolérance dont il fallait faire preuve pour admettre les autres cultures dans l’Église. Alors que la plupart des missionnaires considèrent les rites impériaux, notamment la prosternation, comme une forme d’idolâtrie, les jésuites, dont Matteo Ricci en Chine et le Père Vailgnano au Japon, professent au contraire une grande tolérance en favorisant l’accommodement et donc l’adaptation aux cultures indigènes. De même, quoique dans un autre registre, le grand théologien et juriste jésuite Suarez joue un grand rôle dans le respect des peuples en estimant que Dieu ne remet pas directement le pouvoir aux monarques mais d’abord aux peuples qui, eux, remettent le pouvoir aux monarques. Les peuples doivent donc être respectés et les cultures reconnues. C’est dans l’exhortation apostolique Quérida Amazonia, « Au peuple de Dieu et aux personnes de bonne volonté », du 2 février 2020, que se manifeste le mieux cette doctrine. Le pape y affirme « le risque pour les évangélisateurs qui arrivent en un lieu […] de croire qu’ils doivent non seulement transmettre l’Évangile, mais aussi la culture dans laquelle ils ont grandi » ; au contraire, « l’inculturation élève et apporte plénitude ».
Aussi le défunt pape a-t-il eu bien conscience du caractère révolutionnaire de sa systématisation de la démarche d’inculturation, affirmant, dans son Motu Proprio Ad theologiam promovendam du 1er novembre 2023 : « La réflexion théologique est donc appelée à un tournant, à un changement de paradigme […] qui l’engage, avant tout, à être une théologie fondamentalement contextuelle, capable de lire et d’interpréter l’Évangile dans les conditions dans lesquelles les hommes et les femmes vivent quotidiennement, dans des environnements géographiques, sociaux et culturels différents et ayant comme archétype l’Incarnation du Logos éternel, son entrée dans la culture, dans la vision du monde, dans la tradition religieuse d’un peuple. » Cette révolution permet de comprendre les ruptures surprenantes et autoritaires du pape, la plus spectaculaire étant le Motu Proprio Traditionis custodes dont l’intention semble relever d’un renoncement autoritaire au latin pour mieux embrasser le reste du monde. Paradoxalement, une telle doctrine ne vise donc pas simplement à préserver un droit des peuples ; elle permet un rattachement plus large à la centralité romaine.

Intransigeante centralité romaine
Si derrière le pape franciscain réside un Jésuite, il faut également voir derrière le pape argentin un italien d’origine. Car le pape François a en effet parfaitement su investir les structures institutionnelles du pouvoir romain, jusqu’à provoquer des critiques pour son autoritarisme. L’usage du pouvoir n’est pas non plus sans lien avec les Jésuites ; ces derniers ont longtemps eu la réputation d’intrigants assoiffés de puissance. Leur rapport vertical au pouvoir se constate dans leur vœu : ils sont le seul ordre qui, en plus des trois vœux traditionnels (chasteté, pauvreté, obéissance), prononcent un quatrième vœu : l’obéissance au pape. Parvenu sur le trône pontifical, le pape François adopte le corollaire de ce vœu en réclamant une fidélité et une obéissance sans faille. C’est en partie cet autoritarisme qui a permis les réformes structurelles importantes de la Curie, que ce soit dans le domaine institutionnel avec l’organisation des dicastères et Congrégations, dans le domaine économique et financier pour l’assainissement des comptes, dans le domaine juridique avec les réformes relatives au mariage et aux rites orientaux ou encore les révisions du droit vaticanais, et surtout avec les réformes contre les abus sexuels.
Or, il est assez révélateur que beaucoup de ses réformes soient menées par simples Motu Proprio, autrement dit sur l’équivalent des pouvoirs propres du pape. Ainsi, une centaine de Motu Proprio ont été adoptés durant ses douze années de règne, contre seulement treize en huit ans pour son prédécesseur Benoît XVI, beaucoup plus théologien que tacticien. L’autoritarisme s’est aussi manifesté dans la rédaction des textes, très personnelle ; ainsi, il rédige sa première exhortation apostolique presque seul, sans synode. Il rappelle d’ailleurs de manière tout aussi cassante dans celle-ci que les positions sur l’avortement et sur le sacerdoce masculin ne changeront pas. Toutefois, cet autoritarisme romain se heurte parfois à sa théologie de la marginalité : ainsi, sur les LGBT, le pape tente de concilier les condamnations expresses des formes de couple LGBT et l’acceptation individuelle des LGBT en tant que marginaux, quoique sans grand succès. De manière générale, le pape franciscain laissera donc l’image paradoxale d’un conciliateur intransigeant : intransigeant dans son investissement des marges et sa pratique du pouvoir en ce sens ; conciliant pour la réconciliation des marges entre elles et avec le centre.
Avec la mort du pape François, l’Église fait donc face à un tournant : ou bien elle bascule définitivement vers la périphérie, les marges de son empire, qui lui sont encore le plus sensible, quitte à tourner le dos aux formes européennes et latines historiques. Dans l’hypothèse de ce grand remplacement spirituel déjà en cours, elle devra alors faire face à une opposition lourde des franges les plus traditionalistes d’une part, et user d’une plus ferme autorité. Elle devra également trouver le moyen d’adapter la forme sans adopter le fond, de produire de nouvelles formes qui traduisent sans trahir sa doctrine, au risque de l’éclatement. Dans tous les cas, elle prend un pari sur l’avenir, car l’acculturation de l’Église aux marges américaines, africaines et asiatiques, semble de plus en plus complexe à l’heure du triomphe généralisé de la déculturation inconsciente. Elle peut également tenter de réévangéliser son cœur historique, latin et européen, mais risque de se couper potentiellement du reste du monde en mettant au second plan sa catholicité au profit de son apostolicité, et apparaissant alors comme l’allié d’un Occident en voie de déclassement et le vecteur de cette globalisation occidentale uniformisante qu’elle affirme vouloir combattre.
Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.
