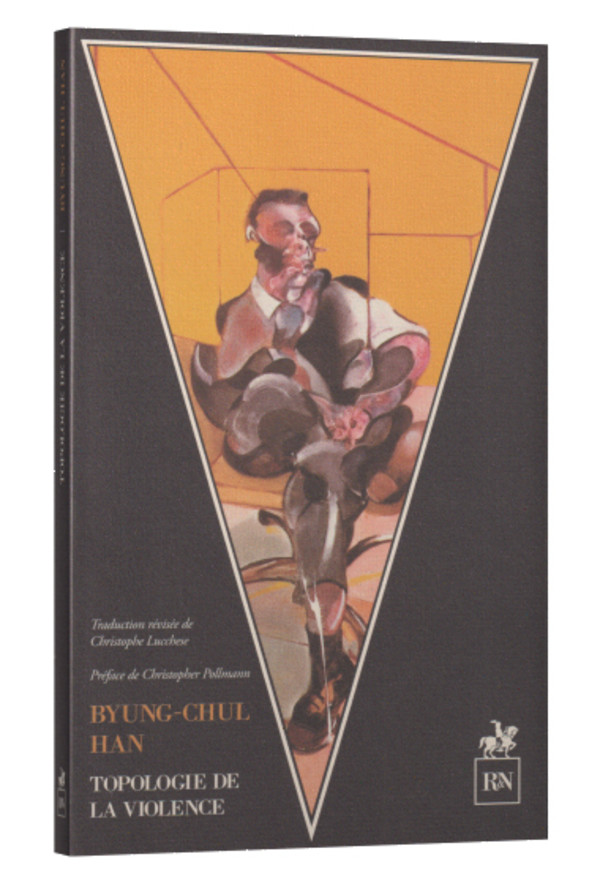Bien loin d’évacuer la violence, la modernité néo-libérale et technologique est en train de la systématiser à tous les acteurs de la société en la changeant de forme. Telle est la thèse que formule Byung-Chul Han dans sa Topologie de la violence (2011), traduit en français en 2024 (éditions R&N). Le philosophe sud-coréen, professeur à l’Université des arts de Berlin, y dépeint les mutations contemporaines de la violence, de son ancienne forme répressive à sa nouvelle forme dépressive. Contaminant de l’intérieur aussi bien les gagnants que les perdants du capitalisme, elle soumet toute la société au diktat de la performance et au péril constant du burn-out. La mutation néo-libérale de la violence annoncerait-elle l’effondrement catastrophique du capitalisme sur lui-même ?
Pour l’essentiel, la croyance moderne du Progrès revendiquait l’éradication apparente de la violence dans les sociétés modernes. Bien que nous assistions à un retour en force de la violence martiale sur le sol européen, à la fois sous la forme virale du terrorisme que celle, classique, de la guerre de position sur le front ukrainien, la pacification des mœurs reste un fait largement constatable. Les progrès des médiations techniques entre les individus, la politesse et le raffinement des sentiments, rendus possibles par la stabilité politique et le développement économique et culturel, forment selon Norbert Elias (1897-1990) tous autant de processus de « civilisation » de la violence. Mais en remarquant que la violence « a été émoussée et limitée par une infinité de règles et d’interdictions qui se sont transformées en autant d’autocontraintes »[1], le sociologue allemand n’était pas loin de reconnaître que la civilisation de la violence ne signifie pas en réalité son adoucissement, mais son déplacement. Fort de ses observations au XXIe siècle, Byung-Chul Han formule ainsi la thèse remarquable que la violence n’a jamais disparu des démocraties libérales : elle n’a fait que changer de forme, en ne se dirigeant plus tant contre autrui que contre soi-même.
Selon le philosophe contemporain, le retrait tendanciel de la violence hors du spectacle de la négativité, c’est-à-dire du conflit, de l’affrontement et de la douleur expressive, n’est pas le symptôme de sa réduction mais de sa modification. Dans la société néolibérale contemporaine, on assiste en fait à un « déplacement topologique de la violence », c’est-à-dire une modification à la fois de ses lieux, et de la possibilité même de la localiser chez un acteur précis. En réalité, « la disparition de l’instance de domination extérieure », que l’on peut constater à plusieurs égards dans les démocraties libérales, « n’abroge pas la structure coercitive ». Nous vivons dans une société capitalistique de la performance où « liberté et contrainte ne font plus qu’un », où la coercition parvient à s’exercer, intérieurement, sans domination extérieure et localisée. Typiquement, là où Norbert Elias voyait dans le sport moderne un exutoire permettant à la combativité de se décharger sous la forme raffinée et ludique d’une compétition[2], Byung-Chul Han y voit au contraire le creuset d’une nouvelle forme de violence non moins destructive, dont l’injonction à la performance et au record génère une société du dopage et de l’insensibilisation — sans parler des sympathies nazies et de l’idéologie proto-eugéniste du père des Jeux Olympiques modernes, Pierre de Coubertin (1863-1937).[3] Ainsi, l’individu des sociétés industrialisées est véritablement « condamné à être libre » : sans échappatoire possible à sa liberté subie plutôt qu’assumée, les contemporains de la dystopie néo-libérale se contraignent d’autant plus violemment à se conformer aux idéaux insatiables de leur société mercantiliste qu’ils sont plus libres de le faire.
Déplacement topologique
La violence est traditionnellement définie comme la détermination de la force en une contrainte, subie par un être également capable de force. D’où son étymologie, qui provient du latin vis, « la force » et même la force en action, auquel correspond en grec l’is homérique qui signifie la vigueur musculaire. Ainsi, dans sa Critique de la faculté de juger (§28), Emmanuel Kant (1724-1804) définit rigoureusement la violence (Gewalt) comme l’état où « la force » (Macht), en tant que « pouvoir supérieur à de grands obstacles », « l’emporte sur la résistance de ce qui possède aussi une force ». Or, cette conception de la violence n’est rigoureuse que pour décrire sa forme négative, celle à laquelle Kant avait encore affaire dans son époque de transition, celle de la « société disciplinaire », point de passage, selon Byung-Chul Han, entre l’ancienne « société de la souveraineté » et la « société de la performance » contemporaine. Précisément, le point commun de la société de la souveraineté et de la société disciplinaire immédiatement est qu’elles reposent sur un « sujet d’obéissance » : obéissance au souverain, obéissance à l’État et ses institutions de contrôle.
Leur différence est que, dans la première, le souverain exerce un « pouvoir de mort » sur le sujet. Par le glaive ou bien par le châtiment, le souverain des sociétés traditionnelles possède, selon les termes de Michel Foucault (1926-1984), le « privilège de s’emparer [de la vie] pour la supprimer ».[4] Au contraire, dans la société disciplinaire qui se constitue selon Foucault à partir du XVIIe siècle, le pouvoir ne cherche pas à supprimer la vie des récalcitrants, mais à l’ « investir […] de part en part] »[5]. Le passage de la société de la souveraineté à la société disciplinaire signifie donc la mutation du pouvoir suprême de mort en pouvoir suprême de vie. Le pouvoir s’est en effet complexifié et diffusé successivement à travers des « dispositifs d’ “incarcération” multiples »[6] et nouveaux : « hôpitaux », « maisons de correction », « prisons », « casernes » et « usines ». Il n’est, dès lors, plus besoin de recourir au caractère spectaculaire des châtiments corporels pour compenser l’absence du pouvoir dans tous les recoins de la vie et du territoire : désormais, l’État providence peut s’assurer dès l’enfance, partout à travers ses nouvelles institutions de contrôle, de « l’administration des corps et la gestion calculatrice de la vie ». Le pouvoir politique traditionnellement chargé de gouverner le « peuple » devient alors un pouvoir social de contrôle de la « population ». Les fonctions régaliennes de la souveraineté cèdent la place à une « bio-politique » qui contrôle « la prolifération, les naissances et la moralité, le niveau de santé, la durée de vie, la longévité »[7].
Dans les deux contextes sociaux où le phénomène proprement moderne de la violence n’est pas achevé, il ne s’agit pourtant que de la forme la plus répandue de la violence : la violence de la négativité, qui soit prive de la vie par la « décapitation » et le « sang », soit prive de la liberté par la « coercition disciplinaire ». Il manquait donc à Kant de concevoir une « contrainte positive », outre la « contrainte négative » qui est celle de la force. Le sujet kantien qui souffre de la violence est clairement, encore, un sujet d’obéissance, dont le devoir moral, décrit-il dans La Métaphysique des mœurs, se caractérise par la conscience d’une « puissance » (Gewalt) violente « qui veille en lui sur les lois », se trouvant « observé, menacé et surtout tenu en respect par un juge intérieur ». Or le sujet d’obéissance implique la polarisation et la localisation du pouvoir, que ce soit dans le souverain ou dans les lieux de contrôle disciplinaire.
Tel n’est plus le cas de la violence qui émane de la société de la performance, selon Byung-Chul Han. Cette violence n’est plus localisable. Ce qui ne pouvait qu’échapper à Michel Foucault en raison de sa théorie de la société disciplinaire, c’est la sortie hors de tout lieu de la violence hypermoderne : « La prison est un élément constitutif, un lieu de la société disciplinaire ; là où le camp est un hors-lieu ». Dans la société de la souveraineté, la « violence sanguinaire » exercée sur l’ennemi a lieu sur la place publique. À l’inverse, dans la société de la performance, où les totalitarismes cherchent à maximiser techniquement leur destruction de l’ennemi, la violence n’occupe plus de lieu : « la chambre à gaz exsangue [est] soustraite à toute attention publique. La violence n’est plus mise en scène avec faste mais honteusement cachée. […] Lui font défaut tout langage comme toute symbolique. Elle n’annonce rien. Elle s’accomplit comme anéantissement silencieux, mutique. […] Le camp est un non-lieu. […] [La violence] passe du visible à l’invisible, du direct au discret. » Ce non-lieu de la violence nazie ou soviétique qui s’exerçait dans les camps s’est étendu à toutes les manifestations d’une nouvelle forme de violence s’exprimant de l’intérieur même des individus, qui ont intériorisé les injonctions capitalistes à toujours plus de performance dans tous les domaines de l’existence. N’ayant plus de lieu, la violence de la positivité est en effet conçue par le philosophe comme une violence systémique, c’est-à-dire une forme de violence dont souffrent tous les acteurs sociaux, toutes les nations, toutes les classes et toutes les ethnies. « Son sujet, écrit-il, n’est ni quelqu’un détenant le pouvoir ni une classe dominante, mais le système lui-même. »
La violence contre soi
Cela revient à penser la violence selon un critère plus général. Pour Kant comme pour Byung-Chul Han, « fracasser une pierre n’est pas encore de la violence », mais seulement de la force, puisque la pierre, explique le premier, n’est pas capable d’une force contraire. Or, l’erreur de la définition kantienne est de faire imaginer que la collision entre deux météores serait plus violente que la pulvérisation d’un agneau innocent par un boulet de canon. On peut donc se laisser convaincre par la redéfinition proposée par l’auteur : en réalité, « la violence touche toujours le détenteur d’une intériorité ». Elle ne se détermine pas seulement comme le rapport antagoniste entre deux forces, mais entre une intériorité et une extériorité, dont la modalité mécanique (celle de la force en mouvement) n’est qu’une espèce de ce rapport : la plus répandue, mais sans être nécessaire.
Or, c’est précisément ce rapport entre l’intérieur et l’extérieur qui se trouve modifié dans la société de la performance. Cette société qualifie la nouvelle organisation des activités sociales à l’ère de la mondialisation, laquelle est indissociable des innovations techniques fulgurantes qui ont rendu possible la massification des échanges et des circulations de personnes, de biens, de services et d’informations. Dans ce contexte, le phénomène politique premier n’est plus l’adversité, mais la promiscuité : l’autre ressemble de plus en plus au même. L’homogénéité capitaliste fait disparaître toute étrangeté dans l’altérité, si bien que nous assistons à une « addition du même à marche forcée ». Ni les codes vestimentaires, ni les pratiques culinaires, ni les rites locaux ni les langues ne distinguent plus qualitativement les personnes en fonction de leur communauté d’appartenance. Dès lors, l’explication schmittienne du politique n’est plus pertinente. « L’actuelle société de la performance n’est pas dominée par le schéma immunologique ami-ennemi. Résumant la thèse de Carl Schmitt (1888-1985), l’auteur précise que selon le constitutionnaliste allemand, « le “concurrent” n’est pas un ennemi. […] La tension existentielle, la négativité de l’hostilité qui procure une image de soi univoque, fait justement défaut à la relation concurrentielle. Le sujet de performance de la modernité tardive s’affranchit toujours plus de la négativité. Nul ennemi, nul souverain ne lui fait face. » Or, c’est cette absence de confrontation à une altérité véritable qui, couplée à l’impératif capitaliste de croissance indéfinie, produit une nouvelle forme de violence.
L’impossibilité moderne d’être soi engendre un retournement de la violence contre soi-même. « L’actuel rapport de production » explique cette crise. La mobilité des métiers et leur dissolution en emplois précaires, l’abstraction et la désincarnation des travaux du tertiaire, auxquels correspond la dissolution des repères traditionnels de la famille et des anciennes solidarités, sabotent toute condition de possibilité de formation de l’identité : « L’œuvre définitive comme résultat d’un travail achevé, accompli, n’est plus possible » ; « l’impossibilité socialement déterminée de formes d’accomplissement valables, définitives », empêche le sujet de parvenir « à aucune forme, à aucune image stable de soi, à aucun caractère ». Dès lors, le sujet de performance de la société capitaliste se met toujours plus de pression pour parvenir au but qui sans cesse se dérobe. Il s’épuise, il se surmène au travail, il surcommunique et surconsomme pour tenter de parvenir à une identité stable et suffisamment satisfaisante. Or, celle-ci lui est interdite dans l’économie de la croissance indéfinie, qui requiert au contraire de maintenir les individus dans un état perpétuel d’ « ouverture » et d’ « inachèvement », nécessaire à leur « flexibilité » sur le marché du travail.
La catastrophe du monde moderne
Dès lors, la description freudienne du Surmoi ne s’applique plus. L’instance morale de censure et de répression des pulsions n’est plus le phénomène typique de la conscience dans un contexte caractérisé par la dérégulation des marchés autant que des mœurs. Au « Surmoi » répressif succède donc le « Moi idéal » dépressif : « Le sujet de performance dépressif, épuisé, est ainsi abattu par lui-même », « par la guerre qu’il se livre à lui-même » pour conquérir la meilleure version de soi-même voulue par le marché. « Au regard du moi-idéal inaccessible, le moi se perçoit comme déficitaire, raté, il s’accable de reproches. Le gouffre entre le moi réel et le moi idéal engendre de l’autoagressivité. » Or cette « violence autogène » a ceci de plus funeste que la violence dirigée contre autrui que le perpétrateur et la victime sont la même personne, entretenant une illusion de liberté. La liberté est devenue identique à la contrainte, car le sujet de performance se fait librement violence pour essayer d’atteindre l’inatteignable.
La violence se caractérise par une contrainte dont l’effet est la suppression des limites de l’intériorité : soit par privation ou destruction de celle-ci, soit par sa dissolution ou saturation. La violence positive fonctionne par cet excès : « La violence de la positivité n’est pas privative mais saturante, non pas exécutive mais exhaustive. Elle ne repose pas sur l’exclusion mais sur l’exubérance. Elle ne se manifeste pas comme répression mais comme dépression. […] Non plus infection mais infarctus », non plus « explosive » mais « implosive ». Cette violence de l’excès a lieu dans le contexte de la croissance capitaliste, dont l’impératif dogmatique se poursuit au sein de sociétés pourtant très développées : ainsi s’agit-il désormais d’une économie de l’ « excroissance », où l’augmentation de la productivité ne vise pas autre chose qu’elle-même. Dans cette frénésie absurde du « toujours plus », les limites du moi sont partout supprimées par saturation : « surperformance », « surproduction », « hyperattention » et « hyperactivité », « excès de mobilité » et « surexposition » de soi, autant de phénomènes qui conduisent le sujet de performance à se disperser dans une multiplicité d’activités toujours plus nombreuses et toujours moins qualitatives, jusqu’à la répétition frénétique des gestes captifs du scrolling sur le désastreux marché de l’attention.
Comme le résume le Pr. Christopher Pollmann (université de Lorraine) dans sa Préface, « le devoir de réussir signifie généralement que l’individu s’inflige des souffrances plus ou moins importantes, pouvant déboucher sur un état de fatigue[8] (…), voire son effondrement psychique ».[9] L’un des symptômes pathologiques de cette violence positive est celui de la scarification, devenue « phénomène de masse chez les jeunes ». Plus généralement, le « burn-out » et la « dépression » est ce dont souffre le sujet de performance, quelle que soit sa classe sociale ou son sexe. Si Byung-Chul Han souligne l’importance de « l’hystérie d’accumulation et de croissance » caractéristique du capitalisme moderne, ce n’est effectivement pas pour reconduire l’explication marxiste. Les classes dominantes et les classes dominées souffrent toutes de ces symptômes : « Top dogs comme underdogs sont soumis au diktat de la performance et de l’optimisation. Tous les membres de la société sont concernés par le burn-out », qui se rajoute, il est vrai, aux violences négatives persistantes subies par les classes populaires. Du fait de cette systématisation de la violence, les tensions ou antagonismes caractéristiques de la crise du monde moderne cèdent la place à l’imminence de la catastrophe, c’est-à-dire l’effondrement interne du système par autophagie. La catastrophe sociale que nous vivons est la « métastase » d’une « positivité dévorant ses propres cellules », selon les mots de Jean Baudrillard (1929-2007).[10] L’entrepreneur est devenu son propre exterminateur. Si le froid glacial du goulag n’a pas vaincu mais renforcé le capitalisme industriel, combien de temps reste-t-il au capitalisme total avant que sa « surchauffe » (burn-out) ne le fasse imploser ?
[1] Norbert Elias, La Civilisation des mœurs (1939), chap. VII, trad. fr. Pierre Kamnitzer, Pocket, 2002, p. 421.
[2] Ibid., p. 443.
[3] Cf. la mise au point instructive de Christopher Pollmann dans son excellente Préface à l’édition française de Topologie de la violence.
[4] Cité p. 110. Cf. Michel Foucault, Histoire de la sexualité, I, La volonté de savoir, dans Œuvres, t. II, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », Paris, 2015, p. 716.
[5] Idem. Cf. Michel Foucault, op. cit., 719.
[6] Michel Foucault, Surveiller et punir, dans Œuves, op. cit., p. 612.
[7] P. 111. Cf Michel Foucault, Histoire de la sexualité, op. cit., p. 719.
[8] Cf. Byung-Chul Han, La société de la fatigue, trad. Julie Stroz, Belval (Vosges), Circé, 2014 ; trad. Olivier Mannoni, Paris, Puf, 2024.
[9] P. 10. Cf. Byung-Chul Han, Thanatocapitalisme. Essais et entretiens, trad. Olivier Mannoni, Paris, Puf, 2021, pp. 81-90.
[10] P. 117. Cf. Jean Baudrillard, La Transparence du mal : essai sur les phénomènes extrêmes, Galilée, Paris, 1990, p. 111.
Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.