Le socialisme n’a jamais cherché à se défaire de l’anti-christianisme qu’on lui a si souvent prêté, allant même parfois jusqu’à le revendiquer, au nom du matérialisme sur lequel repose sa doctrine. Figure historique et symbole inaltéré de ce mouvement, Jean Jaurès était pourtant un croyant convaincu, dont les conceptions religieuses, souvent mal comprises ou délibérément estompées, ouvrent une voie de réflexion originale et intéressante sur l’articulation entre le projet socialiste et la foi chrétienne.

Le contraste entre la théorie marxiste d’une société reposant fondamentalement sur l’opposition entre deux classes définies par leur rapport à la production, et l’affirmation d’une vision catholique du monde au sens étymologique du terme, c’est à dire celui d’une communauté universelle, est a priori saisissant. Cependant, il convient de préciser le réel point de divergence qui oppose en apparence ces deux conceptions : il ne s’agit pas tant de la division de la société en deux catégories que de la question d’un éventuel affrontement entre celles-ci. D’abord réticente à établir le constat d’une humanité dont les inégalités ne seraient pas juste contingentes mais structurellement établies, par crainte d’une contradiction avec l’idée même d’universalisme, l’Église a fini par reconnaître l’existence de deux classes. Dès 1891, dans l’encyclique qui pose les jalons de ce qui deviendra la doctrine sociale de l’Église, le pape Léon XIII reconnaît que « les violents bouleversements sociaux ont divisé le corps social en deux classes et ont creusé entre elles un immense abîme. D’un côté,une faction, toute puissante par sa richesse, maîtresse absolue de l’industrie et du commerce, détournant le cours des richesses, faisant affluer vers elle toutes les sources et tenant en sa main plus d’un ressort de l’administration publique. De l’autre, une multitude indigente et faible ». Évidemment, l’analyse des causes et des mécanismes de cette division diverge de la théorie marxiste, et l’intention du pape n’est d’ailleurs nullement d’en déterminer les détails. Mais l’esprit du texte contient l’essentiel de ce qui constitue la première passerelle entre socialisme et christianisme : l’existence effective d’une injustice fondamentale. La divergence des chemins du chrétien et du socialiste implique nécessairement une convergence antérieure.
C’est précisément à cette étape que s’immisce la confusion qui trompe bien souvent autant les chrétiens que les socialistes. Une fois l’injustice constatée et ses affres reconnues, que convient-il de faire ? À cette question, les socialistes n’entendent pas admettre d’autre réponse que la lutte, c’est à dire la résolution immédiate de l’injustice. Dans la doctrine marxiste, la traduction de cette volonté mène à la nécessaire réalisation du projet socialiste, dont l’avenir devient nécessité par l’effet du matérialisme historique. Les flous contenus dans les écrits sociologiques de Marx ouvrant aisément la voie à des assertions relevant parfois moins de la déduction que du prophétisme, cette téléologie socialiste tendant indéfectiblement vers une société sans classe éloigne assurément tout autre destin humain. Or, c’est justement par l’avènement d’un autre destin humain que le christianisme répond à la question « que faire face à l’injustice ? ». Puisque son âme est appelée à être sauvée et à survivre après sa mort, l’homme ne peut mener qu’un combat vain et illusoire contre l’injustice matérielle. Pire encore, ce combat pourrait perdre l’âme de celui qui le mène, en causant d’autres injustices par ses actes.
Est-ce suffisant pour sceller définitivement l’incompatibilité de la foi et de la lutte des classes ? Jean Jaurès le rappelle dans sa thèse complémentaire Les origines du socialisme allemand, les textes de Marx ne professent pas l’incompatibilité insurmontable de ces deux visions divergentes. Lorsque Karl Marx parle d’un « opium du peuple », il se réfère précisément à la misère religieuse et non à la religion elle-même. « La misère religieuse est tout à la fois l’expression de la misère réelle et la protestation contre la misère réelle. » La croyance en une justice dans l’au-delà est produite par l’injustice du monde réel, mais elle n’empêche pas de la combattre. Karl Marx écrit justement ces lignes dans l’intention de démontrer aux socialistes du début des années 1840 l’erreur qu’ils commettent en désignant la religion comme leur ennemi principal. Selon lui, il faut combattre le mal, et non ses symptômes: Jean Jaurès reprend à son compte l’idée que le socialisme n’a pas pour objet d‘abolir la foi, même s’il lui faut veiller à ne pas s’assoupir sous ses effets.
Le dépassement du déterminisme matérialiste par l’esprit

Jean Jaurès n’a cependant pas oublié l’analyse marxiste de la religion comme instrument de domination d’une classe sur l’autre. Aussi admet-il pleinement qu’elle ait pu être utilisée contre la classe ouvrière au cours des siècles, afin de chercher dans l’assentiment du peuple le plus efficace moyen d’étouffer jusqu’au sentiment même d’injustice par l’impérieuse nécessité de la résignation. Cependant, c’est justement parce qu’il se méfie de cette religion devenue pure morale et donc, dans une perspective socialiste, morale d’une classe, que Jaurès préfère la « religion éternelle » des Évangiles, pure de tout ajustement séculaire aux contingences de l’Histoire.
Alors que la morale commande à l’individu en influant sur ses choix, la religion pure est porteuse d’un message universel qui s’adresse à la communauté humaine entière. C’est cette émancipation collective qui attise l’espoir de Jaurès et lui semble être un terreau fécond pour le devenir de l’homme – et la réalisation d’un projet socialiste. « L’essence même de la vie religieuse consiste à sortir de son moi égoïste et chétif, pour aller vers la réalité idéale et divine » écrit-il dans sa thèse De la réalité du monde sensible. Loin de constituer un emportement de jeunesse, cette réflexion le poursuivra tout sa vie. Près de trente ans plus tard, en 1910, il déclare face à la Chambre des députés : « Je ne suis pas de ceux que le mot Dieu effraie. J’ai écrit, il y a vingt ans, sur la nature et Dieu et sur leurs rapports, et sur le sens religieux du monde et de la vie, un livre dont je ne désavoue pas une ligne, qui est resté la substance de ma pensée. Au risque de vous surprendre, je vous dirai que j’ en ai fait il y a peu de temps une deuxième édition, et que je n’ y ai fait aucun changement. »
La raison de cette étrange admission dans le vocabulaire de Jaurès du concept d’âme humaine, à laquelle les socialistes ne se montrent d’ordinaire pas perméables, est précisément due à son abandon assez précoce des conceptions matérialistes de l’Histoire. Son spiritualisme, qui lui fut reproché à plusieurs reprises, est en effet la clef de voûte de l’articulation qu’il agence entre christianisme et socialisme. Bien moins fasciné par le jeu des forces monumentales qui entraînent par incidence les êtres qu’elles déterminent dans leur mouvement que par l’effet des convictions et des émotions personnelles sur l’action de chacun, il ne renie absolument pas pour autant le déterminisme historique et l’assertion marxiste d’un individu dont « l’être social détermine la conscience ». Mais cette détermination supérieure ne rend pas, selon Jaurès, caduque l’idée d’individu dont la conscience, parce qu’elle réagit aux forces qui la déterminent, est une force active et agissante, dont le mouvement accompagne l’Histoire. Il n’évoque jamais l’existence d’une volonté propre, mais plutôt celle d’une aspiration, qu’il nomme à plusieurs reprises « espoir », voire « espérance », au plus près du lexique chrétien. C’est de cette manière qu’il dépasse Marx et son analyse du désir, sans le contredire, mais en précisant au plus profond de l’âme humaine cette « aspiration vers l’infini », qui est la preuve même de l’existence du bien. « Le simple fait que l’on désire un bien absolu prouve que celui-ci existe, car on ne peut désirer quelque chose sans en avoir déjà une préconnaissance ». C’est précisément à ce point que son spiritualisme devient idéalisme. « Puisque votre science constate que la nature s’élève de forme en forme, de degré en degré, sollicitée par un idéal qui est à mes yeux une force transcendante, moi, Église, j’ai devancé, j’ai anticipé la plus audacieuse espérance que puisse suggérer aux hommes cette loi d’évolution montante, et je vous apporte une promesse de vie que les révolutionnaires de la pensée et de l’action n’ont jamais égalée » déclare-t-il à la tribune de la Chambre des députés en 1906, en faisant parler l’Église -par laquelle il faut évidemment comprendre : « la foi ».
Il est intéressant de noter qu’en plus du spiritualisme et de l’idéalisme qui en découle, Jaurès introduit une troisième notion peu orthodoxe du point de vue de la doctrine marxiste : celle de l’individualisme. Elle découle de la confrontation logique entre le déterminisme historique et l’existence d’une conscience agissante. La supposition d’individualités distinctes au sein du même classe et potentiellement opposées, non pas entre elles (ce que le marxisme entend parfaitement), mais au mouvement même de détermination sociale, ne rend l’idée de convergence que plus belle selon Jaurès, puisque rien ne contraint a priori les hommes à se tourner les uns vers les autres, ni à se tourner tous dans la même direction. Leur interaction conjointe et l’abandon de l’égoïsme, qu’il tient pour mal absolu de l’humanité, est la mise en contact de ces consciences, comme attirées par une finalité lointaine et dont elles ignorent encore tout. « Avant même de connaître Dieu, l’âme de l’homme incline vers lui en inclinant vers les autres ».
Le socialisme pour accomplir les Évangiles: « l’arrière-pensée » de Jaurès
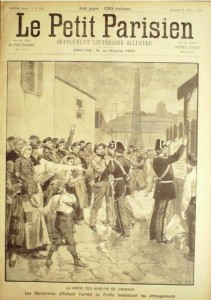
Sur le plan purement politique, Jaurès demeure méfiant face aux catholiques dits « de gauche » et davantage encore à l’égard des corporatistes chrétiens. S’il est arrivé à plusieurs reprises que ces deux mouvements se retrouvent objectivement alliés lors de débats parlementaires, Clemenceau allant jusqu’à dénoncer une coalition « sous la férule de Jean Jaurès et le goupillon d’Albert de Mun », le député de Carmaux ne peut pas pour autant oublier si rapidement le passé anti-républicain d’une fange très majoritaire des catholiques dont de Mun faisait partie. Pourtant, défenseur des petits patrons et du petit commerce, ayant écrit dans la Dépêche de Toulouse « Le capital et le travail sont inséparables : il faut des patrons aux ouvriers comme il faut des généraux aux soldats », il s’attire les sympathies de l’ancien légitimiste. L’intelligence des deux hommes les rapproche. Jaurès va jusqu’à écrire à propos d’un discours d’Albert de Mun auquel il a assisté en 1892 : « Par sa doctrine sociale, il est beaucoup plus près de nous, qui l’écoutions en silence, que de la jeunesse qui l’acclamait ».
Tel est bien le problème principal que pose à Jaurès le rapprochement avec les mouvances de la gauche chrétienne. Il se méfie davantage des catholiques bourgeois que des clercs. Il défend la séparation de l’Église et de l’État avec conviction, mais l’Histoire n’a retenu que la pugnacité de ses engagements en faveur d’une République laïque, et jamais la raison qui motivait ceux-ci : il ne veut pas faire de la laïcité l’ennemie de la religion, mais bel et bien un rempart de protection empêchant celle-ci de s’impliquer dans les affaires de l’État, au moins autant pour protéger ce dernier des influences du clergé que pour préserver le message chrétien de son dévoiement en une morale publique de domination. La religion politisée devenant immédiatement une éthique bourgeoise, il entend la tenir à l’écart pour la préserver. Mais il n’était guère plus tendre vis à vis des « athées de principe dont l’anticléricalisme est une libre-pensée de ruisseau ». Peu de gens aiment à se rappeler que Jaurès allait jusqu’à préconiser que l’on enseignât aux élèves la morale et le catéchisme.
Concernant ses préconisations théologiques, elles ne sont pas plus en phase avec la doctrine de l’Église, qu’il considère d’ailleurs non sans provocation comme « une vague institution de centre gauche ». Le principal écart qu’il se permet de faire vis à vis du catéchisme officiel concerne l’action humaine, sur laquelle il fonde déjà ses conceptions révisées du déterminisme, et qui est, selon lui, « la continuation, en quelque sorte, de l’œuvre de Dieu » comme il l’écrit dans sa thèse. Derrière l’idée délibérément vague d’une action humaine, il ne faut pas lire autre chose que la définition de la politique même. Et voici soudain la fond de sa pensée énoncé de manière bien plus radicale : le socialisme est la prolongation de la volonté divine, si longtemps délaissée par l’Église, qui « ne s’est tournée vers les faibles que lorsqu’ils sont devenus une force ».
Voilà justement la conclusion à laquelle parvient Jaurès : les tentatives du Vatican pour affirmer une doctrine sociale de l’Église révèlent que celle-ci « s’offre aux classes dirigeantes comme un contrefort indispensable contre le socialisme ». Il ne reproche pas à l’Église d’accepter la misère et de la prêcher comme vertu, ni de refuser de l’affronter et de la combattre, ni même d’avoir conforté moralement la domination d’une classe sur l’autre à travers les siècles – tout cela n’est que le fruit de la dérive d’une institution détournée de Dieu par la cupidité, celle-là même que dénoncent plusieurs de ses contemporains dans leurs écrits, tels Léon Bloy ou Paul Claudel. S’il en veut à l’Église, c’est parce qu’elle ne semble s’intéresser aux pauvres que par opportunisme, comme « un homme sévère, un de ces grands bourgeois, pris soudain de tendresse à l’égard d’un parent pauvre parce qu’il le voit en passe d’obtenir un grand héritage ». Lui qui demeure convaincu de la continuité des Évangiles et du socialisme se défie de l’Église, qui n’a jamais réellement appliqué le message du Christ, et qui ne s’apprête pas plus à le faire au moment où le vent tourne et la contraint à s’adresser enfin aux masses déshéritées.

Aussi la Révolution se fera-t-elle nécessairement sans l’Église. S’il a voté pour le maintien des relations diplomatiques entre la France et le Vatican, ce n’est que dans le contexte du boulangisme, pour ne pas déstabiliser la République face à une menace de putsch militaire et non par complaisance sentimentale à l’égard des représentants du clergé. Car c’est bien l’Église qui a provoqué la mort de Dieu selon lui. Mais cette extinction des lumières du ciel n’est que provisoire pour Jaurès. En effet, il affirme la possibilité d’un réveil de christianisme véritable après la Révolution, qui aura initié le long accomplissement des Évangiles. Le socialisme ne fait qu’œuvrer à la réalisation d’un message à travers une espérance commune, bien plus ancienne et vibrante que lui, qui parcourt l’humanité depuis l’aube des temps dans un souffle impérieux, s’imposant à elle avec ténacité, toujours confuse et indistincte au fond de l’âme, et pourtant toujours ardente. Elle obsédait Jaurès depuis son enfance, lorsqu’il contemplait les constellations depuis sa chambre d’adolescent, oscillant entre le vertige que l’on éprouve en mesurant à quel point l’homme est insignifiant dans un monde infini, et la conviction que la capacité à entrevoir l’infini, à l’embrasser tout entier par la pensée, constitue la preuve irréfutable qu’on ne peut se fier à l’apparente petitesse matérielle de l’homme pour préjuger de sa place dans l’univers et le temps. Entre l’usurpation du christianisme de l’Église et l’inhumanité de la révolution socialiste, Jaurès a réussi à tracer une troisième voie en direction des étoiles qui le fascinaient tant, et grand ouverte à tous les hommes prêts à suivre cet appel vers un idéal dont il passa son existence entière à se faire le serviteur – et qui dépasse de très loin le projet socialiste.
« J’ai sur ce monde, si cruellement ambigu, une arrière-pensée sans laquelle la vie de l’esprit me semblerait à peine tolérable à la race humaine. »
