Ancien élève de l’École normale supérieure de Lyon et agrégé de lettres modernes, Alexandre de Vitry a publié sa thèse de doctorat dirigée par Antoine Compagnon sous le titre Conspirations d’un solitaire, l’individualisme civique de Charles Péguy (Les Belles Lettres, 2015). Il a également dirigé l’édition des œuvres de Charles Péguy « Mystique et Politique » dans la collection Bouquins chez Robert Laffont. Auparavant, il avait publié L’invention de Philippe Muray (Carnets Nord, 2011).
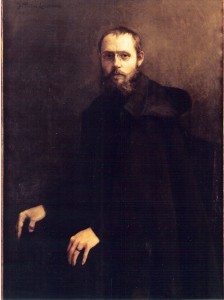
PHILITT : Pouvez-vous d’abord expliquer le titre de votre ouvrage, notamment l’usage du mot « conspirations » qui ne va pas de soi ?
Alexandre de Vitry : Le type du conspirateur a donné lieu a beaucoup de littérature au XIXe siècle. L’exemple le plus célèbre étant sans doute Dostoïevski. Le conspirateur est un révolutionnaire et réciproquement. C’est une idée que l’on trouve chez Marx, qui distingue, parmi les révolutionnaires, des conspirateurs « professionnels » et « occasionnels ». Péguy lui-même se pense comme révolutionnaire au début de son parcours intellectuel en tant que socialiste et dreyfusiste. Mais il ne renonce jamais à cette figure quand ses choix politiques évoluent. Car l’imaginaire de la conspiration existe à droite comme à gauche. Les complots, réels ou non, qu’on dénonce, sont de tous les bords, qu’ils soient jésuite, juif, maçonnique…
Pendant l’affaire Dreyfus – qui est la scène primitive de la vie politique de Péguy – chacun accuse l’adversaire d’être à la tête ou victime d’un complot. Ce qui est intéressant chez Péguy, c’est que, plutôt qu’il ne dénonce le complot chez l’adversaire, il s’approprie une rhétorique du complot, l’idée de fomenter un projet avec un petit groupe dans l’ombre, pour décrire sa propre activité. En particulier, il use beaucoup de cette image pour parler des Cahiers de la Quinzaine. Mais justement, c’est surtout une image : il y a une différence entre ce que fait Péguy et ce que serait une véritable pratique de comploteur. Le but des Cahiers de la Quinzaine est tout de même de faire connaître des idées, de les diffuser au grand jour. Péguy est paradoxal : il veut comploter tout en étant dans la transparence ! Péguy pense les Cahiers comme une entreprise de sincérité mais il est également dissimulateur. C’est à mon avis le propre du véritable conspirateur, quelqu’un qui est obsédé par la chose publique mais qui fait tout passer par le privé. Et la « conspiration » de Péguy comporte une dernière singularité, que j’ai essayé d’afficher dans le titre de mon livre, qui est un oxymore : « Conspirations d’un solitaire ». On conspire toujours à plusieurs. Péguy veut conspirer mais il brise toujours les liens d’amitié qui rendent possible la conspiration.
De quelle manière Péguy met-il son individualisme au service du collectif, qu’il soit socialiste, républicain, national ou chrétien ?
Le terme de « cité » que j’ai mis en avant et que Péguy utilise beaucoup permet de répondre à cette question. La cité est un mot très chargé à l’époque de Péguy. Dire « cité », ce n’est pas dire « société » ni « collectif ». Cela fait référence à la cité antique telle qu’elle fut pensée par Fustel de Coulanges. Pour celui-ci, la cité est l’état d’une société où l’individu n’existe pas. Péguy se sert du terme de cité pour désigner au contraire la forme collective où l’individu va pouvoir le plus s’épanouir. Pour Péguy, ce qu’il y a toujours au bout de la pensée du collectif le plus prégnant – que ce soit dans le christianisme, dans la race ou dans la patrie – c’est l’individu. C’est à la fois son principe et sa finalité. Plutôt que de s’engager dans un individualisme explicite, Péguy retourne le terme de cité, extrêmement chargé, pour lui donner un nouveau sens.
Péguy, insaisissable, est socialiste contre le parti socialiste, patriote contre les nationalistes, chrétien anticlérical… La « pureté » des engagements de Péguy ne compromet-elle pas leur réalisation ?
Oui et c’est vrai pour tous ses engagements aussi différents soient-ils. L’utopie empêche les choses de prendre corps. Pourtant, Péguy veut que cette conscience utopique qui est la sienne se répercute dans le présent. À titre d’exemple, son socialisme doit commencer ici et maintenant par une révolution individuelle. Mais l’intransigeance de Péguy n’est pas seulement idéologique ou doctrinale, il y a également une dimension psychologique, quelque chose qui relève du tempérament, une pente irrépressible qui le conduit toujours vers une position de solitude où il rebat les cartes et recommence à zéro. Tout son parcours est jalonné de micro-ruptures de cet ordre là.

Pouvez-vous nous expliquer la différence d’articulation, chez Péguy et Barrès, entre l’individu et le collectif ?
Il y a un premier Barrès égotiste, celui de la trilogie romanesque du Culte du Moi, qui décrit un itinéraire aboutissant à la découverte de la chose collective, en particulier la politique. Pour Barrès, la quête individualiste débouche sur la collectivité. Mais une fois ce cheminement effectué, le primat du collectif ne rencontre aucune concurrence. L’anthropologie du second Barrès ne laisse aucune place à l’individu. Chez Péguy, c’est différent. Dès le départ, les deux inspirations sont en coprésence, elles coexistent de manière plus ou moins heurtée. Nous n’avons pas affaire chez lui à une évolution linéaire mais à une forme cyclique. Quand il cherche à penser l’individu, il tombe sur le collectif et quand il cherche à penser le collectif, il tombe sur l’individu. Pierre Glaudes et Jean-François Louette évoquent un « tourniquet » de l’individuel et du collectif dans l’essai péguyste ou sartrien. À mes yeux, cela explique pourquoi Barrès, à la fois stylistiquement et idéologiquement, est assez périmé alors que Péguy est une ressource beaucoup plus vive.
Êtes-vous satisfait par la lecture que propose Alain Finkielkraut de la notion de race chez Péguy entendue comme « liaison intime d’un peuple et d’une idée » ?
Non je ne suis pas satisfait par cette définition bien qu’elle soit tout à fait compatible avec les affirmations de Péguy. C’est vrai que Corneille est la grande référence de Péguy pour penser la race et la grâce – encore un jeu de mots de Péguy ! La race s’illustre dans l’héroïsme de certains personnages cornéliens qui culmine, dans la grâce, avec Polyeucte. La lecture de Finkielkraut est en quelque sorte internaliste, c’est-à-dire qu’elle est cohérente à l’intérieur de l’œuvre de Péguy. Sauf que nous parlons de Péguy à un siècle d’écart et Péguy parle à une époque donnée. Au temps de Péguy, le mot de race a un sens. C’est à ce moment que l’imaginaire biologique qu’il y a derrière l’idée de race prend consistance à travers une certaine forme de scientisme ou encore à travers le succès grandissant des thèses de Gobineau.
Gobineau s’appuie sur à une anthropologie pessimiste. Selon lui, il y a dans un passé immémorial des races pures ; c’est l’âge d’or de l’humanité. L’histoire humaine est celle d’une longue dégradation, d’une déchéance d’autant plus grande que l’humanité se mélange. Pour Gobineau, le contraire de la race, c’est précisément le mélange. Par parenthèse, l’appropriation allemande de Gobineau – notamment chez les nazis – sera un contre-sens. Elle retourne Gobineau en optimisme.

Pour Péguy, en revanche, la race n’a rien à voir avec la pureté. Quand Péguy célèbre la race, il est très souvent question de mélange. À ses yeux, les modèles de la race française sont Bergson, qui est juif (un pied de nez aux nationalistes), Saint-Louis de Gonzague (un jésuite italien) ou encore Ernest Psichari (son ami d’origine grecque). C’est un imaginaire ethnologique inverse à celui de Gobineau. À mon avis, la référence de Péguy en matière de race, c’est Michelet qui utilise déjà le concept de façon décalée. Michelet ne croit pas au primat de l’ethnique sur le politique qu’il perçoit comme un écueil allemand. En gros, pour Michelet, la race est le problème des Allemands et la politique est le problème des Français. Cela dit, il y a des retournements chez Michelet. Son livre La Bible de l’humanité s’achève par les mots suivants : « Et ta race est de 89. »
Il y a chez Péguy quelque chose de cet ordre. Il utilise le champ lexical du bourgeonnement, de la vie, de l’énergie qui pourrait être interprété de manière tendancieuse. Mais il s’en sert pour le retourner à la manière de Michelet. Cela amène à des oxymores. Il parle des Français comme d’une « race de liberté ». Normalement, la race et la liberté sont incompatibles, ce sont des valeurs antagonistes – en témoigne par exemple la correspondance entre Tocqueville et Gobineau. Péguy veut tenir ensemble les contraires. C’est plus compliqué et plus fort que ce que propose Finkielkraut.
Vous écrivez en conclusion de votre ouvrage que le « nous » de Péguy est celui d’un solitaire. Ce « nous » possède-t-il un référent autre que Péguy lui-même et ses utopies successives ?
Ce « nous » est dynamique, il se dilate et se contracte. Virtuellement, il devrait pouvoir s’appliquer à l’humanité toute entière et même au-delà (Péguy inclut les animaux dans sa « cité harmonieuse »). Mais plus on avance dans son œuvre, plus on se rend compte que le référent de ce « nous » ne peut être que Péguy lui-même ou alors un cercle très restreint. Dans Notre jeunesse, le « nous » se transforme en « je » à l’intérieur de la même phrase. De même lorsque Péguy évoque Bernard Lazare, il passe du « il » au « nous ». C’est en cela que les héros, les saints ou les prophètes intéressent Péguy. Ce sont des figures individuelles qui portent en elles le collectif et qui parfois l’éclipsent. C’est tout le problème de Péguy : que fait-on d’une inspiration collective quand on en est le seul dépositaire ?
Dans quelle mesure le civisme que Péguy appelle de ses vœux est-il compromis par le monde moderne ?
Pour Péguy, le monde moderne a ceci de particulier qu’il s’attaque à toutes les autres cultures. Il se construit contre le christianisme, contre le judaïsme, contre le monde gréco-romain, contre le monde païen. Le monde moderne est une entreprise de destruction par parasitisme. Il rend précisément impossible ce contact entre l’individu et le collectif. L’ontologie de Péguy se joue dans cette articulation, qui se traduit au mieux dans le langage chrétien que Péguy adopte. Péguy dénonce la sécheresse du monde moderne. Le christianisme à travers la grâce permet une opération d’humidification, selon l’image dont il fait usage. Le monde moderne est, lui, une toile cirée, c’est un monde imperméable. C’est ce contact décisif qui est perdu. Dans le christianisme, le pécheur – même le plus à la marge – fait toujours partie du « système ». Le problème du monde moderne, c’est qu’on ne peut même pas en être excommunié : on est toujours déjà en dehors. Dès lors, pour Péguy, tout le système s’écroule. Le monde moderne a donc cassé le civisme, mais Péguy ne se résout pas un pur pessimisme historique, car c’est l’individu qui est désormais en charge de ce civisme et qui doit attendre des conditions plus favorables pour le faire rejaillir. C’est à mon avis ce que Péguy entend par mystique. Les mystiques, comme Bernard Lazare, sont capables, malgré la dégradation, de conserver en eux, et peut-être en eux seuls, les idéaux collectifs.
La critique que fait Péguy de l’habitude et sa conception du génie (compris comme éternelle jeunesse du regard) ne l’obligent-elles pas à toujours faire renaître sa pensée ?
L’habitude est un thème d’époque, de Ravaisson à Péguy en passant par Bergson. Péguy en fait le procès. « Il y a quelque chose de pire que d’avoir une mauvaise pensée. C’est d’avoir une pensée toute faite. […] Il y a quelque chose de pire que d’avoir une âme même perverse. C’est d’avoir une âme habituée », écrit-il. Ce refus de l’habitude lui permet de prendre conscience de l’imminence de la guerre. Péguy valorise l’événement contre l’habitude. Mais il ne faut pas appliquer exagérément la pensée de Péguy à l’ensemble de ses actes. L’itinéraire personnel de Péguy est très mouvementé. Son isolement à la fin de sa vie – que ce soit dans les partis politiques, aux Cahiers de la Quinzaine ou dans sa famille – est lié à un faisceau de causes très diverses : son tempérament, son mariage qui n’est pas un mariage d’amour, sa « conversion »…
Crédit photo : Collège de France
