Serge Berstein enseigne à l’Institut d’études politiques (IEP) de Paris. Membre des conseils scientifiques de la Fondation Charles de Gaulle et de l’Institut François Mitterrand, il est l’auteur d’une biographie de Léon Blum (Fayard), d’une Histoire du gaullisme (Tempus) et il a récemment codirigé le livre Fascisme français ? (CNRS éditions). Nous revenons avec lui sur l’évolution de nos institutions et la situation politique française.
PHILITT : La France d’après 1789 est marquée par une double conception de l’incarnation démocratique : celle du Parlement représentant la nation sous la IIe ou la IIIe République et celle du chef légitimé par le suffrage universel avec le bonapartisme et le gaullisme. Notre pays souffre-t-il d’une culture politique schizophrène ?

Serge Berstein : Il est vrai que la période révolutionnaire en proclamant la souveraineté de la nation a laissé place à une double expression de cette souveraineté, donnant naissance à deux traditions qu’on retrouve à travers l’Histoire. La première est celle qui voit dans un Parlement élu la représentation légitime de la nation souveraine, les députés ayant pour mission de défendre les Droits de l’Homme et du citoyen contre un pouvoir exécutif toujours porté à abuser de ses prérogatives pour les limiter; c’est le système politique des quatre premières républiques. La seconde est celle qui considère que le maintien de l’ordre et l’efficacité de la politique gouvernementale exigent un pouvoir exécutif fort et impliquant un chef de l’État désigné par la nation et dont la fonction consiste à incarner l’intérêt national, face aux divisions partisanes dont le Parlement est le théâtre. Les deux empires du XIXe siècle relèvent de cette tradition, comme la Ve République, avec quelques nuances.
La « monarchie républicaine » voulue par de Gaulle proposait, au moins symboliquement, de réconcilier l’ancienne France, monarchique et chrétienne, et la nouvelle, républicaine et laïque. Cet équilibre fragile est-il depuis perdu ?
La Ve République telle que l’ont conçue Michel Debré et le général de Gaulle se proposait de s’appuyer sur ces deux traditions en juxtaposant un chef d’État désigné, dans un premier temps par un collège élargi d’environ 80 000 notables, garant de l’intérêt national, au-dessus des partis, avec un Parlement élu au suffrage universel et où seraient représentées les forces politiques. L’Assemblée nationale conservait un rôle important puisqu’elle votait la loi et adoptait le budget de la nation et qu’elle avait la possibilité de censurer le gouvernement en votant une motion de censure ou en refusant une question de confiance. À l’origine, le système pouvait donc être considéré, selon la pratique mise en œuvre, soit comme semi-présidentiel, soit comme parlementaire. Mais la pratique du général de Gaulle et de ses successeurs et la révision constitutionnelle de 1962 portant élection du chef de l’État au suffrage universel ont fait triompher le premier terme de l’alternative. Le général de Gaulle avait justifié cette révision en considérant qu’élu par la nation tout entière, le président serait « l’homme du pays » face aux partis représentant des fractions de celui-ci. En réalité, la nécessité de disposer d’importants moyens pour faire campagne a, dès l’origine, en 1965, fait du chef de l’État l’homme d’un parti désigné par une moitié des Français contre l’autre.
Le quinquennat, qui synchronise législatives et présidentielle, le système des primaires, ou encore l’interdiction du cumul des mandats… Ces évolutions récentes marquent-elles un retour en force des partis dans le jeu institutionnel ?
Il est clair que, depuis la première élection au suffrage universel, le scrutin présidentiel est l’affaire majeure de tous les partis politiques. Toutefois les différences entre la durée du mandat présidentiel (sept ans jusqu’en 2002) et celle du mandat de l’Assemblée nationale (cinq ans) a provoqué après 1981 une série d’élections mettant en présence un président de la République et une majorité parlementaire de sensibilités opposées et exigeant par conséquent une « cohabitation » entre le chef de l’État et un gouvernement disposant d’une majorité à l’Assemblée nationale. François Mitterrand, président de la République de 1981 à 1995 a dû ainsi s’accommoder de gouvernements de droite dirigés par Jacques Chirac de 1986 à 1988 et par Édouard Balladur de 1993 à 1995, et Jacques Chirac, élu à l’Élysée en 1995, a eu comme Premier ministre le socialiste Lionel Jospin de 1997 à 2003.

Pour mettre fin à un système bien accepté par l’opinion, qui contraignait gauche et droite à s’unir pour défendre l’intérêt national, mais frustrant pour les forces politiques, déçues qu’une victoire électorale ne leur donne pas la totalité du pouvoir, gauche et droite se sont entendues pour décider qu’à partir des élections de 2002, le mandat présidentiel serait ramené à cinq ans pour correspondre à la durée du mandat législatif et que le calendrier électoral placerait systématiquement en tête l’élection présidentielle, les législatives n’intervenant que quelques semaines plus tard. Les conséquence de cette décision sont considérables pour les institutions de la Ve République. S’il l’a jamais été, le président ne saurait être désormais « l’homme du pays » puisque, présenté par un parti, il apparaît comme le chef de ce parti qui fait élire dans la foulée de sa propre élection, une majorité à l’Assemblée nationale. On assiste donc à une désacralisation de la fonction présidentielle telle que l’avait conçue Charles de Gaulle. L’imitation du système américain des « primaires », utilisé pour la première fois en 2011 par le parti socialiste pour les élections de 2012, mais qui tend à se généraliser en vue des élections de 2017 au sein de la plupart des partis politiques implique de surcroît que c’est bien le parti qui désigne son candidat à l’issue d’une campagne électorale interne.
On ne saurait dire qu’il y a un retour en force des partis politiques dans le jeu institutionnel, car il n’a jamais cessé d’exister, ce qui est somme toute normal dans un régime démocratique, mais que les contrepoids possibles à leur toute-puissance sont de plus en plus rares, si on excepte l’arme suprême de l’article 49-3 de la Constitution qui permet au gouvernement de faire adopter un texte sans débat au Parlement, sauf si une motion de censure était adoptée (ce qui ne s’est produit qu’ une seule fois dans l’histoire de la Ve République, en 1962).
Si la connivence entre le politique et l’économique traverse les époques, la subordination du premier au second apparaît comme un phénomène nouveau. Comment croire en l’action politique si l’on pense comme Margaret Thatcher qu’ « il n’y a pas d’alternative » ?
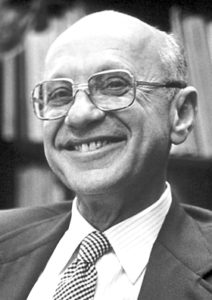
À toutes les époques de l’Histoire, les facteurs économiques ont joué un rôle important dans la vie politique, dans la mesure où ils influent directement sur la vie quotidienne des sociétés humaines. Ce rapport est probablement plus important en France que dans d’autres pays en raison du rôle essentiel qu’y joue l’État centralisé auquel les populations attribuent un rôle tutélaire. De fait, durant de longues périodes, l’activité économique se trouvant pour l’essentiel cantonnée dans le cadre national, l’État avait la possibilité de contrôler ou de stimuler la vie économique et d’intervenir à la marge dans les rapports sociaux.
Mais depuis les dernières années du XXe siècle, deux phénomènes sont intervenus qui remettent en cause cette situation. Le premier réside dans les progrès technologiques du domaine de l’informatique qui ont raccourci les distances et permis l’instantanéité de l’information. Appliqués aux secteurs économiques et financiers, ils ont aboli les frontières et permis aux entreprises multinationales et aux banques de faire jeu égal avec les États dans un univers mondialisé. Le second tient aux choix de politique économique opérés aux États-Unis et en Grande-Bretagne au début des années 1980, puis étendus progressivement au reste du monde et qui, suivant les théories de l’économiste Milton Friedman et de l’école de Chicago, consistaient à libéraliser l’économie en supprimant au maximum les réglementations, les régulations et le contrôle de l’État.
Le résultat en a été une croissance spectaculaire de l’économie mondiale, des profits considérables réalisés par les grandes entreprises multinationales, mais une stagnation des revenus des salariés, une explosion du chômage ou de la précarisation de l’emploi ; en d’autres termes un accroissement des inégalités sociales. Or ce modèle économique, s’il ne supprime pas l’action politique de l’État, ne lui laisse qu’une marge réduite. Et, comme le montre l’exemple de la Grèce dont le gouvernement avait choisi de conduire une autre politique avant de rentrer finalement dans le rang, le coût économique et social d’une telle dissidence paraît trop lourd pour être tenté par un pays isolé.
Face à l’impuissance des élites politiques actuelles à résoudre les problèmes de notre société, les Français sont de plus en plus nombreux à être séduits par la démocratie directe ou inclusive. Doit-on y voir le signe d’une déligitimisation du rôle de l’État dans l’action politique ?
Dans pratiquement tous les pays du monde, la mise en place d’une économie mondialisée et d’une société inégalitaire a suscité des réactions d’opposition de la part des laissés-pour-compte du système ainsi mis en place. La crise de 2008 et des années suivantes (dont nous ne sommes pas sortis) a provoqué une défiance envers les partis de gouvernement et la recherche de formules politiques neuves. Pour sa part, la France, championne mondiale des changements de Constitution depuis la Révolution française, a cherché dans des réformes institutionnelles la solution de ses problèmes. Mais les 23 révisions de la Constitution de la Ve République destinées à corriger quelque peu la toute-puissance du pouvoir exécutif, ont d’autant moins touché à l’essentiel, la prééminence du chef de l’État, que la demande d’autorité demeure très forte dans l’opinion. Dans ces conditions, les réactions sommaires de colère contre les gouvernants limités dans leurs possibilités d’action par le jeu économique de la mondialisation et les transferts de souveraineté au profit de l’Union européenne, s’expriment par un vote-sanction contre le parti au pouvoir. Depuis 35 ans, le pouvoir (de droite ou de gauche) a systématiquement perdu toutes les élections nationales (présidentielle ou législatives) au profit de l’opposition. Cette multiplication d’alternances semble également avoir fait son temps, donnant sa chance à l’extrême droite du Front national, forte de n’avoir jamais exercé le pouvoir et de se targuer de n’avoir aucune responsabilité dans la situation actuelle du pays. Mais l’attente de l’opinion n’est pas dans la délégitimation du rôle de l’État, mais dans son renforcement efficient
Sommes-nous dans une période de recomposition politique qui tend à dépasser le clivage gauche-droite ? Sur quels critères la politique française pourrait-t-elle se recomposer ?

Depuis la Révolution française, il existe en France un clivage droite-gauche opposant progressistes et conservateurs. Mais le contenu de ces notions a considérablement varié en fonction des problèmes fondamentaux du moment : affrontement de légitimité entre monarchistes et républicains, affrontements sociaux entre conservateurs et libéraux ou entre libéraux et socialistes… Sous la Ve République et jusqu’en 1981, l’affrontement droite-gauche s’est cristallisé autour de projets rivaux de société. Depuis cette date et le ralliement de la gauche socialiste à l’économie de marché, l’antagonisme s’est érodé sans jamais disparaître, la gauche et la droite de gouvernement proposant des gestions différentes d’une société dont aucune ne remet en cause les fondements. De surcroît, les trois périodes de cohabitation de la fin du XXe siècle ont révélé sur bien des points des zones de recouvrement entre elles (politique étrangère, politique de défense, modèle social…). Le poids contraignant de la mondialisation et de l’appartenance à l’Union européenne, en imposant des données communes à la politique économique, a encore accru cette proximité qui n’est ouvertement reconnue ni à droite, ni à gauche. En revanche, de nouveaux clivages se dessinent qui peuvent conduire à (long) terme à une recomposition politique autour des thèmes désormais centraux de la conception de la nationalité, du repli identitaire, de la poursuite ou de l’abandon de la construction européenne, des questions migratoires, etc., autrement dit d’une France repliée sur elle-même ou ouverte au monde.
De nombreux observateurs comparent la situation actuelle de la France (crise économique, défiance vis-à-vis des élites, retour des populismes, perte de souveraineté) à celle des années 30 ou à la période pré-révolutionnaire. Quelle est la validité et surtout les limites d’une telle analogie ?
Il était tentant de rapprocher la crise française actuelle qui combine des mutations mondiales bousculant idées et situations ancrées dans les consciences et les habitudes et dépression économique importante et de longue durée du dernier exemple historique connu, celui de la crise des années 30 dans laquelle on peut mutatis mutandis retrouver les mêmes ingrédients (qui sont aussi ceux des crises précédentes). Pour autant, on atteint vite les limites de ce rapprochement facile, mais artificiel. Il n’y a pratiquement aucune ressemblance entre la société des années trente et celle du début du XXIe siècle, ni dans ses structures, ni dans ses modes de vie, ni dans sa culture. Trente années de croissance n’ont pas été effacées par trente années de ralentissement économique. L’État-providence, aux antipodes de la France des années trente à peine sortie du XIXe siècle, demeure un amortisseur des aléas de l’existence. Le populisme, florissant en France comme dans bon nombre de pays européens ou extra-européens s’identifie au nationalisme fermé plus qu’au fascisme ou au communisme. L’Union européenne, sans doute insuffisante et dénigrée, demeure un atout démocratique. Nul ne sait de quoi est fait l’avenir, sauf qu’il n’est jamais un retour au passé.
