[Cet article est initialement paru dans la revue PHILITT #5 consacrée à la barbarie]
Gabriel Martinez-Gros est professeur d’histoire médiévale à l’université Paris Nanterre. Spécialiste de l’Andalousie, il s’est aussi penché sur l’œuvre d’Ibn Khaldûn, auquel il a consacré plusieurs travaux, dont Ibn Khaldûn et les sept vies de l’islam (Actes Sud, 2006). Dans sa Brève histoire des empires (Seuil, 2014), il applique de façon convaincante et originale la théorie historique d’Ibn Khaldûn à différents empires et montre qu’elle se vérifie dans une large mesure. Il a récemment publié Fascination du djihâd. Fureurs islamistes et défaite de la paix (PUF, 2016).

PHILITT : La pensée historique d’Ibn Khaldûn repose sur une dialectique entre État sédentaire et marges tribales « barbares ». Pouvez-vous nous préciser ces grands traits ?
Gabriel Martinez-Gros : Je dois d’abord préciser que j’énonce ces grands traits tels que je les ai compris. Ceci posé, je dirais que ce qui est remarquable dans sa pensée, c’est qu’elle part d’une vision économique du monde : il s’agit de savoir comment créer de la richesse dans un monde agraire qui, spontanément, n’en crée pas. Cela se fait par un phénomène artificiel qu’on appelle l’État : l’État, c’est ce qui lève l’impôt par la coercition, sur laquelle tout repose. Cet impôt permet une concentration et une accumulation de la richesse, des ressources et des hommes qui entraînent ce que nous appellerions aujourd’hui des gains de productivité. Dans la ville, dit Ibn Khaldûn, se créent des métiers qui n’existent nulle part ailleurs, à cause du raffinement des activités et de la demande. C’est par cette ramification, par cette spécialisation que la civilisation (‘umrân) obtient ses « gains de productivité », qui bénéficient à tous, y compris à ceux qui ont payé l’impôt, qui reçoivent ainsi la contrepartie de ce qu’on leur a pris par la dictature de l’impôt.
Un seul inconvénient à cette spirale admirable, que nos économistes libéraux ne sauraient trop applaudir : ce processus suppose le désarmement des populations. En effet, dit Ibn Khaldûn, une population armée ne paierait pas l’impôt, puisque l’impôt est une humiliation, une « exaction » comme on le disait au Moyen Âge, c’est-à-dire « ce que l’on tire » des populations. Vous voyez le sens que le mot a pris aujourd’hui… Une population libre, solidaire et armée repousserait nécessairement l’impôt ; il est donc du plus haut intérêt de l’État et de la civilisation, non seulement de désarmer et de désolidariser les populations, mais aussi de leur inculquer dès l’enfance une forme de crainte qui les rende tout à fait malléables au pouvoir de l’État, et qui facilite, par conséquent, cette coercition qu’est l’impôt.
L’État se trouve donc devant une impasse : il désarme matériellement et psychologiquement, alors qu’il n’est qu’une clairière de civilisation, de population dense et riche, au milieu d’une forêt de populations clairsemées mais belliqueuses puisque non soumise à l’État. L’État crée donc une situation impossible dans laquelle des masses denses et riches sont laissées à la merci de populations tribales qui vivent dans les marges et qui sont fascinées par l’extraordinaire richesse de la clairière. Que peut faire l’État ? Il n’a d’autre solution que de faire venir certaines des populations barbares des cercles périphériques pour les faire entrer à son service, de sorte que c’est aux barbares que sont dévolues les fonctions de violence.

Parmi toutes les ramifications de métier qu’opère l’État, la première est la division entre fonctions de violence et fonctions de production, qui, dans un système impérial, recouvre une distinction ethnique ; on le voit dans le monde musulman, mais aussi en Chine ou dans les derniers siècles de l’Empire romain, illustrations d’autant plus spectaculaires de la théorie d’Ibn Khaldûn que ce dernier n’en connaissait rien. Cette distinction ethnique est souvent doublée d’une distinction linguistique : dans le Caire du XIIIe siècle, le turc n’est pas nécessairement la langue naturelle de tous les membres de l’élite militaire mamelouke, mais ils l’apprennent tous dans les casernes : c’est leur langue, par opposition à la langue des sédentaires.
Peut-on dire que les sédentaires ne disposent pas de leur liberté, contrairement aux marges tribales qu’Ibn Khaldûn nomme les bédouins ?
En terme de liberté juridique, ils sont évidemment libres. Mais en terme de liberté politique, au sens à la fois grec et moderne, non, effectivement : ils n’ont aucune part à la décision politique. C’est même probablement parce qu’Ibn Khaldûn a compris cela qu’il abandonne le monde politique. En tant qu’Andalou, il appartient profondément au monde sédentaire, désarmé depuis des siècles, et en tant qu’administrateur, il sert ceux qui prennent les décisions politiques. Ce qui se fait d’ailleurs dans une autre langue que la sienne : les décisionnaires politiques avec lesquels il travaille sont en effet soit des souverains berbères au Maghreb, soit des souverains turcs en Égypte, soit des chefs de tribus arabes. Mais l’arabe de ces dernières n’est pas le même que l’arabe citadin d’Ibn Khaldûn. Les contacts avec ces tribus lui vaudront leur protection, ce qui lui permettra de se dégager du pouvoir politique. Cela n’a en effet rien d’évident, le prince n’acceptant pas, en général, qu’on le quitte : on ne quitte pas la mafia !
Le terme de mafia est assez fort ! Tout État est-il donc une forme de mafia, dans la mesure où il assure une protection en échange du paiement d’un impôt que l’on peut assimiler au racket ?
Oui, mais Ibn Khaldûn reconnaît volontiers que la protection de la mafia est indispensable au bien-être des peuples. En effet, un pouvoir barbare et tribal ne paie pas ses troupes : le roi est servi par sa tribu parce que c’est sa tribu. Il n’a pas besoin de lever beaucoup d’impôts, puisque l’essentiel de l’impôt sert à acquérir des troupes. Dans les premières générations d’une dynastie, les troupes sont gratuites. La société ne peut que s’en porter bien : quand l’impôt est faible, l’activité économique est stimulée. Ainsi, plus le pouvoir est barbare et mieux cela fonctionne, y compris pour les populations sédentaires qui sont certes exclues du choix politique, mais qui vivent mieux.
Mais le processus s’inverse à la fin d’une dynastie…
En effet, puisque les souverains se rapprochent des populations qu’ils dominent, adoptent leur langue, rompent avec leur tribu. La tribu se dissout dans la société sédentaire, parce que cette dernière assume, en mieux, toutes les fonctions assumées par la tribu : protection militaire, policière et sociale. C’est là un axiome chez Ibn Khaldûn : les hommes ne sont solidaires que s’ils y sont obligés. S’ils n’en éprouvent plus la nécessité, si l’État leur offre en mieux tout ce que leur offrait la tribu, ils n’ont plus de raison d’être solidaires. Cette thèse rencontre un écho très fort à notre époque : nous vivons dans des sociétés peu solidaires parce que nous vivons dans des États très solides. L’État remplace tout : la solidarité familiale n’a donc plus lieu d’être.
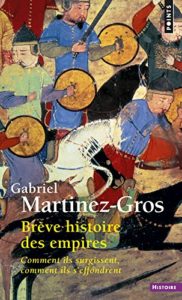
Dans votre Brève histoire des Empires, où vous utilisez la grille de lecture khaldûnienne pour analyser l’évolution de différents empires, vous écrivez qu’en fin de cycle dynastique, la levée de l’impôt ne sert plus qu’à payer les troupes : l’État est-il encore viable à ce moment ?
Au fur et à mesure que les troupes deviennent payantes, le système se dégrade. Le pouvoir doit lever de plus en plus d’impôts pour engager des mercenaires, au moment même où il est sous la pression des tribus environnantes, c’est-à-dire au moment où les régions périphériques commencent à lui échapper et où, par conséquent, sa masse fiscale se réduit. À la fin, la plupart du temps, la dynastie défait l’État : ce qui avait été accumulé dans les premières générations est dilapidé dans les dernières. La capitale est pillée par l’État parce que c’est la dernière accumulation de richesse sur laquelle l’impôt peut être levé.
De façon surprenante, vous considérez, dans la Brève histoire des empires, que les Grecs conquérants de l’Antiquité correspondent à la définition khaldûnienne du « barbare ». Faut-il en conclure que tout conquérant est un barbare ?
Tout conquérant est barbare dans la mesure où il révèle l’existence d’un empire à conquérir. Il est impossible d’imaginer que 30 000 Grecs et Macédoniens aient pu, avec Alexandre le Grand, conquérir un empire d’environ 25 millions d’habitants, correspondant à l’Empire achéménide, si ces habitants n’étaient, selon un processus khaldûnien, désarmés. C’est en ce sens que les Grecs sont des barbares. Mais à l’époque d’Alexandre, ils ont déjà inondé la Méditerranée de leur production et préparent culturellement l’Empire romain. Ce sont donc des barbares très civilisés ! J’emploie le terme de « barbare » pour signifier que les cités grecques ou le royaume de Macédoine ont conservé des structures militaires qui mobilisent très largement les populations. En face, vous avez une structure qui est proprement impériale, très khaldûnienne, – probablement la première de l’histoire – dans laquelle une infime minorité perse a désarmé des populations très majoritaires.
Dans la mesure où, à l’heure de la mondialisation, il n’y a plus guère de marges tribales, sinon extrêmement faibles et pratiquant la piraterie plutôt que la conquête, peut-on vraiment appliquer Ibn Khaldûn au monde actuel ?
C’est précisément la question : la théorie d’Ibn Khaldûn va-t-elle retrouver du lustre ou, comme le pensaient ceux qui la découvraient avec admiration dans les années 1860, appartient-elle à un monde révolu ? Ce qui permet de penser qu’elle a un avenir, c’est l’idée que la civilisation creuse sa propre tombe. Comme nous l’évoquions à propos des Grecs jouant, face à l’Empire achéménide, le rôle des barbares, il ne peut y avoir de conquérants s’il n’y a d’abord des conquis. Or la civilisation fabrique des conquis. C’est ce qu’il y a de plus provocant chez Ibn Khaldûn.
Le processus de modernisation mondiale, de civilisation, est un processus d’urbanisation, de sédentarisation, de scolarisation et de baisse de la fécondité. Il y a donc formation de ce que j’appelle « l’empire » ; il n’y a certes pas d’empire mondial, au sens où il n’y a pas d’organisation internationale qui prélève des impôts à l’échelle mondiale. Nous payons toujours nos impôts à l’échelle nationale. Les structures politiques de l’empire n’existent donc pas. En revanche, il y a une « communauté internationale », une unité de civilisation, une unité idéologique : le pacifisme profond des esprits, ce qui tend à donner une importance colossale à des marges très réduites. Songez que Daech, qui occupe les colonnes des journaux, est une organisation de 40 000 à 50 000 hommes. En 1945, Daech n’aurait pas pesé beaucoup face aux dix millions de soldats de l’Union soviétique, par exemple. Comparé aux guerres de masse de l’âge démocratique, aux millions d’hommes des deux guerres mondiales, il y a un tel abaissement de la violence des sédentarités, c’est-à-dire des empires, que cela donne des chances à de petites formations. Et là, vous vous retrouvez dans un monde très khaldûnien : pour les 7 à 8 millions de Syriens et d’Égyptiens des XIIIe et XIVe siècles, vous avez 7000 à 8000 mamelouks qui suffisent à contrôler le territoire.

D’autre part, le système que nous connaissons depuis deux siècles, celui de la révolution industrielle, fonctionne d’autant mieux que la croissance économique est plus forte. Or cette croissance donne des signes de faiblesse. Plus le gâteau à partager sera maigre, plus on sera tenté d’en venir aux armes pour en prendre une part plus importante. Ici, je pense aux cartels latino-américains ou aux bandes africaines : au Salvador, on estime que les bandes contrôlent le tiers du territoire et de la population.
Dans Fascination du djihad, vous écrivez qu’ « il n’y a d’autre recours contre la violence des bédouins, que la force démocratique ; une force démocratique qu’on doit simplement concevoir mieux partagée, plus équitable et moins arbitraire que la violence des tribus ». Mais y a-t-il vraiment un recours contre ce qui est, selon le schéma khaldûnien, une loi de l’histoire inéluctable ?
Le modèle d’Ibn Khaldûn n’est pas le seul. C’est un modèle qui s’est imposé dans l’histoire des grands États impériaux, et qui, à mon avis, nous menace. Nous pouvons sombrer dans ce modèle, mais nous n’avons aucune excuse pour cela car nous connaissons historiquement les antidotes. L’antidote majeur est le régime qui s’est mis en place, idéologiquement et politiquement, à partir de 1789, et de façon très concrète à partir de 1870 avec le service militaire, l’école obligatoire… C’est le régime de la fabrique du citoyen-soldat. S’il y avait mobilisation générale des populations, Daech ne ferait pas le poids. Mais nous n’en prenons pas le chemin. Cela est dû en partie à une première aporie, qui tient à notre conception de la démocratie : depuis 1945 pour l’Europe, et depuis les années 1960 pour les États-Unis, avec l’opposition à la guerre du Vietnam et la lutte pour les droits civiques, la démocratie est associée à la paix – ce qui est une absurdité ! Cela n’a jamais été le cas, il faut le dire franchement. Il y a quelques années, un chercheur anglais se croyait original en notant que les pays démocratiques avaient été les pays les plus belliqueux. Grande découverte en vérité : Thucydide le savait déjà ! La démocratie, précisément, ce n’est pas la paix, et c’est ce qui nous fait peur. Une véritable vision démocratique de la crise pousserait en effet à une mobilisation, par le biais d’une garde nationale par exemple, et c’est ce devant quoi nous reculons parce que dans le discours général, démocratie et paix sont liées.
L’autre aporie, qu’on peut nommer chrétienne ou freudienne, peut être exprimée ainsi : le problème de la civilisation, c’est la civilisation. Côté freudien, cela signifie que la civilisation est répression de l’eros, c’est un thanatos. Côté chrétien, il s’agit de la possibilité même d’une société sans violence. L’islam n’a pas ce problème ; l’islam réel, les États musulmans ont certes joué un rôle pacificateur, mais se sont efforcés de restreindre une violence présente dans la religion. C’est pourquoi je pense qu’un Ibn Khaldûn avait plus de chance d’apparaître dans la civilisation islamique que dans le christianisme. Pour un chrétien, il y a une difficulté à penser franchement la guerre comme une chose utile. S’il est vrai que peu de savants musulmans ont pensé la guerre dans sa réalité concrète, parce qu’elle était considérée comme propre aux barbares, Ibn Khaldûn est de ceux qui essaient de penser le rôle de la violence dans la constitution de l’État.
Vous préconisez donc d’assumer la violence démocratique. Mais n’est-ce pas déjà le cas quand nous bombardons Daech ou quand les Américains recourent largement aux drones d’attaque ?
C’est symbolique ! La violence de l’aviation est justement une mise à distance de la violence. J’entendais un jour dans un reportage un jeune pilote, dont je ne remets pas en cause le patriotisme, qui comparait son appareil à un bureau : c’est précisément le problème. Mais en réalité, il ne s’agit pas uniquement de violence : si la civilisation fait de nous des conquis, ce n’est pas seulement en nous dépouillant de notre violence, mais c’est surtout en nous dépouillant de notre solidarité. Ce n’est pas par hasard si les mouvements fascistes, qui sont tout de même parmi les grands mouvements du XXe siècle, sont nés des solidarités du combat dans les tranchées de la guerre de 1914. Les fascistes avaient redécouvert les valeurs de solidarité du combat, c’est-à-dire des valeurs barbares khaldûniennes.
[Image de Une : Extrait du manuscrit d’un traité mamelouk d’art militaire daté de 1470, Bibliothèque Nationale de France]
