Olivier François est chroniqueur littéraire à la revue Éléments et co-fondateur, avec Jacqueline de Roux, de l’association Exil H. Dans Dominique de Roux parmi nous, il a réuni les interventions prononcées le 10 juin 2017 lors du colloque organisé par Éléments et Exil H à l’occasion du quarantième anniversaire de la mort de Dominique de Roux, disparu à 41 ans le 29 mars 1977. Occasion pour PHILITT d’évoquer l’éditeur admirable et l’écrivain unique que fut le fondateur des Cahiers de l’Herne.
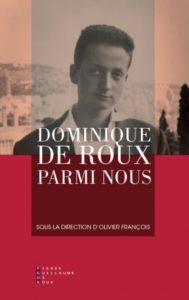
PHILITT : Dans votre introduction, vous écrivez à propos de Dominique de Roux que « les gauches et les droites ne peuvent l’utiliser aux fins de propagande, pour édifier les militants ou flatter le parti intellectuel ». Selon vous, qu’est-ce qui fait que Dominique de Roux échappe à toute forme de récupération ?
Olivier François : Issu d’une famille d’Action française – son grand-père paternel, Marie de Roux, fut l’avocat de Charles Maurras et de Léon Daudet – Dominique de Roux aurait pu rester un homme de la droite intégrale, seulement fidèle aux principes de la monarchie capétienne et du catholicisme le plus traditionaliste, attaché à défendre les valeurs d’un ordre ancien. Ou encore devenir une sorte d’anar de droite, et s’en tenir au style dandy, aux provocations hussardes, à l’ironie légère et à l’insolence superficielle. Il aurait été ainsi bien inoffensif, jouant comme d’autres un rôle d’aimable perturbateur, de subversif épatant le bourgeois, ou de justicier médiatique dénonçant la poutre dans l’œil de ses adversaires mais pour s’en faire une estrade. Mais très vite, Dominique de Roux s’est situé à une autre hauteur, en refusant les « formes mortes », ces catégories culturelles et politiques modernes insatisfaisantes pour qui cherche à retrouver les voies d’une politique, d’une littérature et d’un « style de vie » qui ne soient plus « grimaces de morts fardés » (Kazantzakis), répétitions serviles de canons et de dogmes, postures de mandarins ou petite agitation inconséquente. Lecteur en profondeur de Georges Bernanos, et plus tard de René Guénon et de Julius Evola, Dominique de Roux était assurément antimoderne ; si moderne est le règne de la quantité, la démonie de l’argent, et cet « étranglement économique, cette strangulation scientifique, froide, rectangulaire, régulière propre » que dénonçait Charles Péguy, ce Mufle-Roi dont Dimitri Merejkovski annonçait le règne au lendemain de la Première Guerre mondiale ; si moderne, enfin, est cette démocratie de marché universelle, parodie d’empire qui prétend clore l’Histoire, remplacer les peuples par des troupeaux de monades productives et aptes à la consommation. Mais Dominique de Roux n’était pas un réactionnaire ni un conservateur, surtout si l’on entend par ces deux termes un désir de restauration autoritaire, ou la médiocre défense des mœurs et des privilèges de la classe bourgeoise. Il méprisait autant la droite du fric que l’extrême droite du ressentiment, la droite obsédée de gestion et de croissance que celle qui rêve d’ordre militaire et policier. Le pamphlétaire d’Immédiatement vomissait aussi bien évidemment la gauche officielle – en dehors de quelques figures authentiquement libertaires tels Armand Robin ou son ami Jean-Michel Palmier –, cette gauche immaculée et si persuadée de son excellence morale et intellectuelle. Il ne supportait pas dans cette gauche assise ce qu’elle demeure aujourd’hui : un parti de sectaires, de flics subventionnés, d’indicateurs et de dénonciateurs, de curés et de moralisateurs, de viragos et de bourgeois simulateurs. Dans Départ, texte fondateur de la revue Exil H écrit en 1973, Dominique de Roux déclarait qu’il entendait fonder une « Cité de résistance païenne contre les institutions de l’oppression et du paraître » et chercher à « rendre compte de ce qui existe en deçà et au-delà de l’écriture ». On voit, je crois, ce qui rend Dominique de Roux toujours aussi irrécupérable.
Vous écrivez aussi que « l’Herne sonnait la charge contre les imbéciles et les assis, les avant-gardistes salonnards et les vieux notables académiques ». Comment définiriez-vous le projet littéraire de Dominique de Roux ? Qu’adorait-il et que détestait-il en littérature ?
Dès son adolescence, Dominique de Roux a lu voracement et de manière désordonnée. Il n’a jamais eu, Dieu merci, une culture scolaire, entravée par ces codes et ces interdits qu’imposent parfois les professeurs. Dominique de Roux a découvert la littérature en suivant, lui, des chemins sauvages, peu empruntés ou délaissés. Il a certes lu certains classiques – tout Balzac, notamment, et Maurice Barrès dont il connaissait par cœur les livres, aussi quelques auteurs de la famille monarchiste et contre-révolutionnaire qui se trouvaient dans la bibliothèque familiale : Maurras, Bainville, Léon Daudet – mais il s’est aussi rapidement passionné pour des isolés ayant bâti une œuvre à la marge des grands courants littéraires, ou pour des écrivains et des mouvements qu’il lui semblait nécessaire de réévaluer ou de redécouvrir . La curiosité de Dominique de Roux était aiguë, allant du romantisme allemand aux aphorismes taoïstes, de Paul-Jean Toulet à Valéry Larbaud, Paul Morand – qu’il ne prenait pas pour son personnage mondain d’homme pressé mais pour ce qu’il est vraiment, l’un des plus grands et des plus justes témoins de son siècle – Henri Michaux ou Raymond Abellio, de Musil à Georges Bernanos – qu’il sauvera des griffes cléricales et démocrates chrétiennes –, Dada et les surréalistes, et puis, plus tard, à Louis-Ferdinand Céline, Ezra Pound, Borges, Gombrowicz, à la Beat Generation dont il fut l’un des introducteurs en France, aux poètes russes de l’Âge d’Argent, Alexandre Blok et André Biely, au soldatique Ernst Von Salomon, au vibrant Elie Faure, et, plus surprenant, à Lucien Bodard, grand écrivain-reporter de la race des Kessel et des Béraud dont il admirait le talent de peintre baroque des grandeurs et servitudes de la guerre d’Indochine, ou encore, parmi les écrivains de sa génération, à des talents aussi divers que Gabriel Matzneff, Pierre Guyotat ou Michel Bernanos. Dominique de Roux avait fait sienne cette formule de Thomas de Quincey : « Une forme de la vérité, non pas une vérité cohérente et centrale mais bien latérale et divisée. » Il n’aimait donc d’abord pas les littérateurs qui ont du monde une vision univoque, et qui cherchent à mettre ce monde en fiches, à réduire le beau fatras vivant et bigarré du monde à un ordre mort, pour employer le langage de Charles Péguy. Dominique de Roux admirait et défendait les écrivains en rupture, dans le fond ou dans la forme, avec ce qu’il nommait « l’esprit de Versailles », ce lourd et sénile classicisme en talons rouges qui prend même parfois des postures d’avant-garde. Il rejetait ainsi les formalismes, les vains exercices de style et voulait trouver, à travers une écriture, une parole vivante, un homme réel et non une montagne de papier. « Toujours, derrière l’écriture, il nous faut chercher la parole vivante, ce qui en fait un acte de vie, et la ramène indéfiniment à la vie », écrit-il dans L’Écriture de Charles de Gaulle.
L’ambition de l’Herne étaient de « changer la bibliothèque comme l’avaient fait les surréalistes 40 ans plus tôt », écrit Pierre-Guillaume de Roux dans l’article qu’il a donné à notre livre collectif. « Établir de nouveaux liens. Faire resurgir les impardonnables, les malcommodes, les solitaires. » Ajoutons que Dominique de Roux ignorait la stérile opposition réactionnaire ou progressiste entre la plus longue mémoire, la fidélité envers le cœur vivant du passé et la volonté de travailler dans le présent, parfois contre le présent, à la venue d’un monde nouveau et libéré des scories de l’actuel. On comprend ainsi sa passion pour Ezra Pound, cet archéo-futuriste qui a irrigué son œuvre en lisant et méditant les sages de l’antique Chine comme les troubadours de la Provence médiévale. « Il n’y a point de futurisme qu’un passéisme ardent n’ait d’abord animé », écrivait le vieux Charles Maurras. « Ancient to the future », déclaraient les free-jazz mens de l’Art Ensemble of Chicago. Voilà qui définirait aussi bien la ligne de Dominique de Roux.

Peut-on imaginer un Dominique de Roux occupant une place centrale dans le monde des lettres ou bien son exigence, son anticonformisme et son refus de toute compromission l’obligeaient nécessairement à une forme de marginalité ? Est-il, comme Péguy ou Céline qu’il aimait tant, un vaincu magnifique ?
Dominique de Roux l’a d’abord occupée, cette place centrale dans le monde des lettres et de l’édition. Jusqu’au début des années 1970, outre les éditions de l’Herne, il s’est engagé dans de nombreuses et importantes aventures éditoriales. Il participe en 1966 à la fondation des éditions Christian Bourgois qu’il codirigera jusqu’en 1972, il dirige de 1968 à cette même année 1972 la collection 10/18, il est directeur littéraire aux Presses de la cité. On ne peut pas dire que ce soit une situation de proscrit. D’autant que Dominique de Roux, en plus des livres qu’il publie et qui trouvent un écho parmi le public cultivé, provoquant débats et polémiques, donne des articles aux Nouvelles littéraires et à Combat, intervient dans la presse, participe à quelques émissions de radio et de télévision, notamment à l’excellente série documentaire de l’ORTF, « Les Archives du XXe siècle » . Mais cela ne pouvait sans doute pas durer car il était en effet trop libre et trop « barbare » pour un petit milieu littéraire parisien qui commençait déjà à s’enliser dans les routines, les compromis et à condamner le moindre signe d’insoumission ou de divergence. Lorsqu’il publia le Cahier de l’Herne consacré à Louis-Ferdinand Céline, il reçut des lettres d’intimidations, parfois agrémentées d’un petit cercueil et de menaces de mort. Mais c’est la parution en 1972 d‘Immédiatement, recueil d’aphorismes, de notes poétiques et de charges pamphlétaires contre les grandes têtes molles de l’intelligentsia et de la politique, qui va lui attirer définitivement les foudres des basses polices intellectuelles. Il était depuis quelques temps dans leur viseur pour ses ambiguïtés politiques – Dominique de Roux est fasciste, membre d’un complot pour le rétablissement d’un ordre noir, disaient certains vigilants –, sa critique du gauchisme mondain et de toutes les bêtises bourgeoises ou prolétariennes, ses attaques contre les liquidateurs du gaullisme. Mais dans ce livre, il a osé attaquer l’idole Roland Barthes, maoïste du Collège de France, le président Pompidou et l’académicien Maurice Genevoix. Cela ne pardonnait pas et il s’est ensuivi une mise en quarantaine qui a duré jusqu’à sa mort. Fut-il pour autant un vaincu ? Je me défie un peu de l’expression vaincu magnifique. Dominique de Roux a mené une vie d’aventures et d’écriture, a publié romans et pamphlets, a édité des livres importants, révélé des écrivains et des œuvres, a « travaillé dans les misères actuelles » sans jamais céder, en restant libre, debout. Il est certes mort à 41 ans, et c’est un drame, mais être vaincu, n’est-ce pas plutôt plier l’échine, s’arranger de médiocres reniements, devenir un poussah honoré par des imbéciles plutôt que demeurer un loup sauvage gardant ses griffes et ses crocs ?
Peut-on affirmer que si Dominique de Roux n’était pas mort aussi jeune (à 41 ans le 29 mars 1977), toute la face de la littérature française aurait changé ?
Sa voix et son action, ses audaces, son courage, son refus de tous les conformismes, y compris ceux qui se donnent des airs de subversion, lui ont assurément manqué. À sa mort, ses adversaires restaient puissants et les années qui la suivirent furent un temps de basses eaux et de montée de l’insignifiance, pour reprendre les mots de Castoriadis : les grands récits politiques totalitaires, rouges ou bruns, se sont alors épuisés, mais pour être remplacé par le gris d’un libéralisme technocratique – d’ailleurs dénoncé par Dominique de Roux dans son Contre Servan-Schreiber dès 1970 –, la politique devenant gestion et communication. La littérature française fut, elle aussi, atteinte par cet épuisement. Les années 1980 auraient certainement dégoûté Dominique de Roux. Nous pouvons imaginer assez facilement sa colère et son mépris devant le spectacle télévisé d’une Marguerite Duras, les clowneries des néo-hussards ou des petits provocateurs médiatiques, les multiples reniements de tel ancien mao passé à la défense du marché et des droits de l’homme, et les vigilants censeurs veillant au maintien de l’ordre… Mais il aurait toujours mené sa guérilla contre le désordre établi, les « formes mortes », « les institutions du paraître et de l’oppression », et continuer son travail essentiel d’écrivain et d’éditeur. En 1977, il avait le projet de lancer une revue de géopolitique et venait de reprendre une série de cahiers – les Dossiers H – qui seront plus tard publiés par les éditions l’Âge d’homme et dirigés par son épouse Jacqueline de Roux. Dominique de Roux était très lié à Vladimir Dimitrijevic. Il aurait sans doute, d’une manière ou d’une autre, participé à son aventure éditoriale. Mais, qui sait, peut-être serait-il entré définitivement dans une dissidence clandestine au monde moderne en partant pour quelque maquis. Tout était possible avec Dominique de Roux.
Comment, d’après vous, aurait-il jugé l’évolution des Cahiers de l’Herne dont il fut dépossédé en 1973 ?
Sévèrement, et comme une trahison de l’esprit originel des Cahiers. L’Herne a depuis longtemps été rattrapée par l’université et par les logiques mercantiles. Les Cahiers, selon Dominique de Roux, ne devaient pas être des ouvrages hagiographiques ni de pesants collectifs de mandarins et de théoriciens, mais aborder les auteurs et les œuvres de manière « transversale, éclatée, et sans hésiter à être critique », et en laissant une grande place à la subjectivité. Aujourd’hui, à de rares exceptions, ce sont des monuments de conformismes qui font l’éloge des gloires établies – Derrida, Duras, pourquoi pas demain, Jean d’Ormesson – et de gros pavés où le parti intellectuel nous inflige ses pensums et ses thèses. Imaginez Péguy dépossédé de ses Cahiers de la quinzaine par un comité de docteurs en Sorbonne !

Dominique de Roux mêlait, de manière assez originale, la politique et la littérature, notamment à travers la figure de Charles de Gaulle. Pouvez-vous nous expliquer le sens de son engagement ? Certains soutenaient qu’il voulait être un nouveau Malraux.
Dominique de Roux aurait pu faire sienne cette déclaration, en forme de boutade, de Robert Aron et Arnaud Dandieu dans la préface de La révolution nécessaire, essai particulièrement représentatif du non-conformisme de l’entre-deux-guerres paru en 1933 : « Nous ne sommes ni de droite ni de gauche, mais s’il faut absolument nous situer en termes parlementaires, nous répétons que nous sommes à mi-chemin entre l’extrême droite et l’extrême gauche, par derrière le président, tournant le dos à l’assemblée. » Il est à cet égard encore irrécupérable. Son gaullisme révolutionnaire et international est très loin d’un souverainisme classique qui entend défendre seulement les prérogatives de l’État-nation car il est imprégné de messianisme, rêve d’empire – « De Gaulle ne sert ni l’Église avec Bossuet, ni la Contre-Révolution avec Maurras, mais la monarchie universelle, cette monarchie temporelle, visible et invisible, qu’on appelle Empire » –, et il est une volonté de dépasser les cadres de la vieille politique moderne, politique de bureaucrates et de gestionnaires. La pensée politique de Dominique de Roux relève aussi souvent d’une vision poétique irréductible aux stratégies politiciennes. Il serait donc vain d’y chercher un programme électoral ou une doctrine destinée à des militants. Pour autant on peut la rattacher, dans le contexte de la guerre froide, aux mouvements de troisième voie qui rejettent les totalitarismes collectivistes comme les démocraties ploutocratiques, et tous les impérialismes. Dominique de Roux sympathisait avec les non-alignés, et tous ceux qui refusent le cauchemar climatisé d’un monde unifié où le fatras vivant des peuples et des nations serait soumis à un ordre de mort, celui de la marchandise ou de la caserne soviétisée. Dominique de Roux trouvait dans le gaullisme – un gaullisme singulier et souvent hétérodoxe par rapport aux héritages officiels du général – une solution qui s’inspire de l’Histoire, des traditions nationales de chaque pays et de leurs spécificités sociales, hors des carcans idéologiques.
La relation de Dominique de Roux à André Malraux est ambivalente. Le jeune écrivain des années 1960 est d’abord agacé par la statue de Malraux – le ministre d’État, couvert d’honneur et célébré – et il a des mots très durs pour fustiger son musée imaginaire qu’il considère comme une tentative de « reblanchir les façades » de la culture académique. Le lecteur de Pound, de Gombrowicz et de la Beat Generation pense certainement que l’auteur des Antimémoires est passé dans le camp des formes mortes et des scléroses, de l’esprit de Versailles. Mais dans les années 1970, Dominique de Roux va rencontrer Malraux à plusieurs reprises pour tenter de l’engager dans certaines aventures portugaises et africaines. Il me semble s’être alors retrouvé, malgré la méfiance initiale, dans le Malraux aventurier et conspirateur, et, en ces années pompidoliennes, dans le défenseur d’un gaullisme sans concession avec la droite bourgeoise. Un jeune écrivain né en 1943, fondateur de la revue gaulliste non-conformiste L’Appel, fera à cette époque le lien entre les deux hommes, Olivier Germain-Thomas. J’engage nos lecteurs à lire son dernier livre, La Brocante de mai 68 et autres ouvertures, paru récemment chez Pierre-Guillaume de Roux, où il dresse un bref et beau portrait de Dominique de Roux, et évoque certains aspects méconnus du mai étudiant vu à travers le regard d’un jeune gaulliste authentique.
Quelle était « l’idée de la France » défendue par Dominique de Roux, lui qui avait diagnostiqué très tôt la décomposition de l’esprit français dans son pamphlet La France de Jean Yanne ?
Comme Bernanos avant lui, Dominique de Roux était partagé entre le dégoût et la fidélité. Dégoût pour ce qu’est devenu le vieux pays dans ses formes légales et officielles, dégoût pour une France où « tout le monde parle désormais comme les journalistes de l’Express », et qui a oublié ses vertus aristocratiques et populaires pour se livrer à une caste fascinée par les vainqueurs du jour – et collaborant avec les tous les impérialismes – ; une France crétinisée par les modes et s’engouffrant dans toutes les impasses idéologiques ou s’abandonnant, avec un lâche soulagement, à la médiocrité et aux routines politiciennes. Mais Dominique de Roux croyait fidèlement à la vocation singulièrement universelle de la France. Elle demeurait pour lui, disons-le avec les mots de Bernanos, « une chance pour les hommes libres qui ne veulent pas céder aux mutants et aux robots ». On dira qu’il se faisait une certaine idée de la France, mais elle n’avait rien d’une abstraction. Dominique de Roux se tournait vers les horizons lointains, vers les afriques et les orients, mais il était aussi – certaines pages des ses livres et de sa merveilleuse correspondance en témoignent – un homme de la glèbe, un homme de piété, charnellement amoureux de son pays. Il n’avait pas oublié la terre et les morts.
© photo Patrick Chauvel
