Grégor Puppinck est docteur en droit, expert auprès du Conseil de l’Europe et directeur du Centre européen pour le droit et la justice (ECLJ). Il a reçu, en 2016, le prix de l’humanisme chrétien pour son ouvrage La Famille, les droits de l’homme et la vie éternelle (l’Homme Nouveau). Il vient de publier Les droits de l’homme dénaturé aux éditions du Cerf, où il aborde la question des héritages et des réinterprétations de la Déclaration universelle des droits de l’homme, dont nous fêtons les soixante-dix ans le 10 décembre.
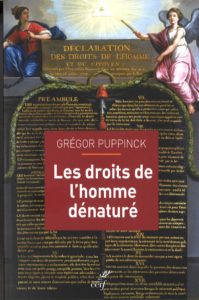
PHILITT : Vous distinguez trois étapes ayant marqué l’interprétation des droits de l’homme : les droits naturels, les droits antinaturels et les droits transhumains ou transnaturels. Quels sont les critères distinctifs de chacune de ces étapes ?
Grégor Puppinck : Je propose trois étapes pour survoler le parcours historique depuis 1948. Tout d’abord, en réaction aux totalitarismes d’inspiration progressiste-matérialiste, les droits de l’homme de 1948 ont réaffirmé l’existence de la nature humaine, de sa dignité, et la primauté de la personne. Ce sont les « droits naturels de l’homme ». Puis, dans un second temps, l’individualisme a opposé, au sein de la nature humaine, l’esprit à la matière pour faire prévaloir la volonté sur les corps. C’est ce que j’appelle les « droits antinaturels de l’individu ». Enfin, le transhumanisme affirme qu’il appartient à l’esprit de gouverner la matière. Ce sont les droits transhumains ou transnaturels. Le fil conducteur de cette évolution est l’autonomisation de la conscience à l’égard de la nature.
Les droits naturels de l’homme reposent sur l’idée que l’homme est un être harmonieux qui participe à un tout harmonieux. C’est conformément à cette nature humaine que nous pouvons nous épanouir. Selon cette approche, le destin d’un être humain consiste à accomplir en lui toutes les facultés de la nature humaine, comme apprendre, développer les qualités et la vertu, se marier… Cette conception du droit naturel repose sur une anthropologie qui se veut réaliste et à partir de laquelle sont déduites toutes les conditions nécessaires pour qu’un homme soit heureux. On part en effet du postulat empirique selon lequel l’homme est un être, un être vivant, comme tous les animaux et les végétaux, mais aussi d’après lequel il est un être vivant social et également spirituel détenant une capacité de penser sur lui-même et de rechercher la vérité. Ces quatre caractères fondamentaux de la nature humaine structurent notre existence et notre personnalité. C’est par ces caractères que l’on peut déduire ce qui est bon ou mauvais pour la personne. Tout ce qui permet à une personne de rester en vie, croître, développer ses facultés, se reproduire ou connaître la vérité sur le monde et sur lui-même participe au bien de la personne. À l’inverse, tout ce qui porte préjudice à son existence physique et à son bien-être social ou spirituel constitue un mal. Selon cette perspective, les droits de l’homme visent à garantir à chaque personne le respect, par l’État, de l’exercice des facultés par lesquelles chacun s’humanise. L’État doit non seulement s’abstenir de porter atteinte à ces facultés mais aussi y concourir et les soutenir autant qu’il le peut. D’après cette conception, le bonheur consiste à accomplir au mieux ces facultés. Il s’agit donc d’une conception assez simple et assez humble de la vie sociale.

Les droits antinaturels de l’individu se fondent sur un rapport différent à la nature. Cette conception postule que le bonheur et la dignité humaine ne consistent pas simplement à accomplir une nature donnée avec la naissance, mais à rechercher une affirmation de soi au-delà de ce qui nous est donné avec la naissance. On passe ainsi d’une conception paisible et harmonieuse de la nature humaine à une conception plus conquérante et insatisfaite de celle-ci, selon laquelle chaque personne devrait accroître son pouvoir sur elle-même et sur son environnement pour élever plus haut sa dignité individuelle. À l’origine des droits antinaturels se trouve une conception dualiste de la nature humaine, postulant que tout ce qui permet d’affirmer la primauté de l’esprit sur le corps exprime la spécificité de notre humanité : sa dignité. Il s’agit donc non plus d’un accomplissement de la nature humaine mais d’une libération de l’homme à l’égard de son corps et de sa nature. On passe de l’idée de faculté à celle de pouvoir ou de puissance. Naît ainsi une conception des droits fondée sur l’opposition et sur la confrontation, puisque ces droits nient plutôt qu’ils ne construisent, comme en témoignent le droit à l’avortement ou à l’euthanasie.
Dans le prolongement des droits antinaturels apparaissent les droits transnaturels. Ces droits ne cherchent plus seulement à garantir la libération mais également l’amélioration. On passe du critère d’opposition dans le cas des droits antinaturels à une prétention au contrôle en ce qui concerne les droits transnaturels. On prétend ainsi transcender la nature en la transformant. La puissance humaine doit s’exercer par la transformation de la nature, et l’extension de la puissance humaine sur le corps humain devient un signe d’une plus grande dignité.
La différence fondamentale des droits antinaturels et transnaturels vis-à-vis des droits naturels repose sur l’idée de disharmonie entre la volonté et la matière, l’esprit et le corps. L’homme est perçu comme essentiellement spirituel, sa vie n’étant qu’un simple élément biologique, un mouvement vital fondé sur un corps animal.
Chaque génération tend à de nouveaux développements des droits. Les droits naturels visaient surtout l’objectif de protection de la personne humaine, tandis que les droits antinaturels sont portés par l’idéal de libération ou d’émancipation de l’individu, tandis que les droits transnaturels visent à présent l’amélioration de l’humanité. Cette idée d’amélioration est à comprendre dans un sens large, comme augmentation du pouvoir de l’homme sur lui-même dont devrait résulter une amélioration de sa condition. Une nouvelle génération de droits va procéder de cet objectif : des droits à réaliser des désirs au-delà de la nature. Ils se multiplieront à mesure que les technosciences accroîtront notre pouvoir.
Vous dites que les droits transhumains proposent une vision positive de l’État, perçu comme le moyen principal de satisfaire les désirs individuels, à la différence d’une certaine hostilité à l’État visible dans les droits naturels. Pourtant, le courant libertarien, hostile à l’intervention étatique et favorable à la régulation des désirs par le marché, est massivement représenté au sein du transhumanisme, notamment dans la Silicon Valley. Comment expliquer ce paradoxe ?

En 1948, l’approche personnaliste cherche à garantir la possibilité pour les personnes de s’accomplir par elles-mêmes, la société étant ordonnée de façon subsidiaire à cet objectif. Il s’agit d’offrir à chacun le maximum de facultés pour atteindre le bonheur. Or, le développement des techniques requiert l’intervention de puissances supérieures à l’individu, qu’il s’agisse de la puissance de l’État ou de celle des entreprises. Ces deux puissances ont en commun de dominer les personnes et d’offrir les conditions par lesquelles celles-ci cherchent à réaliser leurs désirs. Dans les deux cas, les personnes perdent leur autonomie véritable au profit de ces structures, qu’elles soient privées ou publiques. Cette tendance apparaît de manière manifeste, par exemple, dans toutes les techniques de procréation médicale ou dans l’euthanasie, qui est censée être un geste d’absolue liberté individuelle mais dont la réalisation est de plus en plus confiée à l’État et à des entreprises privées. Je ne vois donc pas de différence fondamentale entre l’entreprise et l’État. Je dirais plutôt qu’il s’agit d’une question de culture : dans un pays marqué par une culture étatiste comme la France, c’est l’État qui devient l’instrument de la réalisation et de la régulation des désirs, tandis que, dans des cultures de type californien, on voit plutôt l’entreprise privée réaliser cette tâche. Mais dans les deux cas, l’individu est aliéné par une entité qui le dépasse et devient dépendant d’une structure qui lui propose à la fois des désirs et les moyens de les réaliser.
Vous décrivez les droits transhumains comme induisant un « dépassement de la démocratie représentative ». En quoi le transhumanisme met-il la démocratie à mal ?
En fait, ce n’est pas tant le transhumanisme en tant que tel qui met la démocratie à mal mais plutôt la troisième génération des droits de l’homme. Tant que le fondement anthropologique de la dignité humaine est clair et partagé, l’interprétation des droits de l’homme ne peut pas être trop évolutive. Aujourd’hui, le fait que l’interprétation des droits de l’homme ne repose plus sur un ancrage aussi affirmé dans la nature humaine permet au juge de s’éloigner de plus en plus de l’intention originelle des rédacteurs et de proposer une interprétation de plus en plus large et extensive des droits de l’homme. Ceux-ci deviennent un instrument capable d’imposer de nouveaux « droits » découlant de nouvelles conceptions de l’homme aux États et aux peuples sans que ceux-ci les aient acceptés. Le caractère supranational des droits de l’homme détachés de l’anthropologie permet donc un dépassement de la démocratie et des volontés nationales. Il est vrai que les droits de l’homme se sont présentés comme dominant la politique nationale dès l’origine, en 1948. Malgré tout, on assiste depuis lors à une nouveauté, puisque l’interprétation des droits de l’homme est aujourd’hui guidée par une conception indéfinie et indéterminée de la nature humaine. En effet, la définition juridique de la nature humaine n’est plus consensuelle mais elle se nourrit d’une idée de progrès, lequel est identifié à l’accroissement de la puissance individuelle. En ce sens, la démocratie fondée sur le suffrage est limitée par des instances initialement chargées par les États de faire respecter leur engagement conventionnel. Ces instances supranationales tentent désormais de contraindre ces mêmes États à modifier leur législation d’une manière de plus en plus accrue. Ces institutions considèrent de moins en moins le suffrage comme la principale source de la légitimité.
