Érick Audouard est écrivain et traducteur. Il a fait découvrir au public français Leonardo Castellani, prêtre et penseur argentin inclassable, à travers une sélection de textes intitulée Le Verbe dans le sang (Pierre-Guillaume de Roux, 2017). Chez le même éditeur, il a fait paraître Comprendre l’apocalypse, reprise enrichie d’une conférence donnée au Cercle Aristote autour des écrits apocalyptiques de Leonardo Castellani et de René Girard. Avec une vigueur parfois lapidaire, mais non sans humour, cet opuscule invite à revenir aux véritables causes de la crise contemporaine pour identifier les questions essentielles qui se posent à nous.

PHILITT : En vous appuyant sur les travaux de René Girard, vous affirmez que l’idée de l’apocalypse tient en ce que la violence constitutive de la culture humaine finira par se déchaîner sans limites. Est-ce bien ce que nous observons ? Certains statisticiens vous opposeraient un constat plus optimiste, en se fondant sur des mesures faisant état d’une diminution constante de la violence depuis 1945.
S’il y a bien une chose que nous savons aujourd’hui, c’est que nous sommes en train de nous détruire. Il existe un tas d’excellentes prospectives, très scientifiques et très documentées, sur la proximité du précipice. Les signes viennent de partout et ils viennent en même temps. Les reprendre en détail n’est d’ailleurs pas mon objet. Ce qui manque à tout cela c’est l’unité, l’orientation. L’étendue de la crise est sans aucune mesure, parce qu’elle embrasse absolument tous les domaines, y compris et surtout la capacité des hommes à vivre entre eux. Maintenant, si l’on ne sent pas le vertige de la chute, ça ne signifie pas qu’on cesse de tomber, mais qu’on a perdu le sens de la gravité. Ou qu’on prend une défenestration pour un essor. Ces statisticiens auront encore le nez dans leurs colonnes comptables quand leurs cheveux prendront feu. Qui a encore envie de parler avec ceux qui trouvent que tout va de mieux en mieux ? Je m’adresse aux angoissés et aux nostalgiques, dont la lucidité et la sensibilité ne sont pas détruites.
Ce déchaînement de violence semble en contradiction avec le « douillet marécage où l’humanité voudrait s’abolir » que vous mentionnez dans votre préface à l’anthologie de Leonardo Castellani. Si l’homme aspire aujourd’hui, selon vous, à une « servitude confortable et sans fin », ne faudrait-il pas s’attendre dans un proche avenir à l’avènement d’une sorte de paix mondiale ?
Ce serait une erreur de croire que le règne de la tiédeur s’impose sans persécution. Rien de plus violent que la volonté de faire disparaître toute violence par la force. Cette volonté est un fait historique inédit ; elle s’est radicalisée depuis la Seconde Guerre mondiale, en faisant miroiter l’espoir d’un blanchiment des consciences, d’une magnifique épuration du désir, devenu enfin innocent et transparent à lui-même. Dans la mentalité actuelle, il est désormais hors de question de faire sa part au mal. Et ceci est le plus grand mal qu’on puisse faire, car c’est la liberté humaine qu’on éradique. Le totalitarisme en cours promeut effectivement la paix, la tolérance, le paradis sur terre : il est la Paix en marche, qui entend supprimer tout ce qui résiste encore à son appétit de maîtrise. Mais c’est au moment où nous idolâtrons la Paix et la Sécurité que subitement la catastrophe nous tombe dessus.
La vraie question anthropologique concerne la façon dont les hommes parviennent ou non à organiser leur violence intrinsèque. Depuis la fin de l’institution guerrière, la violence n’a pas cessé, elle s’est formidablement sophistiquée, externalisée, automatisée, technologisée, de telle sorte que la plupart des individus ont l’impression de ne pas l’exercer du tout. Or, la société dite de consommation est à la fois la plus clémente et la plus dévastatrice de toutes les sociétés depuis le début des temps. En quelques décades à peine, elle aura littéralement défiguré la face du monde. Pour vivre en paix, nous avons uniformisé et stérilisé les modes vies, nous avons épuisé nos ressources, asphyxié jusqu’aux océans, laissé aux improbables générations futures des déchets qui non seulement leur survivront mais causeront leur perte. Y a-t-il encore quelqu’un pour qui l’exploitation et la manipulation outrancière du vivant ne sont pas un pur et simple massacre ? Toujours plus d’exploitation, plus de manipulation, comme si nous avions pour but l’immolation suprême. Par bien des aspects, la forme de société que nous connaissons ressemble à ces absurdes systèmes religieux qui cherchaient à se régénérer dans le sang de leur propre holocauste, comme celui des Aztèques du XVe siècle… Et d’autres sacrifices arrivent, si terrifiants que personne ne pourra y échapper. Nous commençons à en prendre conscience. Mais voilà, toutes les crises éclatent simultanément – culturelle, environnementale, économique, politique, morale, spirituelle – et nous ne savons plus à qui nous adresser, à qui faire confiance, parce que nous avons perdu foi dans la vérité.

Dans un de ses journaux, Charles Baudelaire écrivait ceci : « Nous périrons par où nous avons cru vivre. La mécanique nous aura tellement américanisés, le progrès aura si bien atrophié en nous toute la partie spirituelle, que rien, parmi les rêveries sanguinaires, sacrilèges ou anti-naturelles des utopistes, ne pourra être comparé à ses résultats positifs. » Serait-ce une impeccable prophétie apocalyptique ?
Baudelaire est l’un de nos plus grands apocalypticiens, et c’est parce qu’il était chrétien qu’il a développé ce genre d’intuitions saisissantes. Comme je le précise dans mon opuscule, c’est son sens aigu du péché originel et la profonde catholicité de son jugement qui lui ont permis de voir que nous étions en train de dégringoler de plusieurs crans dans l’abîme. Non seulement nous ne sommes jamais remontés, mais nous nous sommes entassés au fond du trou, en espérant y prendre nos aises. Nous y aurons tout perdu, jusqu’à notre identité.
S’il revenait par chez nous, le poète de L’Aube spirituelle ne jugerait pas notre spiritualité « atrophiée », il en verrait l’ensorcellement, la possession. Il serait scandalisé par la fusion quasi orgiaque de la mécanisation avec un spiritualisme délirant – ce techno-spiritualisme puritain qui a déclaré une guerre à mort au réel, à la chair – comme il serait scandalisé par les noces d’Orphée et de Pavlov, cet abominable coït dont parlait Aldous Huxley à propos de la publicité. Le plus admirable chez Baudelaire, c’est que son anti-modernisme ne l’a jamais obnubilé au point de lui masquer l’essentiel. Il savait à qui s’adresser, et ce n’était pas à la mort. Il pratiquait l’oraison comme personne : son dialogue avec Dieu, intense et tourmenté, a quelque chose de véritablement biblique – qui le met très au-dessus des actuels critiques de la crise, ainsi que des autres poètes de notre langue.
Bernanos disait de la civilisation moderne qu’elle était « une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure ». N’est-ce pas ce dont parlent René Girard et Leonardo Castellani, l’un en dénonçant la mobilisation des individus vers le pire, l’autre en s’attaquant à la falsification du christianisme ?
Certainement… Ne serions-nous pas désormais en mesure de nous passer de l’épithète « intérieure » dans la célèbre phrase que vous citez ? J’ai parfois l’impression qu’il s’agit de la seule économie que nous ayons faite. Car c’est bien la vie tout court que l’ivrognerie modernisatrice conspire à exterminer. Comble de la dérision, elle répand l’abomination de la désolation au nom de la Vie – dont elle ne sait à peu près rien. Hors contexte, cette citation de Bernanos a un défaut : elle tend à désigner la modernité comme une force externe, hostile aux désirs authentiques des hommes, dont le plus pressant serait de se lever chaque matin avec une pelle pour s’en aller creuser leur intériorité. Est-ce le cas ? La plupart du temps, nous ne sommes réellement approfondis que par effraction, par tout ce qui contrarie nos prévisions, nos programmes, notre « bien-être », c’est-à-dire par tout ce que notre époque a en horreur et qu’elle maudit de toutes ses fibres, comme la souffrance, la maladie, la pauvreté, l’échec, ou l’humiliation, par exemple… Citons au passage, parce qu’elle est d’un autre âge, la formule de Blanc de Saint-Bonnet, reprise par Bloy : « L’homme a des endroits de son cœur qui n’existent pas encore, et où la douleur entre, afin qu’ils soient »… Il est légitime d’attendre avec impatience la fin du système, de nourrir quelque espoir de saines restaurations – mais si le champ se réduit au domaine économique, si l’on pense que la rareté des marchandises explique tout, ou qu’il suffira de retrouver le sens des « limites » pour redevenir « authentiques et solidaires », c’est peu dire qu’on ne va pas assez loin dans l’identification du problème. L’homme actuel n’est pas réformable à ce prix. Nous sommes passés d’une vie sous le regard de Dieu à une existence sous le regard des Autres. Dans ces conditions d’idolâtrie, comment peut-on croire que l’intériorité et la charité nous tomberont tout à coup du ciel ?

Bref, il ne faut pas s’étonner que notre univers égalitaire – en produisant une indifférenciation sans précédent – soit aussi le champion de la superficialité. On sous-estime systématiquement les ravages de la compétition qu’il déchaîne : nous ne voulons pas voir que nous sommes tous en train de faire la même chose, à savoir nous anéantir en désirant de préférence ce qui se refuse à nous. Tant d’hommes semblent avoir pris goût au néant, le rechercher pour lui-même, vouloir s’y distinguer par plus d’insignifiance et plus de perversion encore ; ils s’éclairent au soleil de Satan – comme le voyait le grand Georges –, ne connaissant plus qu’afin de détruire, pour renouveler dans la destruction leur connaissance et leur désir… L’aveuglement est tel que nous sommes contraints de penser en termes de pathologie générale, sinon de démonologie collective – plutôt que dans le cadre rassurant des bonnes vieilles catégories philosophiques et politiques, qui ne correspondent pas à la réalité des choses.
Vous commencez votre livre en vous présentant comme écrivain et non comme historien des idées. Qu’est-ce qui amène un écrivain à s’intéresser à un sujet aussi général ou « théorique » que l’apocalypse ?
En l’espèce, « écrivain » signifie que je ne suis pas plus universitaire qu’astrologue. Je m’intéresse à ce qui se passe entre les êtres humains – à ce qui s’y passe encore – sans beaucoup d’autres qualités que celle d’appartenir au genre. Or, ce que je constate, ce n’est pas une croissance de la communion et de la joie, mais que nous n’arrêtons pas de nous diviser, que nous nous éloignons de plus en plus les uns des autres, un peu comme les astres dans le froid de la nuit cosmique. J’ai donc témoigné d’un fait à mes yeux manifeste: l’eschatologie chrétienne nous permet de saisir très exactement ce qui est en train de nous arriver. Leonardo Castellani et René Girard en avaient la conviction. Ils n’ont pas eu peur d’en faire part ; je les ai imités sur cette voie. Aujourd’hui, tout le monde ou presque interprète les événements en termes apocalyptiques – sauf les chrétiens. C’est un phénomène très surprenant, car l’apocalypse n’est rien d’autre que la Révélation. Discréditée et minée en son sein, l’Église ne l’enseigne plus guère ; elle a beau être frappée d’aphasie, c’est elle qui détient le sens de l’histoire et les outils les plus pertinents, les plus puissants, pour comprendre la situation catastrophique qui est la nôtre. Ce n’est pas une surprise : l’Église a toujours été la spécialiste du naufrage universel – avec des compétences toutes particulières pour les opérations de sauvetage, évidemment.
Vous êtes très sévère à l’égard de votre contemporain. Vous brossez le portrait d’ « un roi sans foi ni loi » pour lequel « tout est jugé sous l’angle du plaisant, du facile, du pratique et de l’agréable » – ce qui peut paraître injuste, au regard de la détresse croissante de beaucoup d’individus.
Je ne nie pas la détresse actuelle. Au contraire, il me semble qu’elle n’a jamais été plus répandue qu’aujourd’hui. Elle est même en train de basculer dans un désespoir virulent et suicidaire – alors que nous baignons dans l’hédonisme et que nous jouissons de « facilités » dont n’auraient pas osé rêver nos ancêtres. Mais quelle est la cause de cette détresse ? Dans quelles illusions s’enracine-t-elle? Est-ce en nous séduisant les uns les autres que nous nous donnerons les moyens d’affronter l’existence? On m’a aussi reproché de transmettre l’inquiétude au lieu de l’espérance – voire de communiquer l’épouvante au lieu de la consolation. Toutes ces critiques sont audibles. Psychologiquement parlant, il n’y a pas d’incohérence. Quand nous serons réellement attentifs, c’est-à-dire épouvantablement inquiets de l’état de notre âme, le temps viendra peut-être de parler d’espérance et de consolation.
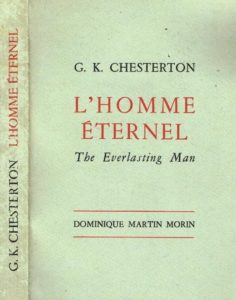
Il y a des idées si livides qu’on doit les gifler pour leur redonner des couleurs. L’idée d’humanité en fait partie. Au fond, la technologie et ses dispositifs ont pris cette place effarante dans nos existences parce qu’il n’y a plus quelque chose comme l’Homme en soi – cet Everlasting Man que chantait Chesterton dans les années vingt du siècle dernier. Depuis un bon moment, l’homme est un puzzle vendu au détail. Abstrait, segmenté, disséminé dans ses fonctions et volatilisé dans une rivalité permanente avec son prochain, à peine survit-il encore à travers quelque vague notion d’ « espèce humaine » – bientôt susceptible de joyeuses subdivisions, à grands renforts de droits contractuels, cela va de soi… Nous avons cru nous en sortir en réduisant le drame de notre condition, mais nous n’avons fait que nous désarmer complètement. N’en déplaise à la morale minimaliste de l’époque et à ses petits comités d’éthique, l’homme est bien plus grand et bien plus vil que nous ne l’imaginons. Et il est rarement aussi grand que lorsqu’il fait face à sa propre misère.
Est-ce parce que nous avons oublié les fins dernières et la quête du salut que notre époque devient folle, ou est-ce parce que notre époque devient folle que nous oublions notre salut et les fins dernières ?
Ce ne sont pas deux phénomènes séparés, bien entendu. Le premier engendre le second, de façon très logique. Le chaos auquel nous assistons est à la fois suprêmement inquiétant et merveilleusement révélateur sur ce point. Les désordres du désir sont les fruits pourris d’une transcendance égarée. La modernité n’est rien d’autre que cet égarement. Et plus c’est moderne, plus c’est toujours la même chose… Prenons le champ politique : la corruption des politiciens existe, mais ce n’est pas la corruption qui l’a dégradé, c’est notre désarroi métaphysique qui l’a envahi, au point d’en faire cet asile de fous, écartelé entre des injonctions contradictoires plus ou moins aberrantes. Si les choses se sont durcies, elles se sont aussi beaucoup éclaircies ; comme l’avait prédit Castellani, tout prend dorénavant la forme d’un dernier combat religieux : d’un côté, une sorte de « panthéisme athée » qui sombre dans l’irrationnel, pour ne pas dire dans la démence, et de l’autre, la religion gardienne de la raison. Dans ce combat final, l’ennemi paraît triompher ; il se déchaîne en multipliant les atteintes au bon sens, en cherchant à frapper de paralysie jusqu’à la faculté de juger : il faut qu’il n’y ait plus que des fausses nouvelles pour annuler la Bonne Nouvelle.
Nos craintes ne doivent pas concerner l’issue du conflit. Tant que l’homme sera homme, il lui sera impossible de se débarrasser du salut, de la rédemption, de son aspiration à l’infini. L’ennui n’est pas qu’il les cherche, mais qu’il les cherche partout où il n’a aucune chance de les trouver.
Vous dites que c’est « notre tradition » qui est la mieux placée pour comprendre l’état du monde actuel. Ne pensez-vous pas que d’autres traditions puissent être d’un apport tout aussi pertinent pour la critique du monde contemporain, comme le pensait René Guénon en opposant l’ensemble des civilisations traditionnelles et la civilisation moderne ?
Bien des traditions sont admirables par leur beauté, par leur dignité, par leur piété, par leur rapport au vivant, par l’étendue de leur sagesse. Leur écrasement sous le rouleau compresseur du « progrès » a de quoi faire pleurer, et pourtant, la réponse honnête à votre question est non. D’abord, parce que c’est sur le corps agonisant de la chrétienté que la civilisation moderne a poussé, pour contaminer le reste du globe ensuite. C’est contre la chrétienté, parfois tout contre, qu’elle s’est développée, en sécularisant ses dogmes, en les morcelant, en les recyclant sous une forme pervertie ou mutilée, comme toute hérésie qui se respecte. Toute absurdité nous prive d’un sens qui lui préexiste, et toute aberration est la déviation d’une voie juste et sensée. Comment espérer rencontrer quelque chose d’intelligible si nous ignorons ce sens et cette voie ?
Au cours de sa prodigieuse falsification du christianisme, qui est allée jusqu’à l’inversion totale, notre civilisation en aura retenu une chose essentielle, une chose dont elle a fait son absolu – pour le meilleur et pour le pire – à la fois condition de son essor foudroyant et cause de son extrême vulnérabilité : l’interdiction du sacrifice humain rituel et le souci des victimes qui en découle. Si on ne voit pas cela, on ne voit rien. Nietzsche l’avait très bien vu, et il le déplorait, comme on sait, car cette interdiction et ce souci étaient pour lui responsables de la dégénérescence occidentale, en regard des civilisations à l’ancienne, sacrificielles et plus « viriles ».
Cela étant, ayons le courage de poser la question : le polythéisme, le bouddhisme, le soufisme ou je ne sais quelle Weltanschauung amérindienne sont-ils armés pour saisir l’étrangeté de notre univers et les effroyables dilemmes auxquels nous sommes confrontés ? Est-ce dans la posture du lotus qu’on a des chances d’avancer d’un pouce dans la compréhension de notre désastre historique ? Jamais la tentation ne fut plus grande de s’évader, de se divertir, de se mentir à soi-même, en s’abritant dans des croyances et des mythologies aussi précaires qu’illusoires.

Il est nécessaire d’ajouter que la religion catholique est plus qu’une tradition, plus qu’un culte, qu’une philosophie ou qu’une spiritualité : par dessus tout cela, c’est un défi divin lancé à la face de la nature humaine – invitée à se dépasser elle-même, à sortir du vieil homme, comme Saint Paul l’affirme avec vigueur. C’est aussi la seule religion à se formuler comme vraie, comme foi et comme raison radicalement informée par la lumière de la vérité : aucune autre tradition n’a jamais eu une telle prétention à l’universalité, et c’est bien cette scandaleuse « exclusivité de l’universel » qui fait l’objet des assauts de la furie relativiste contemporaine. Soulignons que, même chez les chrétiens, presque plus personne ne reconnaît l’originalité inouïe de la Bible. Peut-être cela vient-il de l’ignorance et de l’ingratitude des temps, peut-être aussi d’une forme d’orgueil particulièrement coriace, propre aux intellectuels européens d’abord. Demandons-leur s’il y a un seul équivalent, dans toute l’histoire du monde, d’un tel livre qui menace et condamne son peuple en permanence, qui invective et qui admoneste jusqu’aux disciples de l’Évangile – lequel Évangile les avertit en termes clairs et précis de leur autodestruction prochaine, s’ils n’obéissent pas aux commandements…
Notre situation est tout à fait extraordinaire – si l’on y pense – car tandis que nous essayons d’enterrer la religio vera dans un petit espace ridiculement privé et folklorique, ses textes annoncent depuis 2000 ans que c’est justement ce que nous ferons. Pendant que le système du monde s’écroule, elle nous dit comment et pourquoi il s’écroule – non sans la promesse d’une miséricorde infinie, notez bien.
Enfin, quoi de plus désespérant que la croyance en une histoire cyclique, éternellement répétée, ou en une amélioration toujours à venir, demain ou après-demain, comme si nous n’étions pas ici et maintenant en contact imminent avec l’absolu ? Le Royaume des Cieux ne devient pas : il advient. Au fond, je pense que le sens de ce qui nous arrive nous échappe parce que nous refusons les conséquences de cette discontinuité radicale. Notre monde cherche à distraire les hommes pendant qu’ils attendent, et à les distraire de l’attente elle-même, pour qu’ils ne pensent plus du tout au retour du Christ.
