Arnaud Teyssier est historien, spécialiste de la Ve République dont il est un des meilleurs connaisseurs. Il est également le biographe de Charles Péguy et de Philippe Séguin avec qui il travailla à l’Assemblée nationale. Il vient de faire paraître De Gaulle, 1969 aux éditions Perrin. Il revient pour PHILITT sur cette dernière année au pouvoir du Général de Gaulle qui est trop souvent mal interprétée.
PHILITT : Dans votre livre, vous écrivez que Charles de Gaulle a « fort bien compris qu’un personnage nouveau est apparu dans l’histoire du pays : la société ». Il ne fut donc pas dépassé par les événements de Mai 68 ?
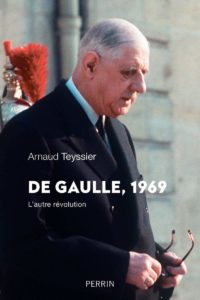
Arnaud Teyssier : Il n’a pas été dépassé, mais pris de court, brisé dans son élan. Il voyait depuis longtemps se dessiner, bien au-delà de la guerre elle-même, du nazisme, du totalitarisme, un bouleversement de civilisation qui apporterait la suprématie absolue de la technique et soumettrait l’individu – alors même qu’il se croirait libéré et épanoui – à de nouvelles et terribles formes d’asservissement. Pendant la guerre, il l’avait déjà annoncé par son célèbre discours d’Oxford, et cette idée ne l’a jamais quitté. C’est une pensée qu’il partageait avec Simone Weil, qui avait rejoint Londres et mourut avant d’avoir pu achever sa très belle tragédie historique, Venise sauvée. Elle y évoquait « le malheur destructeur du “je” ».
En bon lecteur de Péguy et de L’Argent, de Gaulle voyait donc loin, mais il n’a pas vu venir assez vite la crise étudiante du printemps 68, bientôt grossie d’un très large mouvement social. C’était un symptôme, évidemment, mais seulement un symptôme, de ce mal plus profond qu’il appréhendait. Il était de surcroît un peu désarmé devant le caractère inédit, souvent ludique ou puéril, de cette fausse « révolution » contre laquelle il ne pouvait lutter avec la même aisance ni les mêmes outils que ceux dont il avait usé dans ses combats de jadis et naguère – l’OAS encore, six ans plutôt. Je crois qu’il a été aussi très frappé, à cette occasion, de l’extrême fragilité du système institutionnel qu’il avait mis en place, moins surpris, sans doute, par la démission généralisée des élites : au total, il a dû dénouer la crise lui-même, et donc s’atteler aussitôt, dans la précipitation, aux réformes auxquelles il songeait depuis des années. Selon sa propre expression, « il s’est “ressaisi” et a “ressaisi la France” ». Mais le temps lui manquait désormais.
Qu’est-ce que le concept de « participation » auquel Charles de Gaulle semble si attaché pour parachever son œuvre politique et qu’il souhaite mettre en place avec le référendum de 1969 ?
C’est, dans son esprit, un principe général qu’il formule ainsi dans son extraordinaire discours de vœux aux Français du 31 décembre 1968 : « À l’origine de ce trouble, il y a le sentiment attristant et irritant qu’éprouvent les hommes d’à présent d’être saisis et entraînés par un engrenage économique et social sur lequel ils n’ont point de prise et qui fait d’eux des instruments. Ce mal du siècle, qui est celui des âmes, nous pouvons, pour notre part, contribuer à y remédier en organisant la participation de tous à la marche de l’activité à laquelle ils contribuent, de telle façon que chacun soit dignement associé à ce qui se passe à son propre sujet et assume des devoirs en même temps qu’il fait valoir des droits. »

La participation était d’abord pour lui le moyen de nouer un dialogue entre l’État et ce qu’il appelait « les forces vives de la nation », en contournant les notables et les fiefs, et en débordant le seul cercle des élus qu’il flanquerait de représentants des catégories socio-professionnelles. Pour certains de ses proches, qui ont commencé d’ailleurs, sous sa présidence, à élaborer des textes de réforme, il s’agissait d’un projet réellement révolutionnaire qui devait modifier profondément le fonctionnement interne des entreprises et permettre l’appropriation par les salariés d’une partie des actifs de l’autofinancement.
Là encore, de Gaulle a manqué de temps, et s’est heurté à des résistances dans son propre gouvernement et au sein de la majorité qui le soutenait. Il a suscité aussi la méfiance et les réserves du patronat et des syndicats, qui raisonnaient d’abord en termes de salaires, de temps de travail, et ne comprenaient pas ce vieux général qui venait leur parler de la dignité menacée du travailleur et de la nécessité de transformer le capitalisme avant qu’il fût trop tard.
Ce référendum dont une partie concerne les régions est souvent vu, à tort selon vous, comme la marque d’une volonté décentralisatrice. Pourquoi ce contresens s’est-il imposé jusqu’à nos jours ?
De Gaulle n’était pas décentralisateur. Certains de ses proches collaborateurs, comme Olivier Guichard, pensaient qu’il fallait amorcer ce mouvement, mais ce n’était pas l’idée de De Gaulle à ce moment, qui ne se souciait que de parachever son œuvre et ne croyait que dans l’État. Il était attaché aux traditions des anciennes provinces, mais considérait qu’il n’y avait qu’un seul territoire en France, et non des « territoires » comme on le dit aujourd’hui. Les régions qu’il voulait créer devaient, dans son esprit, s’efforcer d’être au plus près possible des anciennes régions, mais elles avaient avant tout une finalité technique et politique : être le lieu de rencontre, de bon niveau, entre l’État central, qui resterait maître du jeu, et la « société » – du moins ses éléments les plus dynamiques, les entrepreneurs, les chercheurs, etc. – qui, représentée dans les assemblées régionales, pourrait ainsi participer par ses initiatives et ses recommandations à la construction de la France moderne : la « démocratie participative », en somme, mais adossée à un vrai pouvoir, organisé et dynamique, et non cette bouillie informe qu’on a baptisée ainsi des décennies plus tard, et qui n’est plus que le voile pudique d’une impuissance publique généralisée – on appelle cela la « gouvernance ».
Selon vous c’est ce « débat sans fin entre Maurras et Barrès qui a sans nul doute contribué à forger sa personnalité politique ». Quelle place occupent ces deux écrivains dans la pensée politique du Général de Gaulle ?

Maurice Barrès, au moment de la Grande Guerre, avait définitivement rompu avec la vision régionaliste et décentralisatrice de Maurras. Il était resté républicain et croyait dans la possibilité d’un gouvernement fort mais démocratique. De Gaulle a nécessairement lu Maurras, et on peut supposer qu’il a pris en compte sa critique très sévère des institutions de la IIIe République. Mais contrairement à Maurras, dont l’antisémitisme lui est de surcroît totalement étranger, il croit que la République est possible, qu’elle peut être forte, avoir une grande diplomatie, peser sur les affaires du monde… Le Général partageait aussi avec Barrès cette idée majeure que l’histoire de France est un tout, et qu’il faut donc tout prendre, l’Ancien Régime et le Comité de salut public, Richelieu et Carnot, tout ce qui renvoie à une « humanité française ». L’admiration de De Gaulle pour Barrès était également littéraire, très proche de celle qu’il vouait à Malraux et Mauriac – qui avaient été eux-mêmes dans la filiation du « prince de la jeunesse ». Mais l’inspiration de De Gaulle la plus puissante fut certainement Péguy, notamment sa vision prophétique d’une certaine modernité, porteuse de pur matérialisme et destructrice de l’homme : c’est cette influence qui explique l’engagement social profond de De Gaulle à la tête du Gouvernement provisoire, dans les grandes réformes de la Libération, et non un prétendu pacte secret ou tacite qu’il aurait passé avec le parti communiste…
Vous citez également beaucoup Bergson dans votre livre. Comment le philosophe imprégna-t-il l’action politique du Général et sa dernière année au pouvoir ?
L’influence de Bergson a été immense au début du XXe siècle, sur Péguy précisément, sur Proust… De Gaulle l’a ressentie et s’en est imprégné non en philosophe, mais en homme d’action. Il ne saisit peut-être pas toutes les subtilités de la pensée de Bergson, mais il en tire quelques principes simples et efficaces : le refus de croire en la fatalité de l’Histoire, la force de l’intuition sans laquelle l’intelligence n’est rien. Il y a surtout cette perception du temps, où le passé, le présent et l’avenir ne sont pas comme livrés à la découpe. C’est l’idée force de L’évolution créatrice : « Notre durée n’est pas un instant qui remplace un instant : il n’y aurait alors jamais que du présent, pas de prolongement du passé dans l’actuel, pas d’évolution, pas de durée concrète. La durée est le progrès continu du passé qui ronge l’avenir et qui gonfle en avançant. » Pour de Gaulle, la politique participe du même esprit : elle est un art immergé dans la vie réelle, elle est création, c’est-à-dire réalité imprégnée d’esprit. L’imagination n’est pas une illusion mais une faculté créatrice qui permet de donner au présent la véritable substance d’un temps retrouvé. Comme Bergson, confronté à la Grande Guerre, l’avait exprimé lui-même : « La réalité n’apparaît plus alors à l’état statique, dans sa manière d’être […] Ce qu’il y avait d’immobile et de glacé dans notre perception se réchauffe, se liquéfie, se met en mouvement. Tout s’anime autour de nous, tout se revivifie en nous. Un grand élan emporte les êtres et les choses. »
C’est pourquoi, pour de Gaulle, gouverner est un grand élan, une action réformatrice constante, mais qui s’efforce de maintenir et de revivifier la substance même de la nation. François Mitterrand a senti cela, mais dans un esprit hostile et sans vraiment comprendre, quand il a parlé de « coup d’État permanent ». C’était une intuition géniale, mais dont il n’a jamais saisi les vrais prolongements.
Vous évoquez la dimension péguyste du général pour distinguer sa conception de la Ve république de celle qu’en avait Georges Pompidou. Qu’entendez-vous par là ?
Un peu cruellement, j’ai rapproché une phrase célèbre de Péguy (« On dit que les peuples heureux sont ceux qui n’ont pas d’histoire. Je n’ai pas besoin de vous dire que c’est faux. ») d’un texte de Georges Pompidou (« Les peuples heureux n’ayant pas d’histoire, je souhaiterais que les historiens n’aient pas trop de choses à dire sur mon mandat. Pas de guerre, pas de révolution notamment. Je souhaiterais en revanche qu’on lise dans les manuels d’histoire que de 1969 à 1976 la France a connu une période d’expansion, de modernisation, d’élévation du niveau de vie ; que grâce au progrès économique et social, elle a connu la paix extérieure. »). Georges Pompidou, qui avait été le Premier ministre de la modernisation du pays (1962-1968) était un esprit modéré et réaliste, qui estimait que le peuple français, après tant d’années difficiles, après la guerre, la reconstruction, la guerre d’Algérie…, avait un certain droit au bonheur, ce bonheur qui représente un peu plus que le simple bien être ou le confort. Pour de Gaulle, le bonheur était au contraire une illusion dangereuse, car il n’était jamais que du pur bien être, un maigre répit pour les courtes distances. La démocratie était pour lui « un corps sans armure », et devait donc être toujours armée pour affronter des ennemis qui n’auraient pas toujours le visage si ouvertement répugnant et barbare de la destruction nazie. Il avait perçu, comme le dira plus tard Soljenitsyne dans son discours de Harvard (1978), ce que pouvait dissimuler « le masque funeste du bien être réglementé ». De Gaulle redoutait par-dessus tout le déclin du courage face à des menaces nouvelles qu’il voyait de fort loin et qui se paraient avantageusement des vertus du progrès.
Peut-on dire que Charles de Gaulle et Georges Pompidou se rejoignent dans un même constat de l’avènement d’une crise de civilisation ?

Ils ne se rejoignent pas entièrement : à travers la crise de la jeunesse, la dénonciation de la société de consommation, Pompidou perçoit surtout une forme de crise d’adolescence de la société démocratique. Il pense que des réponses pourront y être apportées, notamment par l’État, instrument privilégié de l’intérêt public face aux intérêts privés – en ce sens, il est authentiquement gaullien, et le restera, contrairement à la plupart de ses successeurs. De Gaulle voit plus loin, il est littéralement « altier », au sens où l’entendait Méta de Salis quand elle s’adressait à Nietzsche, sur les hauteurs de Sils Maria : « Vous êtes altier, oui, mais je prends le terme dans sa belle signification originale, car il s’agit d’altitude. » Et c’est bien ainsi qu’il faut comprendre le propos tenu par de Gaulle à son collaborateur Bernard Tricot, pendant le voyage en Irlande : il dit son estime, son amitié même pour Pompidou, qui s’apprête à lui succéder, mais il ajoute : « Il manque d’élévation. » Ce n’est pas la flèche du Parthe, ni une appréciation morale, mais un simple constat : son ancien Premier ministre, en dépit de ses immenses qualités, n’a pas une vue d’aussi haute portée que de Gaulle lui-même, dont la vie entière a été marquée par « une fierté inquiète ». Jean-Marie Domenach l’a très bien dit au moment de la mort du Connétable : « Mais une personne dressée contre les fatalités, appelant d’autres personnes à exister : est-ce donc si scandaleux pour des démocrates, qui croient que l’histoire n’est pas le simple produit des déterminations économiques ou des inégalités de la force ? » Toute la singularité de De Gaulle est là. Quand il quitte le pouvoir, il dit : prenez garde, ne vous endormez pas, la paix et le bonheur des peuples sont choses fragiles, soyez toujours prêts à faire face… Depuis quelques décennies, le propos qui domine en politique est plutôt : ne craignez rien, tout va bien, les choses ne sont pas si graves… et désormais, on met tout cela sous le signe du grand défi climatique, qui, pour être malheureusement bien réel, est un alibi commode pour dissimuler tout le cortège des abandons d’aujourd’hui. Il est une chose dont je suis cependant convaincu, c’est qu’au moment où la maladie l’emporta, en 1974, Georges Pompidou, devenu lui-même si bellement altier, avait pleinement rejoint la vision du Général.
Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.
