Tombé dans l’oubli, André Suarès (1868-1948) était pourtant l’une des figures majeures des lettres françaises de la première moitié du XXe siècle. De l’œuvre prolifique de cet ancien pilier de la NRF, seul son Voyage du Condottière a réellement survécu. Pour réparer l’injustice, Stéphane Barsacq vient d’exhumer, avec André Suarès. Miroir du temps (Bartillat), un ensemble d’articles et de textes jusqu’ici disparus et qui témoignent de l’exceptionnelle étendue critique de cet auteur.
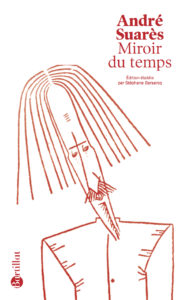
Il y a des monuments qui rayonnent sur toute une époque puis qui, inexplicablement, sombrent comme s’ils n’avaient jamais existé. Anatole France, Romain Rolland, François Coppée… Voilà quelques-uns de ces noms, parfois prix Nobel, tout juste sauvés par l’odonymie. André Suarès, lui, se contente d’une rue d’à peine 150 mètres dans le XVIIe arrondissement de Paris. C’est peu, quand on sait que l’homme fut considéré comme l’un des meilleurs écrivains de son temps par ses plus grands contemporains, d’André Malraux à Henry de Montherlant. Et ces lauriers lui ont été tressés dès l’adolescence. À 18 ans, son Éloge d’Homère par Ronsard lui valut le premier prix au concours général et, surtout, des louanges dans Le Temps d’un Anatole France « saisi d’admiration ». La postérité est donc cruelle pour Suarès, à peine sorti des limbes par quelques rééditions éparses ou par le comédien Philippe Caubère, qui a adapté son Marsiho au début des années 2010.
Mais peut-être que le temps devient plus propice à cet homme disparu en 1948 : depuis l’année dernière, son œuvre est dans le domaine public. Amoureux de Suarès, l’écrivain et éditeur Stéphane Barsacq savourait déjà l’événement en juillet 2018. « Il laisse une œuvre immense, tous genres confondus, que sa tombée dans le domaine public va enfin permettre de redécouvrir », s’enthousiasmait dans une tribune celui qui a déjà fait (ré)éditer Sur la musique (Actes Sud, 2013), Contre le totalitarisme (Les Belles Lettres, 2017) et qui est à nouveau à l’œuvre avec André Suarès. Miroir du temps (Bartillat). Le recueil rassemble plus de trois cents pages de textes pour la plupart inédits ou jamais réédités et qui donnent toute l’ampleur de cet homme « miroir » d’un temps à jamais disparu. « À bien des égards, Suarès appartient à la légende, celle d’un âge d’or des lettres qui semble révolu, où princesses et industriels vous offraient non seulement le couvert, mais des hôtels particuliers avec des jardins, pour y travailler loin de la nécessité, et y élever, comme il le fit, roses et tortues », regrette Stéphane Barsacq dans sa préface.
Mais plus que la chronique d’un autre temps, se plonger dans l’œuvre de Suarès revient d’abord à se jeter dans un océan. Car ce fils de parents juifs né à Marseille en 1868, laïc mais toujours préoccupé par la question de Dieu, a écrit sur tout. De sa pièce symboliste Les pèlerins d’Emmaüs (1893) à ses Fragments manuscrits relatifs à la culture classique (posthume, 2019), on lui compte plus d’une centaine de titres touchant à tous les domaines – critique littéraire, théâtre, poésie, art, musique, politique, religion, histoire, philosophie – dont la mention de quelques-uns suffit à montrer l’impressionnante étendue : Tolstoï vivant (1911), Trois hommes. Pascal, Ibsen, Dostoïevski (1913), François Villon (1914), Debussy (1922), Soleil de jade, poèmes du Japon (1928), Martyre de saint Augustin (1929), Goethe le grand européen (1932), Vues sur Napoléon (1933), Vues sur l’Europe (1936), Temples grecs, maisons des dieux (posthume, 1980). S’y ajoutent encore un lot de correspondances – avec Paul Claudel, Paul Léautaud, Romain Rolland, Charles Péguy, André Gide, Georges Rouault ou encore Jean Paulhan – donnant l’idée de son importance dans le monde des lettres. De ses dizaines d’œuvres pourtant, une seule lui a timidement survécu : son Voyage du Condottière (paru en trois volumes, en 1910 et 1932), récit issu d’un voyage en quête d’art et de beauté à travers l’Italie.
Pèlerin de la connaissance

Le reste de ses créations littéraires semblent condamnées à l’oubli. Les dernières publications, dont ce Miroir du temps, montrent d’ailleurs que la postérité de Suarès sera plutôt celle du critique et de l’intellectuel que de l’auteur. En la matière, ce nouveau recueil établi par Stéphane Barsacq offre une plongée fidèle à la panoplie de son œuvre, rangée en cinq chapitres thématiques – littérature, danse, musique, art, mystique. Comme à chaque fois avec Suarès, c’est d’abord la palette de ses écrits qui impressionne. Inlassable pèlerin de la connaissance universelle, il chemine au milieu des auteurs et des artistes, évoquant avec une égale aisance Stevenson et D’Annunzio, Bach et Bergson, Cézanne et Pétrone. Et c’est en pérégrinant à travers ces écrits à la manière dont il se promène à travers les œuvres qu’il faut savourer les humeurs de Suarès. Car, ici, il ne s’agit pas d’analyses textuelles rigoureuses, mais plutôt d’élans et de réflexions inspirés par ces grands noms.
Quand Suarès donne son avis, c’est toujours avec le secours de formules superbes parce que sans appel. Ainsi de Chateaubriand, qu’il ne goûte guère sans le détester et dont il regrette la « simplicité solennelle qui tourne au faste et à l’oraison », ou de Léonard de Vinci, cet homme « supérieur à son œuvre, ce qu’on ne peut presque jamais dire de personne ». Si Suarès maîtrise un art, c’est d’insinuer de la nuance là où certains ne mettraient que du péremptoire. Il trouve Wagner pesant – « Il y a, dans ces œuvres énormes, trop de récit, trop d’épopée, trop d’anecdote encore » –, mais lui reconnaît du génie dans la force qu’il donne à l’émotion. Dostoïevski est l’un des rares à qui il abandonne sa plume à l’éloge : son œuvre « couvre les royaumes de l’esprit à venir », assure-t-il. « La vie, en Dostoïevski, est un combat capital entre l’amour et la puissance, les deux signes contraires de la même force, qui se sent divine quand elle aime, et qui se méconnaît quand elle n’aime pas. Telle est la grandeur de Dostoïevski : ses œuvres sont les Iliades de la connaissance, les poèmes de la guerre de Dieu et du moi. »
Si cette finesse de jugement s’exerce, c’est qu’elle s’inspire aussi de la psychologie des artistes. Ainsi, Suarès voit un parallèle entre la vie de Péguy et celle de la République. « Faisant retour sur lui-même et sa vie, Péguy pense naturellement à la jeunesse de la République : c’est la sienne. Les moins politiques d’entre nous ont pris de la République le goût et l’habitude d’être libres. La République fait des maîtres, quand le peuple est noble. De la sorte, les vrais aristocrates se trouvent dans les Républiques, plutôt que dans les cours. » Mais il prend ailleurs ses distances avec les vues de l’Orléanais. « Le conflit de la mystique et de la politique paraît fatal encore plus qu’éternel : on ne peut concilier le royaume de Dieu et les règnes de la terre, sans faire tort de tout aux uns et à l’autre. Ici, pour accorder, il faut détruire. La terre veut durer, et les hommes aussi : c’est pourquoi le royaume de Dieu est au ciel. »
L’art, « réponse de la vie au philosophe »

La forme éparse d’un tel recueil peut tromper. Suarès chemine certes entre les grandes œuvres sans esprit de système, mais ces sentiers sont ceux d’une grande quête, celle de la beauté. C’est la même qui l’a guidé à travers l’Italie pour son Voyage du Condottière et qu’il traque à travers les arts. Cette quête du beau, chez Suarès, n’a bien sûr rien de commun avec la fantaisie de la dernière mode : ce beau tient chez lui un sens absolu. « Il n’est point d’art, il n’est pas d’œuvre vraiment grande qui ne touche à la métaphysique par quelque point » car « l’œuvre d’art est la réponse de la vie au philosophe, la vérité qu’il cherche et qu’il dépouille de son prestige, en la touchant », écrit-il dans une variation sur Wagner.
Et cette puissance métaphysique, il peut la traquer au mépris des opinions établies. Quand il parle du « magnifique et misérable » Véronèse, il lui reconnaît un grand talent… mais si peu d’âme. « Le peintre seul ne fait pas un grand artiste : il y faut le poète. » Car, pour lui, l’essence de l’art ne tient pas à la perfection d’une géométrie, mais au rêve que l’œuvre inspire : « La vie est l’inspiration au rêve, comme la mort en est la fin. Et les œuvres mortes sont celles qui nous empêchent de rêver. » Ailleurs, dans une lettre vigoureuse à une comtesse, Suarès défend ainsi Céline et son Voyage au bout de la nuit : « Je ne sais pas si je prendrais votre parti contre Céline. Il n’y a pas de vice à le soutenir. Détestez son livre si vous voulez. Bouchez-vous le nez. Révoltez-vous. Après quoi, vous devrez reconnaître une force rare. […] C’est un livre chrétien, sans art, barbare. Mais il est plein ou infecté, comme il vous plaira, de charité. […] Avec toutes ses laideurs, ses ignominies et les excès du parti pris de ne voir partout que l’abomination de la misère et son ordure, je ne sais pas de roman, depuis dix ans, qui ait le prix de celui-là. »
Autant de belles lignes valaient le coup de ne pas sombrer dans l’oubli. Il n’y a pas si longtemps, Suarès était un monument. Mais le temps l’a englouti. « Inexplicablement », écrivions-nous au début, comme pour excuser la muflerie du destin. Pourtant, la lecture de Suarès laisse déjà comprendre l’infortune qui viendra. L’éclat qui fait son style est en même temps celui de son obsolescence. L’écriture, d’un esthétisme maniéré et parfois boursouflé, sombre dans un lyrisme qui en fait la désuétude. Antoine Compagnon prend d’ailleurs le temps de le signaler dans une brève notice consacrée à l’auteur marseillais : le professeur au Collège de France évoque un « style parfois emphatique » d’un écrivain à qui la simplicité « fait souvent défaut » – l’encyclopédie Larousse souligne, dans la droite ligne, une « grandiloquence qui sonne aujourd’hui un peu forcée ».
Dans l’article « La communication impossible (sur le style d’André Suarès) », paru dans la revue Littératures, Jean-Marie Barnaud rapproche le « style suarésien » de celui de Malraux. « Même richesse, même somptuosité, même aplomb. Le style de Malraux est celui d’un homme en quête d’absolu, miné par l’angoisse de la mort », analyse l’écrivain dans cet article posant la question dès 1972 de la façon dont la prose de Suarès peut être un obstacle à la réception de son œuvre. Mais une différence sépare Malraux de son contemporain : l’action. « Suarès n’a voulu – ou pu – connaître que son univers personnel », note Jean-Marie Barnaud. Et c’est sûrement un peu de ce culte désincarné de la beauté qui fit les grandeurs et les déchéances de quelques grandes gloires du siècle dernier.
Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.
