« Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire », cette phrase est d’Albert Einstein. Il faut la mâchonner longuement pour en saisir toute la saveur et la complexité. La détérioration du travail n’échappe pas à cet axiome. Pour David Courpasson, qui se livre dans Cannibales en costume (2019, François Bourin Editeur) à une anthropologie du cannibalisme économique, la culpabilité est collective.
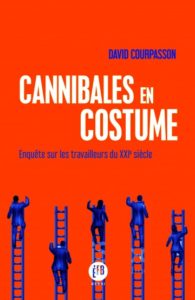
Dans cette grande fosse méphistophélique qu’est devenu en certains endroits le monde de l’entreprise, chacun concourt à alimenter le brasier infernal qui le brûle et le dévore. Par lâcheté ? Peut-être. Par habitude ? Sûrement. Par cet orgueil originel qui colle aux tripes de chaque homme depuis Adam, immémoriale lutte de tous contre tous, qu’étaient arrivées à canaliser les civilisations antiques puis médiévales, avant la grande rupture moderne. Que voyons-nous aujourd’hui ? Certaines entreprises clairement anthropophages et des salariés qui renoncent de moins en moins à ce qui est exigé d’eux. « À quoi sommes-nous accoutumés exactement ? À voir des gens punis, humiliés, licenciés, déplacés, rétrogradés, à côté d’autres qui sont récompensés, applaudis et promus, sans que l’on sache toujours pourquoi. »
« The proper business of business is business. No apology required », pouvait-on lire dans un numéro de The Economist en 2005. Emboîtant le pas à son collègue de l’Ecole de Management de Lyon Pierre-Yves Gomez, Courpasson déplore « ce travail perverti par la sacralisation de l’efficacité individuelle et collective comme valeur cardinale de nos vies, quel qu’en soit le prix ». La perte de sens au travail est le nœud gordien de la vie professionnelle à l’heure d’une mondialisation pleinement achevée et d’une informatisation généralisée. Pour le pire, personne n’ose le trancher. Etre le simple auxiliaire d’une course insensée vers le profit, régi par des règles automatisées dont on ne perçoit plus la finalité depuis bien longtemps, le tout dans une atmosphère de « survie » professionnelle, voilà ce qui dévore les êtres. Et David Courpasson a raison de reprendre le beau mot de dévoration. C’est bien de cela qu’il s’agit.
« Tous les jours, je vois des gens qui ne sont pas des salauds mais qui sont comme aspirés par un travail dégueulasse », témoigne un ami de l’auteur. Le chrétien, ou pour le dire plus largement, le Français riche de tout son héritage chrétien peut-il s’accommoder d’une telle situation ? Peut-il mettre entre parenthèses les vertus chrétiennes, les vertus médiévales, donc les vertus antiques pour assurer sa survie, défendre ses intérêts, dans cette fosse infernale que même Dante n’a pas osé imaginer ? Y aurait-il donc une cruauté nécessaire ? Un cynisme acceptable ? Nous nageons en pleine anomie. Sans mesurer que cette absurdité dans le travail, cette bêtise et cette violence n’ont pas que des conséquences matérielles. Elles broient les âmes, ou les éteignent, les anesthésient. Ce qui revient finalement au même. Courpasson n’exagère pas lorsqu’il écrit qu’ « une catastrophe humaine se déroule sous nos yeux ».
« Manger pour ne pas être mangé », « être du bon côté du manche » sont devenues des injonctions classiques dans l’idéologie managériale, et largement assumées. De l’autre côté : « Ce travail me tue », « je pédale comme un hamster en cage », « je suis un cannibale habillé en costume ». L’enquête de Courpasson est très utile à qui veut « comprendre comment on s’habitue à l’agressivité des autres ainsi qu’à la sienne, pourquoi bien faire un sale boulot… est aussi un travail ». La force des enquêtes ethnographiques est de toucher, d’effleurer une vérité humaine qu’aucun essai de macro-économie ou de sociologie théorique ne pourra jamais atteindre. Un même fossé sépare le traité de théologie morale d’une heure passée dans un confessionnal. C’est auprès de ses acteurs, de ses témoins, que Courpasson voit la violence du monde du travail. Voilà qui lui permet d’en discerner les nuances, les signaux secrets, les accords tacites.
Vers le capitalisme émotionnel

« Le cannibalisme au travail découle largement de l’anxiété commune à tous de perdre quelque chose que quelqu’un d’autre pourrait obtenir. » C’est l’absence d’ordre traditionnel qui crée cette anarchie, où chacun est prêt à déchirer son voisin pour sauver sa peau. Voilà un désordre auquel devrait s’attaquer le renouveau conservateur, dans une acception bien comprise du mot. Car cet état de choses n’a pas surgi spontanément à la seule faveur de la transformation numérique des décennies 1980 et suivantes. Celle-ci ne servit que de catalyseur. Dès 1966, Charles Wright Mills décrivait l’aliénation des cadres aux États-Unis dans Les Cols blancs, Essai sur les classes moyennes américaines. Qu’écrivait Mills ? « L’homme moyen d’aujourd’hui n’a pas de soutien sérieux qui donne un sens à son existence. […] S’il est toujours pressé, c’est peut-être parce qu’il ne sait pas où il va ; s’il est paralysé par la peur, c’est peut-être parce qu’il ignore de quoi il a peur. » L’être humain a besoin de stabilité, de permanence. Ce que ne lui offre plus une économie dans laquelle la vitesse et le provisoire font partie de la règle du jeu.
Pourquoi le capitalisme bureaucratisé puis numérisé broie-t-il plus violemment les psychismes et les caractères que le capitalisme industriel du XIXe et du premier XXe siècle ? « Parce qu’il veut notre individu en entier, pas seulement son corps », répond David Courpasson. C’est la logique implacable de ce que la sociologue Eva Illouz a nommé le « capitalisme émotionnel ». Mais aussi parce qu’il s’est soumis au règne de la vitesse. Dans cette jungle où les chausse-trapes sont partout, les hommes de métier sont perdus. Déboussolés. Leur morale était celle du travail bien fait : « [L]’ethos de métier, c’est l’inverse de la bureaucratie des chiffrages et des procédures. Il ne s’agit pas de désordre, d’improvisation ou de travail approximatif. » Et David Courpasson de conclure : « le flot moderniste n’a pas amené plus d’attention et de précision dans le travail, il est plutôt en train de les détruire en imposant une idéologie de la vitesse », et avec eux, la dignité du travail. Après avoir quitté Courpasson, il nous faut donc relire Péguy, Illich et Günther Anders. Et ne pas oublier qu’il revient à chacun d’entre nous de nous abstraire du grand Machin en renonçant aux faux métiers, à ces emplois qui dégradent et avilissent. C’est le prix à payer pour que nos âmes soient sauvées de l’asphyxie.
Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.
