La sonate la plus célèbre de la littérature, celle pour piano et violon composée par Vinteuil, ne peut être écoutée que dans Un amour de Swann, où elle est exécutée pour la première fois. Rythmée par la cadence de la sonate, genre que Proust affectionne particulièrement, La Recherche s’achève sur une autre mélodie : la sonate à Kreutzer de Beethoven, celle-là même qui, quelques décennies plus tôt, avait inspiré à Tolstoï un réquisitoire contre la musique dans une nouvelle éponyme. De cette simple exégèse de la sonate naît, chez Tolstoï comme chez Proust, une généalogie de la musique.
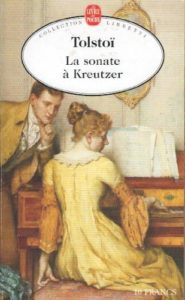
Dans la trinité artistique de La Recherche composée par Bergotte, Elstir et Vinteuil – l’écrivain, le peintre et le compositeur –, le rôle de père revient sans conteste à Vinteuil. A-t-il un lien de parenté avec le vieux professeur de piano de Combray ? On ne sait rien de lui sinon qu’il a composé, entre autres pièces, la sonate pour piano et violon dont Swann ne connaît guère que la petite phrase de l’andante qui l’enchante et qu’il considère comme « l’air national » de son amour pour Odette. Comme Swann, Pozdnychev, le héros de La sonate à Kreutzer, n’a retenu que le presto de la pièce de Beethoven, dans le premier mouvement ; contrairement à lui, il associe cette phrase non à la rencontre de sa femme mais à leur séparation. De même que le troisième concerto de Rachmaninov a détruit David Helfgott, le soliste au piano ; de même la sonate à Kreutzer a poussé la femme de Pozdnychev à l’adultère avec Troukhatchevski, le violoniste, et Pozdnychev au crime. « Du reste, en général, la musique est un phénomène redoutable ! » Le réquisitoire de Tolstoï peut commencer.
Le procès que Tolstoï intente à la musique tient en quelques mots. La sonate avilit et exaspère l’âme, au lieu de l’élever : elle me fait oublier mon moi et me plonge dans un état qui n’est pas le mien. « Voilà pourquoi la musique est une excitation sans aboutissement, sans apaisement, sans solution. » La sonate à Kreutzer n’a d’ailleurs pas pour objet premier la musique. Ce que Tolstoï condamne à travers la sonate, c’est l’amour charnel : non seulement l’homme s’y dégrade moralement mais il abdique sa raison. Le romancier associe donc implicitement le plaisir sexuel et la jouissance musicale.
Proust ne pense pas autrement. La première expérience sensuelle à laquelle le narrateur ne participe pas, mais à laquelle il assiste comme spectateur discret, est aussi la première occurrence – certes anecdotique – de la musique : les ébats sexuels de Mlle Vinteuil et de son amie qui, sous prétexte de faire de la musique, se réunissent chez la première et, entre autres activités libidineuses, profanent le portrait de l’ancien professeur de piano. Déjà, Proust et Tolstoï entrent en désaccord : pour l’un, la musique est, comme l’amour physique, injustement décriée ; pour l’autre, elle est une jouissance déréglée, tournant vers la dépravation. Le narrateur cède volontiers au charme de la sonate ; Pozdnychev y renonce. Faut-il avoir tort avec Proust ou raison avec Tolstoï ?
Sonate, que me veux-tu ?
On connaît l’apostrophe de Fontenelle quittant une compagnie où on l’avait abreuvé de musique instrumentale : « Sonate, que me veux-tu ? » Roland-Manuel, musicologue contemporain de Ravel, a réuni ses « réflexions sur les fins et les moyens de l’art musical » sous ce titre. Tolstoï formule le même reproche interrogatif dans La sonate à Kreutzer : « Qu’est-ce que la musique ?… Que fait-elle ? Et pourquoi le fait-elle ?… » La question de Pozdnychev n’est pas celle d’un philosophe rigoureux mais d’un mari trompé et veuf : la musique a séduit sa femme et, devant l’adultère, a poussé le malheureux à tuer son amour d’antan. Impuissant, Pozdnychev assiste au dialogue entre le piano et le violon qui s’unissent complaisamment dans le dernier mouvement, selon la structure embrassée de la sonate à deux thèmes. Aussi l’adaptation de La sonate à Kreutzer au cinéma par Rohmer s’éloigne-t-elle du drame tolstoïen : chez Tolstoï, les deux amants n’assistent pas à la sonate en spectateurs mais l’interprètent et apportent leur corps, comme l’écrit Valéry à propos du peintre.

Certains couples se créent dans l’intimité d’un « quatre mains », comme Agathe et Hagauer dans L’Homme sans qualités ; d’autres se décomposent lorsque les mains ne jouent plus à l’unisson mais tour à tour, comme l’impossible réconciliation de la mère et de la fille autour d’un prélude de Chopin, dans Sonate d’automne de Bergman. Tandis que la sonate repose sur la relation entre deux musiciens chez Tolstoï, elle se construit généralement autour de deux auditeurs chez Proust : Swann et Odette, Albertine et le narrateur ; ou bien entre un auditeur et un interprète, puisque c’est le Morel-violoniste qui séduit d’abord Charlus. Or si le procès de Tolstoï s’en tenait là, il serait caduc : Pozdnychev croit faire des reproches à la musique alors que c’est à sa femme et à lui-même qu’il les fait. Il attribue des intentions à une sonate qui ne fait que suggérer.
Interrogeons maintenant la substance du phénomène musical dont nous n’avons considéré, jusque-là, que les effets. Quand la musique fait danser, comme une gigue, ou prier, comme une messe, elle a une raison d’être, même lorsqu’elle n’atteint pas son but. Or « cette musique-là », écrit Tolstoï, la sonate, exaspère sans soulager. Elle subjugue en suggérant et n’a d’autre but que d’asservir l’auditeur par la puissance frauduleuse et charlatane de la mélodie. Comme le remarque Jankélévitch dans La musique et l’ineffable, cette méfiance à l’égard de la mélodie accompagne la musique depuis sa naissance : dans le discours des contempteurs de la sonate, on discerne encore le conflit de la Lyre et de la Flûte dont parle Aristote dans la Politique. La flûte dionysiaque rythme les grossières orgies, la lyre apollinienne guide les saines pensées. Le débauché chérit la sonate, le sage la redoute. « Cave carmen » avertit Nietzsche ; « Cave musicam » écrit-il ailleurs. La musique, surtout romantique, « énerve, amollit, effémine » : Schumann et d’autres ne manifestent que l’« éternel féminin » de la Frau musica. Le cas Wagner se distingue néanmoins des autres. Nietzsche reproche à sa musique d’être gigantesque : or il est « plus facile d’être gigantesque que beau. »
N’est-ce pas le gigantesque de Wagner justement, le sublime kantien, qui, parce qu’il accompagne le plaisir esthétique d’une douleur, subjugue Proust autant qu’il fascinait Baudelaire ? Il n’y a pas d’expérience du beau sans la « douleur savoureuse » baudelairienne : en témoigne le visage de Mme Verdurin qui, « sous l’action des innombrables névralgies que la musique de Bach, de Wagner, de Vinteuil, de Debussy lui avait occasionnées », a les traits creusés par l’harmonie. Dans sa jalousie et sa honte, l’auditeur tolstoïen ne fait pas la différence entre Beethoven et Wagner. Qu’il s’agisse de l’Héroïque ou de Lohengrin, les sensations que la mélodie procure sont toujours fausses et l’inintelligible n’y a aucune part. La sonate ne semble avoir aucune arrière-pensée métaphysique : souvent, elle nous prend comme une mer, nous pénètre, nous emporte – mouvante avant d’être émouvante – et toujours nous abandonne. Méfions-nous de son charme.
Sonates cartésienne et schopenhauerienne

Faisons le pari inverse. Tentons de sauver la musique : chargeons son langage de sens et donnons-lui une nature supra-sensible. On obtient alors la théorie de Schopenhauer, bien connue de Proust et de Tolstoï : sonate, symphonie et quatuor sont comme une récapitulation de la destinée métaphysique et nouménale du vouloir. C’est l’être-en-soi qui monte et descend sur les cinq lignes de la portée. « Relisez ce que Schopenhauer dit de la musique » déclare Mme de Cambremer, et Mme de Guermantes d’ajouter : « Relisez est un chef-d’œuvre ! Ah ! non, ça, par exemple, il ne faut pas nous la faire. » Chacun écoute la sonate comme un raccourci de l’aventure humaine, de l’allegro au finale : Tolstoï entend dans le presto de Beethoven sa femme qui s’abandonne à un autre homme ; le scherzo de Vinteuil – et non l’andante – rappelle au narrateur non seulement son amour pour Albertine mais synthétise aussi la sensation des pavés inégaux, la saveur de la madeleine, la vue des arbres de Balbec en voiture etc.
Pourtant lorsqu’il initie le narrateur à la petite phrase, Swann lui explique que ce que la musique montre, « ce n’est pas du tout la « Volonté en soi » et la « Synthèse de l’infini », mais, par exemple, le père Verdurin en redingote dans le Palmarium du Jardin d’Acclimatation. Schopenhauer dénie à la musique la faculté de représenter le phénomène pour lui prêter le pouvoir d’incarner l’idée dans le son : autrement dit, il recule dans l’étude de la science musicale. Schopenhauer, inutile et incertain, ne suffit donc pas. Tolstoï ne croit pas non plus à cet alibi métaphysique de la mélodie, pas plus qu’on ne croit une femme adultère qui se justifie. La méta-musique, en ce qu’elle prétend nous transmettre des messages de l’au-delà, double sa tromperie d’une mauvaise foi et prolonge l’escamotage sensible par une escroquerie intellectuelle.
Une musique qui caresse l’oreille – la musique de Morel va vous « caresser dans l’oreille » annonce Mme Verdurin à Charlus – ne peut donner à penser. Tel est l’ultime reproche de Tolstoï : la sonate humilie la raison. Nietzsche ne dit rien d’autre lorsqu’il écrit, après son avertissement, que cet art ambiguë « prive l’esprit de sa sévérité et de sa joie ». Celui qui écoute de la musique cède au sommeil de l’esprit – parfois même au sommeil du corps, pour les non-initiés, dans La Recherche – et certains usent de la mélodie comme l’ivrogne de l’alcool : pour oublier. Le narrateur est d’ailleurs le premier à le faire, lorsqu’il se met au piano pour cesser de songer à Albertine absente. Là encore, le reproche a plusieurs siècles. Dans Sonate que me veux-tu ?, Roland-Manuel signale la tradition du « quatorzième fauteuil » à l’Académie : de Corneille à Hugo, beaucoup de ceux qui ont occupé le siège ont reproché à la musique d’être un art inachevé et incommode qui offusque la clarté du discours. Orpheline de la littérature, la sonate est aussi rejetée par la philosophie. La musique, dans sa dimension esthétique au sens premier du terme aisthesis, n’est jamais qu’une connaissance confuse de l’intelligible, sauf peut-être lorsqu’elle obéit à la scolastique du contrepoint. Or la sonate, symphonie miniature, bouleverse justement la structure baroque de la suite : il y a autant de différence entre Bach et Beethoven qu’entre Descartes et Schopenhauer. Proust appartient aux seconds et il cherche la musique du côté de chez Beethoven et Wagner. Aussi ne manque-t-il pas de faire remarquer l’erreur de Nietzsche : « Je n’avais, à admirer le maître de Bayreuth, aucun des scrupules de ceux à qui, comme à Nietzsche, le devoir dicte de fuir, dans l’art comme dans la vie, la beauté qui les tente, et qui s’arrachent à Tristan comme ils renient Parsifal ». Proust ne partage pas cet « ascétisme spirituel », grotesque du reste puisque l’auditeur parvient seulement à « s’élever jusqu’à la pure connaissance et à l’adoration parfaite du Postillon de Longjumeau ».

C’est pourquoi Proust se montre parfaitement insensible à l’argument tolstoïen de la raison abdiquée. On connaît l’incipit du Contre Sainte-Beuve, non moins célèbre que celui de La Recherche : « Chaque jour j’attache moins de prix à l’intelligence. » La raison ne se dégrade pas dans l’exercice musical parce qu’elle n’est pas la première faculté conviée, encore moins l’invité d’honneur. La musique habite un autre monde, « un monde infiniment supérieur à celui où la raison peut analyser le talent ». Pas de libération de la connaissance jusque-là au service de volonté comme chez Schopenhauer. Mais le narrateur ne partage pas entièrement l’opinion de Swann sur la musique non plus, ou du moins la prolonge nettement. Lorsqu’Odette joue la sonate au piano pour le narrateur, Swann commente : « C’est cela qui est si bien peint dans cette petite phrase, c’est le bois de Boulogne tombé en catalepsie ». L’épigraphe fameuse de la Symphonie pastorale de Beethoven ne le contredit-elle pas : « plus expression du sentiment que peinture » ? Et pourtant, lorsque Gertrude, aveugle, écoute cette même symphonie dans le roman de Gide, elle lui inspire une « scène au bord du ruisseau ». Portons, pour une fois, la contradiction à Proust : à force de nourrir la sonate de ses propres émotions, quel mérite laisse-t-il à Vinteuil ? Au lieu d’écouter le musicien composer, le narrateur ne s’écoute-t-il pas songer lui-même, bercé par la petite phrase ? Jankélévitch : « La musique signifie donc quelque chose en général sans jamais rien vouloir dire en particulier. » La sonate contient tout et tout contient la sonate, comme les carafes plongées dans la Vivonne dans un passage célèbre de La Recherche.
« C’est aussi simple qu’une phrase musicale »
Malgré tout, Tolstoï et Proust entendent la sonate de la même oreille. Lorsque Pozdnychev écoute Beethoven et qu’il croit « découvrir des sensations et des possibilités nouvelles, inconnues jusque-là », n’a-t-il pas une intuition tout à fait proustienne ? Puisque tous deux sont sensibles au phénomène musical, qui des deux romanciers l’a pénétré plus profondément que l’autre : celui qui, conscient des risques qu’il court en s’abandonnant à la mélodie, condamne ces sirènes du néant ? Ou celui qui, après avoir concerté sa raison, cède avec délice au charme de la sonate ? Chaque esthétique a le défaut d’isoler un moment de la sonate et de n’en garder qu’une phrase musicale : Pozdnychev connaît la structure de la pièce de Beethoven mais il la réduit au presto du premier mouvement, diabolus in musica ; Swann ne parvient à mettre un nom sur la sonate que très tard et seul le narrateur situe correctement la petite phrase, lorsqu’il obtient la partition. L’occasion d’ailleurs de fustiger la futilité de ceux qui font profession d’aimer la musique. Tolstoï et Proust critiquent à l’unisson le snobisme musical. Lorsqu’une dame noble d’Avranches, « laquelle n’eût pas été capable de distinguer Mozart de Wagner », déclare que Pelléas et Mélisande est une pièce affreuse, Mme de Cambremer lui rétorque que c’est un « petit chef-d’œuvre » et défend Debussy comme une de ses amies qui aurait été prise à parti. Proust n’épargne d’ailleurs jamais ceux qui s’improvisent mélomanes mais n’y entendent rien, comme le docteur Cottard, et écrit justement à propos de la sonate de Beethoven, non sans sarcasme : « [C]’était la sonate à Kreutzer qu’on jouait, mais, s’étant trompé sur le programme, il croyait que c’était un morceau de Ravel qu’on lui avait déclaré être beau comme du Palestrina, mais difficile à comprendre. » Les œuvres comme la sonate de Beethoven, écrit Tolstoï, devraient seulement être exécutées « quand nous sommes en état de réaliser ce à quoi elles nous portent. » Autrement dit, pas dans un salon ou une « société de femmes décolletées » même lorsque, comme le salon Verdurin, il est considéré comme le « Temple de la musique ».

Du quatorzième siège de l’Académie s’est aussi élevée la voix de Chabanon qui, dans sa défense de la musique, prélude à la sonate proustienne, s’interrogeait : « Si le plaisir de la musique est pour l’oreille ce qu’un beau visage est pour nos yeux, pourquoi le condamner et à quel titre ? » Quand le regard du narrateur s’arrête sur le visage de Gilberte, il est comparé à une fenêtre où « se penchent tous les sens, anxieux et pétrifiés ». Il en va de même pour l’ouïe : il ne suffit pas que la musique nous pénètre, il faut encore la pénétrer. Est-ce donc si difficile de se mettre en état de l’accueillir ? demande Roland-Manuel. La question de Fontenelle est trop cartésienne : comme le langage de la sonate ne lui transmet aucune notion précise, il interroge ces motifs sans motivation et, devant leur silence, conclut à leur indignité métaphysique.
Pourquoi voudrait-on que la musique signifie autre chose que ce qu’elle est ? Régime ambiguë de l’expressivo qui n’exprime rien, conclut Jankélévitch, la musique ne dit ni ne cache rien mais « chante le lieu de rencontre des significations ». Pour le narrateur, la sonate ou le septuor de Vinteuil synthétisent les sensations connues : les dalles inégales de Venise, la raideur de la serviette, le bruit du marteau sur la roue du train de Balbec etc. La musique opère des « résurrections » sensibles, sporadiques mais authentiques, et ramène à la vie des impressions oubliées dans leur pureté première comme autant de paradis perdus, c’est-à-dire de « vrais paradis ». Chaque parole, chaque geste porte en lui le reflet des choses que l’intelligence, pour les besoins du raisonnement, a supprimé : sans Vinteuil, ces reflets sommeilleraient sans doute encore dans la mémoire du narrateur. Qu’est-ce que la musique, en définitive, « sinon une expérience sensible du temps vécu et retrouvé ? » conclut Roland-Manuel. Comme Proust, il considère la mémoire comme la quatrième pédale du pianoforte qui soutient et prolonge l’harmonie : elle est « la condition nécessaire et primordiale de toute expérience musicale authentique. »
Le narrateur proustien n’aurait été qu’un de ces auditeurs de « formation littéraire et de constitution émotive » dont Roland-Manuel se moque s’il n’avait cherché à connaître la petite phrase autant qu’elle semblait le connaître. Au début, il ne la comprend pas : « Mais souvent on n’entend rien, si c’est une musique un peu compliquée qu’on écoute pour la première fois ». Jusqu’au Temps retrouvé, il cherche encore la raison de sa fascination qui n’est pas exactement celle ressentie par Swann. Abusé par ses sens, l’auditeur tolstoïen juge sans jouir, persuadé des mauvaises intentions de la sonate : il est de ceux qui compulsent avidement la notice de leur programme tandis que la symphonie se joue devant eux. Le « je-ne-sais-quoi » qui fait penser Proust fait souffrir Tolstoï. Ainsi, parmi les nombreux enseignements qu’elle prodigue, La Recherche dispense une éducation musicale, c’est-à-dire sentimentale. Elle fournit un discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans la science musicale.
Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.
