Dans Le Soleil des morts (1923), l’écrivain russe Ivan Chmeliov (1873-1950) raconte l’expérience infernale qui fut la sienne en Crimée sous le joug de Béla Kuhn. Thomas Mann, en visite à Paris, avait tenu à rencontrer l’écrivain en exil. Il voyait dans Le Soleil des morts un sommet de la littérature mondiale et proposa Chmeliov pour le prix Nobel en 1931.
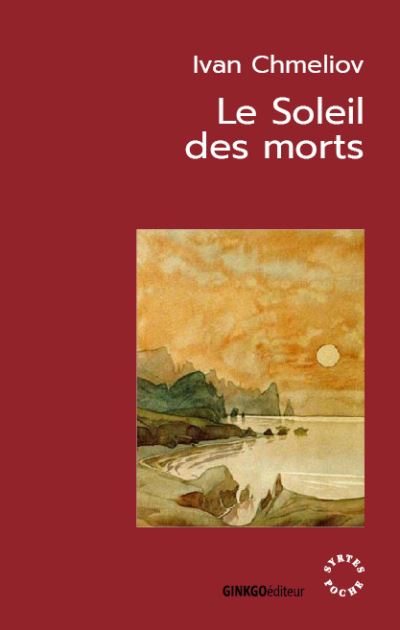
En 1918, quelques mois après l’éclatement de la Révolution d’Octobre, Ivan Chmeliov, qui lui est farouchement hostile, s’installe en Crimée avec sa femme et son fils. Ce dernier rejoint les rangs de l’Armée blanche du général Denikine pour combattre les soviétiques au Turkestan russe. Après la débâcle de l’Armée blanche commandée par le général Wrangel, successeur de Denikine, la Crimée tombe sous le joug du communiste hongrois Béla Kuhn. De novembre 1920 à février 1922, les populations connaissent une famine terrible et subissent les persécutions du nouveau pouvoir en place. Le fils de Chmeliov sera exécuté sans jugement par la Tcheka en janvier 1921. C’est cette période abominable que l’écrivain retranscrit avec une grande force poétique dans Le Soleil des morts (1923), le premier texte qu’il publiera après s’être exilé à Paris grâce au soutien d’Ivan Bounine.
« Dans ce livre qui est en fait un journal, il décrit comment la faim détruit progressivement tout ce qu’il y a d’humain dans l’homme, d’abord les sentiments, ensuite la volonté. La faim et la mort comme le fatum de la tragédie antique pèsent sur toutes choses. Petit à petit, tout meurt sous les rayons du « soleil qui rit » », explique le spécialiste de littérature slave René Guerra. Dans la lignée de Knut Hamsun, Chmeliov réinvestit le thème de la faim en mettant en scène, non pas un individu unique à la subjectivité délirante, mais une population entière qui voit sa perception du monde se transformer au fur et à mesure que les denrées alimentaires se font plus rares. Car le roman de Chmeliov entérine, 70 ans avant sa chute, l’échec historique de l’Union soviétique, comprise comme un système incapable de produire quoi que ce soit, comme essentiellement un système de pénurie.
Le philosophe Michel Henry, dans Du communisme au capitalisme (1990), a parfaitement cerné les conséquences d’une telle « économie » : « La pénurie exacerbe le ressentiment. Comme une mer qui se retire découvre des rochers qu’elle cachait jusque-là, le reflux de la richesse sociale fait apparaître les bribes de bien-être et d’agrément qui subsistent de l’état d’abondance disparu comme des privilèges insupportables. » Ainsi, le fait de posséder un vache qui donne du lait, le fait de disposer d’un peu de farine pour faire du pain ou encore d’un peu de bois de chauffage pour passer l’hiver sont perçus, non pas comme des biens dérisoires permettant d’assurer une vie décente, mais comme les vestiges d’un monde bourgeois qu’il faut s’empresser de confisquer et de répartir.
L’Enfer existe

Coincé entre le Tchatyr-Dag et la mer Noire, le narrateur du Soleil des morts, qui évolue dans une combe aride, doit supporter, en plus de la faim qui lui tiraille le ventre, l’ironie d’un cadre qui rappelle sans cesse que la vie mérite d’être vécue : la mer brille de mille reflets et invite à l’évasion, le Tchatyr-Dag domine la région de toute sa superbe et incite à la contemplation des beautés naturelles. Pourtant, cet environnement n’existe finalement que pour entretenir une illusion : « Ce n’est pas une invention, l’Enfer existe. Le voici avec son cercle trompeur : la mer et les montagnes… » La faim généralisée abolit tout ce qui permet habituellement de constituer une société d’individus libres. La culture, l’instruction sont obsolètes. On préfère échanger ses livres – même une « Grande Encyclopédie » magnifiquement reliée – contre une demi-livre de pain. Les lois les plus fondamentales n’ont plus cours : « On n’arrête plus les voleurs. On n’a pas de quoi les nourrir. Ce n’est pas comme du temps de Nicolas. » Les seules règles en vigueur sont celles, arbitraires, instaurées par les communistes sous le régime de la « Terreur rouge ». Le partage – en réalité la confiscation – de tous les biens est le mot d’ordre puisque, comme le souligne encore Michel Henry, « le propre d’un régime de pénurie est que la production de cette richesse est maintenue à un niveau si bas que celle-ci se présente comme une quantité fixe, arrêtée, qu’il n’y a plus alors qu’à partager ». Les bolcheviks sont décrits par Chemliov comme profondément immoraux, comme ces « démons » que dénonçait en son temps Dostoïevski.
L’alternative de ce monde infernal est la suivante : ceux qui ne possèdent rien mourront de faim, ceux qui possèdent quelque chose seront dépossédés de leurs biens par les communistes et rejoindront les premiers. La seule échappatoire réside dans l’irréalité, comme cet enfant qui préfère dormir afin de rêver de cette nourriture disparue : « « Et Petitchka ; nous irons chercher du pain en ville. » Et Petitchka me dit : « Ah ! maman, dodo… J’ai mangé du lard… j’ai… mangé de la… viande !… » Je regarde et je vois qu’il avait… mâché le coin… de son oreiller. » Ou encore comme le père Andreï, tellement affamé qu’il s’est cassé les dents en voulant manger de la pierre. Parmi ce cortège macabre, certains individus se distinguent, ceux qui ont décidé de garder leurs bêtes bien que celles-ci soient trop affamées pour produire quoi que ce soit. Beaucoup s’étonnent : Pourquoi les gardent-ils ? Pourquoi ne les mangent-ils pas ? Afin de singer le monde d’hier ? Afin de continuer de contempler ces créatures admirables, que ce soit la vache Tamarka ou ce paon aux couleurs chatoyantes ? Côtoyer la beauté, est-ce le dernier luxe de ceux qui ont faim ?
Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.
