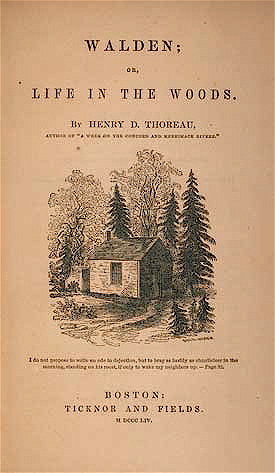Bien mal avisé serait celui qui verrait en Henry David Thoreau un maître du survivalisme. Dans Walden, l’écrivain américain dispense un enseignement métaphysique que l’on pourrait résumer ainsi : la vie véritable ne peut être qu’une vie dans les bois.
[Cet article est paru initialement dans PHILITT #10]
On ne prête souvent que peu d’attention au sous-titre du célèbre livre de Henry David Thoreau, Walden ou la vie dans les bois. Ou plutôt, on prête seulement attention au mot bois et aucune au mot vie. Pourtant, l’emploi de ce dernier doit être entendu dans un sens fort et exclusif. Ce n’est pas seulement la vie que mène Thoreau près de la ville de Concord et de l’étang de Walden qui doit intéresser le lecteur, c’est la vie elle-même, en tant qu’elle trouve son expression la plus radicale et sa réalité la plus complète dans les bois. En d’autres termes, Thoreau formule une proposition souvent ignorée que l’on peut condenser ainsi : la vie véritable ne peut être qu’une vie dans les bois, la vie urbaine, mais aussi la vie du fermier enchaîné à sa terre, ne sont que des succédanés de vie. Thoreau l’écrit d’ailleurs de manière tout à fait explicite, dans un passage qui ne laisse planer aucune ambiguïté : « Je suis parti vivre dans les bois parce que je voulais vivre en toute intentionnalité ; me confronter aux données essentielles de la vie, et voir si je ne pouvais apprendre ce qu’elles avaient à m’enseigner, plutôt que de constater, au moment de mourir, que je n’avais point vécu. Vivre est chose si précieuse : je ne souhaitais pas vivre ce qui n’était pas de la vie. » « Vivre ce qui n’était pas la vie », l’expression est troublante et peut interroger. Quelle est cette vie qui n’est pas la vie véritable ?
Aux yeux de Thoreau, la vie inauthentique désigne une vie qui confisque à l’homme sa propre liberté et qui n’entretient pas de relation directe avec la nature. La civilisation moderne est à l’origine de cette séparation tragique entre l’homme et l’ordre naturel, imposant ses conventions sociales hypocrites et son rapport nouveau au travail qui aliène les individus. Dès lors, il s’agit pour Thoreau de reconquérir cette vie primitive, dépouillée de tout artifice. « Je voulais vivre intensément, et aspirer toute la moelle de la vie ; vivre de manière si robuste, si spartiate, que je serais en mesure d’arracher à la racine tout ce qui dans la vie n’était pas de la vie – débroussailler un large pan et y faire table rase, traquer la vie, la bloquer dans un coin, la réduire à ses plus petits dénominateurs […]. » Thoreau, en séjournant pendant deux ans dans cette cabane qu’il avait construite de ses propres mains et en opérant ce qu’on appelle en philosophie une réduction, souhaite saisir la quintessence de la vie, en évacuant tout ce qui pourrait la parasiter : les machines, les institutions, les mondanités…
Hostilité envers le progrès technique
C’est donc à un modèle politique, économique et philosophique auquel s’attaque l’écrivain américain, celui de la révolution industrielle et du capitalisme, qui s’est imposé aux États-Unis et qui domine à présent son univers mental. Thoreau, figure emblématique du nature writing, est aussi transcendantaliste. Il adopte par conséquent une attitude philosophique qui rappelle celle des romantiques européens héritée de Rousseau. Ses méditations sur la nature humaine le conduisent à exprimer une hostilité radicale envers le progrès technique : « Ce qui vaut pour nos universités vaut de même pour cent autres “progrès modernes” : on se leurre à leur sujet, car ces progrès sont loin de toujours impliquer une amélioration réelle. » À ses yeux, la transformation de la société américaine compromet la vie d’homme libre qu’il souhaite mener, une vie qu’on pourrait qualifier de proto-américaine, où les lois des hommes ne gouvernent pas encore les individus qui n’ont de compte à rendre qu’à la terre et à la nature sauvage. « Je ne fus jamais molesté par personne d’autre que des représentants de l’État », raconte-t-il, lui qui refusait de payer sa taxe foncière et qui, par conséquent, fit plusieurs séjours en prison. « Il n’exista jamais Américain plus authentique que Thoreau », souligne Ralph Waldo Emerson, son ami et propriétaire de la forêt dans laquelle Thoreau s’installa. « Il aimait tant la Nature, et était si heureux en sa solitude, qu’il devint très critique des villes et de l’œuvre bien triste que leurs raffinements et artifices avaient faite de l’homme et de ses habitations », ajoute le philosophe, fondateur du mouvement transcendantaliste américain.
Pour l’auteur de Walden, la redécouverte par l’homme de la vie authentique doit s’accompagner d’une double réflexion, sous-jacente à sa critique de l’idéologie du progrès. Il faut d’abord réinventer son rapport au temps en refusant de voir sa vie réglée par la mécanique arbitraire des horloges, ces monstres qui depuis toujours sont pour l’homme une source d’angoisse. Il faut abandonner le culte de la vitesse lié à l’essor du capitalisme, un rythme insoutenable qui, loin de faire le bonheur de l’homme, contribue à sa souffrance : « On vit trop vite. Les hommes pensent qu’il est essentiel que la Nation fasse du commerce, et exporte de la glace, et converse par le truchement d’un télégraphe, et se déplace à trente miles à l’heure ; et ils le pensent sans le moindre doute, qu’ils aient ou non eux-mêmes besoin de toute ça. » À ce temps soumis aux lois du travail et de l’économie, il faut substituer le temps vital, celui des journées et des saisons qui possède ses contraintes propres, mais qui ne sont pas celles des hommes.
C’est à cette condition seulement que l’on peut adopter un mode de vie plus lent, loin de toute frénésie moderne. « J’aime vivre ma vie avec beaucoup de marge. Parfois, par un matin d’été, après avoir pris mon bain quotidien, je m’asseyais sur le sol ensoleillé de ma porte et y restais de l’aube jusqu’au midi, plongé dans ma rêverie […] » Ce rythme, en harmonie avec la nature, n’est soumis à aucun impératif de productivité, à aucun objectif de rentabilité. Mais cela ne signifie pas, contrairement à ce que pourrait penser un esprit entièrement conditionné par la vie sociale et économique, que c’est un rythme dénué de finalité. Ne pas capitaliser, ne pas produire, ne signifie en aucun cas ne rien faire. Au contraire, Thoreau travaille – il passe une grande partie de son temps à sarcler ses haricots – mais surtout il contemple. « Pour l’essentiel, je ne me souciais pas du passage des heures. Le jour progressait comme pour éclairer un de mes labeurs. Le matin était là, puis, ô miracle, c’était déjà le soir, et rien de mémorable n’avait été accompli. »
Espace et solitude
À la réflexion sur le temps s’ajoute une réflexion sur l’espace dont on est tenté de penser qu’elle est encore plus indispensable, tant les États-Unis se sont d’abord définis, en opposition à l’Europe de l’Ouest, comme la patrie de la terre infinie et dont les limites ne furent appréhendées qu’avec la découverte du front Pacifique. En effet, c’est un lieu commun que de parler des « grands espaces » américains, mais cela constitue l’ADN de ce pays de taille continentale. Et on sait à quel point la géographie peut influencer la culture, la mentalité et le destin d’une nation. Pour Thoreau, un Américain authentique est nécessairement un être solitaire. Son tempérament et ses dispositions naturelles nécessitent une place considérable pour leur épanouissement : « Le monde se porterait mieux s’il n’était pas peuplé de plus d’un habitant par mile carré, comma là où je vis. » C’est aussi pour cela que l’existence au sein des villes ennuie Thoreau : les hommes sont les uns sur les autres et cette trop grande proximité atrophie leur être.
Si Thoreau se considère comme un solitaire et embrasse volontiers la solitude, il lui oppose, dans une vaine transcendantaliste, la solitude pathologique de l’urbain moderne, celle de l’homme seul dans la foule. « J’aime être seul. Je n’ai jamais trouvé de compagne qui fût aussi bonne compagne que l’est la solitude. Nous sommes le plus souvent plus solitaires lorsque nous sortons dans le monde parmi les hommes que lorsque nous restons seuls dans nos quartiers. » Car Thoreau, lorsqu’il évolue dans ces bois qu’il aime tant, ne se sent jamais vraiment seul. La proximité qu’il entretient avec le monde naturel est à ses yeux la meilleure des compagnies. En réalité, la solitude de l’écrivain est beaucoup plus profonde que celle des habitants des villes, mais elle n’est pas marquée du sceau de l’ennui. C’est une solitude métaphysique, cosmique : « Je possède, pourrait-on dire, mon propre soleil, ma propre lune et mes propres étoiles : un petit monde complet pour moi tout seul. »
L’ennui est un phénomène propre à la condition urbaine. Elle traduit la faillite psychologique de celui dont l’existence exige de la frivolité. Or Thoreau, trouvant son salut ainsi que l’essence de la beauté dans l’immanence radicale, se divertit de la plus noble des façons. « En matière de mode de vie, j’avais au moins cet avantage sur tous les gens qui sont obligés d’aller quérir leurs divertissements à l’extérieur – dans le monde, ou au théâtre – que ma vie elle-même était devenue mon divertissement, et ne cessait jamais de se renouveler. C’était un spectacle sans fin, riche de scènes innombrables. » Plus encore, Thoreau échappe à la lassitude parce que chaque levé de soleil est pour lui le commencement d’une nouvelle vie. « Adorateur d’Aurore », tel les anciens Grecs, il tend à imiter la Nature, à se confondre avec elle. Comme le pin rigide ou le caryer qui avoisinent l’étang de Walden, Thoreau est habité du sentiment de l’éternité. Et dans l’éternité, rien n’est plus nouveau que l’ancien, rien n’est plus ancien que le nouveau.
Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.