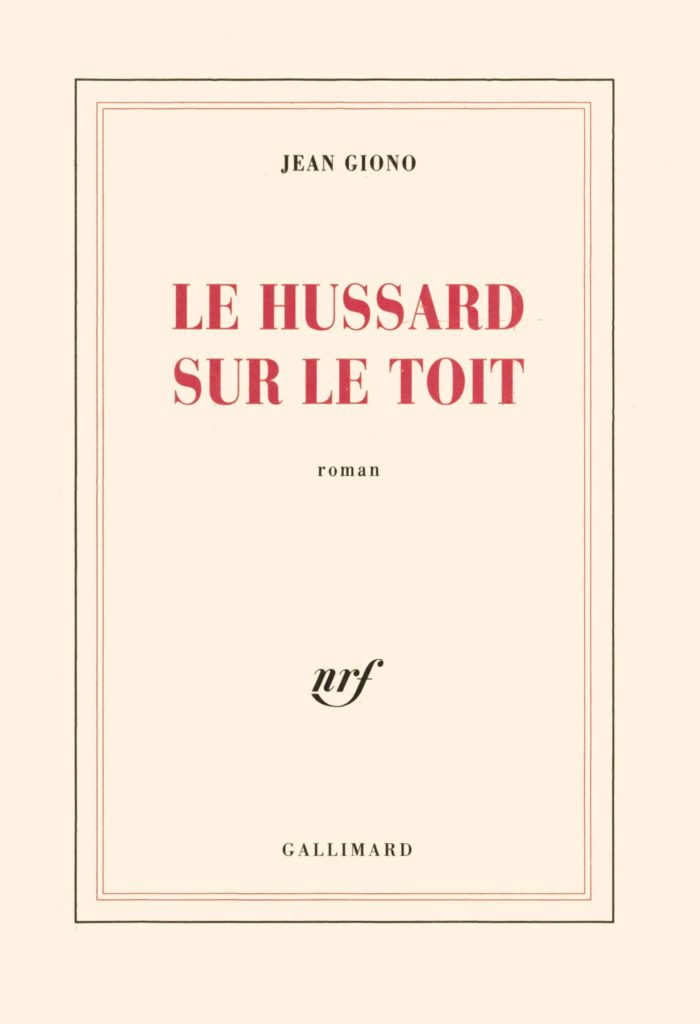Descriptions saisissantes, équipée ébouriffante, sentiments étincelants ; la critique n’a eu de cesse de faire du Hussard sur le toit un roman d’aventure. Mais certains commentateurs se sont gardés de n’y voir que cela, soulignant le caractère allégorique du roman : lutte du bien ou plutôt du « bon » contre le mal, la guerre, certains y décelant des rapprochements avec l’occupation allemande. Et si ce roman nous dévoilait non pas une opposition au mal mais, au contraire, le consentement au monde tel qu’il est ?
À pied ou à cheval, Angelo, jeune soldat du sentiment national italien, bientôt accompagné par Pauline, traverse librement une Provence que le soleil torture. L’adverbe est de toute importance : librement, c’est-à-dire libre des hommes qui barricadent le pays en tout sens, et libre de la raison même de toute cette agitation défensive : le choléra. Le héros est sain et s’obstine à contourner toute assignation à résidence pour retrouver un camarade de lutte. Pauline, quant à elle, cherche à rejoindre son mari. La maladie engloutit pourtant la région d’une bouche ardente et les morts s’alignent par centaines. La fièvre exulte d’où qu’elle vienne : de la maladie, du soleil, des craintes de la population hystérique. Angelo file au travers du vaste pays comme un vent pur, à la fois charitable et noble, prêtant assistance à qui est dans le besoin, fussent-ce des mourants, sans nulle crainte de la contamination. Il ne sera jamais inquiété et ne souffrira jamais de l’infection. Une question paralyse le lecteur tout au long du roman : Angelo succombera-t-il ? Et sinon, pourquoi ? Délivrant un par un les indices, Giono nous précipite au cœur d’une leçon anatomique et psychologique censée nous donner les clés de l’énigme. En réalité, le malade a le choix.
Le choix ? Oui, le choix de vivre. De rester dans son corps. Un des personnages rencontrés sur la fin livre son analyses de la maladie. Dans un exubérante comparaison – du corps à la géographie – il détaille tout ce qu’il a pu visuellement analyser des malades et des stigmates du choléra, mais aussi plus largement des organes et de leur fonctionnement. Ce qu’il en ressort ? Presque rien du tout ! Il semble convaincu que les affres de l’existences laissent des marques : « Qui nous assure l’absence de rapports proches ou lointains entre cette bile verdâtre qui emplit les boyaux, et l’amour ? […] qui me certifie que la haine, la jalousie n’ont aucune part dans ces tâches pourprées et livides, ces charbons intérieurs que je découvre dans les follicules muqueux intestinaux ? Qui soutiendra que la foudre bleuâtre pleine de paons sauvages de la jouissance s’est abattue des milliers de fois sur cet organisme sans laisser de traces ? », convaincu que les affections physiques proviennent largement de l’esprit.
Or, dans le cas du choléra, la « contagion » psychologique est de toute finesse. Le choléra, le voilà donc accueilli pour notre médecin, dans un « sursaut d’orgueil ». On crève par orgueil, certes, mais cela ne nous dit pas tout, pourquoi donc « mourir » de l’orgueil ? Il parait que l’amour-propre invoqué ici soit d’une nature particulière. Ne serait-il pas en réalité question de désespoir ? De l’orgueil moins la joie ?
« La peur donne des ailes et de l’esprit ». L’homme parle également des oiseaux migrateurs qui s’éloignent vers le zénith. À un certain moment en effet, le cholérique est comme stupéfié. Le voilà visualisant ses espoirs, ses rêves, son idéal. Il choisit, à cet instant même, de toutes ses forces, la mort. La mort plutôt qu’une vie décevante, ingrate, une vie qui n’est pas à hauteur des espérances, des calculs, des désirs. Bref, une vie qui ne nous mérite pas. Il se jette à la mort plein du dégoût de la vie.
Aussi, il ne s’agit donc pas d’un choix général, entre le bien, le mal, le bon, le mauvais, mais d’une alchimie personnelle, intime, travaillant le corps en profondeur. Ce jusqu’au moment où l’on se demande subitement « si tout ça vaut la peine », à l’instant où « les joies sédentaires foutent le camp ».
Et notre héros ? Lui qui échappe aux soubresauts, aux lèvres retroussées, aux dégueulis gluants qui remontent la gorge, l’emplissant d’une sorte de riz, n’est-il pas touché par le désespoir, à aucun moment ? Même lorsqu’il s’échine à frictionner les mourants dans le vain espoir de les sauver ? Non. Car Angelo n’est pas le porteur d’un idéal, il ne porte que lui-même. Il ne souhaite pas empêcher la mort mais se donner pour les vivants.
Le choix de la vie telle qu’elle est
Mais l’Italie libre ? Les combats héroïques ? La fougue invraisemblable qui le pousse sans cesse en avant ? N’est-ce pas la poursuite d’un idéal qui risque de s’avérer trop lointain ? Inaccessible ? Et pourtant, le voyageur ne cesse de se questionner, de remuer cet élan révolutionnaire scruté de façon presque inquiète, tâchant d’en peser la part juste et la part vaniteuse. Cette introspection va jusqu’à entailler son désir fraternel, sa candeur libératrice : « Si nous devons nous battre dans les rues, se disait-il, et tuer des soldats qui seront peut-être les fils de ce paysan pauvre mais à qui on aura donné des consignes, il faudrait au moins que nous ayons comme excuse la possibilité de changer la face du globe. Or, ceci nous échappe. C’est un royaume vide. Il y a ici du mal et du bien que nous ne pourrons pas réformer et qu’il vaut probablement que nous ne réformions pas ». Justement, cette vitalité est à la fois humeur protectrice et limite, une belle fièvre. Elle régénère la joie du personnage, son ardeur, sa désinvolture face à toutes ténèbres, sans qu’il ne se départisse pour autant d’une résignation résolument saine. À aucun moment Angelo ne déplore son sort, n’envisage autre chose que le monde qui s’offre à lui, univers qu’il traverse plus qu’il n’affronte. Angelo ne s’oppose pas mais consent à son destin. Il est à l’aise avec ce monde, fut-il hideux. Le jeune italien reste à l’intérieur, c’est-à-dire dans son corps.
C’est aussi le cas de Pauline, la cavalière qui l’accompagne, jusqu’au moment où elle tombe gravement malade. Est-ce la frustration, l’amour physique impossible, l’irrésistible envie de garder avec soi ce beau jeune homme qui la conduit à choisir la mort ? Ne désespère-t-elle pas d’un amour charnel ? Elle fera cependant le choix de la vie telle qu’elle est, le choléra refluant puis disparaissant totalement.
Voilà ce que nous décrit Giono, au travers des landes écrasées de soleil ; le désespoir est l’égoïsme le plus profond, il se glisse insidieusement entre les fibres, les nerfs et gangrène peu à peu l’homéostasie. Chercher à mettre la vie à portée de nos désirs est un jeu dangereux. Nous mettre à portée de la vie est source de guérison, de joie. Cette sage humilité travaille incessamment le héros sans qu’il n’y prenne garde. C’est tout au fond de son cœur qu’elle éclaire ses ardeurs. Lui qui, face à la brutalité de la mort, ira jusqu’à se méfier de ses plus grands rêves de grandeur, pour simplement suivre sa route.
« Il pensa à cette jeune femme qui se desséchait dans l’entrebâille d’une porte, à une dizaine de mètres au-dessous de lui. Dommage qu’elle ait été précisément parmi ces plus malades. La mort avait taillé une déesse en pierre bleue dans une belle jeune femme, qui avait été apparemment opulente et laiteuse, à en juger par son extraordinaire chevelure. Il se demanda ce que les plus roués cagots de la liberté auraient fait à sa place quant il avait eu besoin, lui, de tout son romanesque pour ne pas crier quand les reflets de la bougie s’étaient mis à haleter dans cette chevelure d’or. – Et s’agit-il vraiment de liberté » ?
Quentin Dallorme
Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.