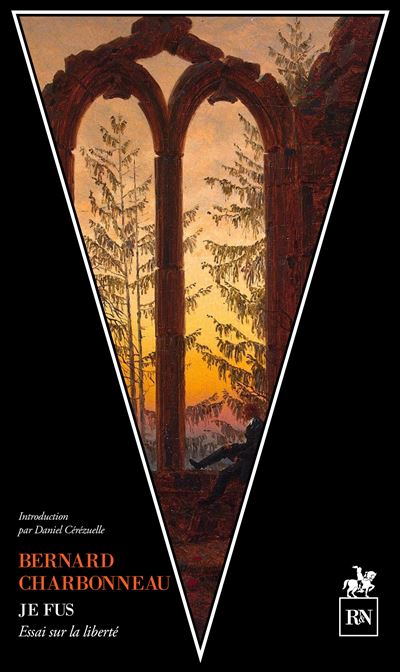Qu’est-ce que la liberté ? Cette question pourrait être celle d’un quelconque examen de philosophie. Pourtant, rien de moins de scolaire que la façon dont Bernard Charbonneau reformule la question et propose une réponse dans Je fus (R&N, mai 2021)
Ce qui fait, en premier lieu, l’écrivain est sa voix, sa langue, non ses récits, ses personnages, ses idées. Il en va de même pour certains philosophes, rares, sans doute, dont la pensée n’est saisissable qu’en entendant la voix qui la porte, en faisant sienne la langue qui l’exprime, en l’acceptant, en l’habitant. Il en va certainement ainsi de Bernard Charbonneau (1910-1996). « Dans ce livre, je parlerai de la liberté », dit-il en s’adressant au lecteur. Il définit là tout à la fois le propos et son mode. Cependant, longtemps cette parole sur la liberté est restée inaudible — mais ne disait-il pas que parler de la liberté était « presque impossible » ? Rédigé peu après la fin de la Seconde Guerre mondiale, l’ouvrage est resté inédit trente ans. En 1980, eut lieu une première parution, mais à compte d’auteur. La réputation de ce dernier, de ce plus que proche d’Ellul, suffisait à lui ouvrir bien des portes, sans doute, mais cela n’a pas suffi pour un tel livre. Aujourd’hui, grâce aux éditions R&N, cet essai sur la liberté est enfin rendu accessible au plus grand nombre.
À coup sûr, le titre trouble : Je fus. Essai sur la liberté. Essai sur la liberté ? On comprend car c’est bel et bien un essai qui a pour sujet la liberté. Mais Je fus ? Qui est donc ce « je » ? Pourquoi diable n’est-il plus ? Et qu’est-ce que cela a-t-il donc à voir avec le fait d’être libre ? C’est l’une des clefs de la pensée de Charbonneau : l’homme libre est celui qui a conscience de sa mort et qui sait qu’il sera un jour comme s’il n’avait jamais été.
Si l’homme n’est pas libre, s’il est partout dans les fers, c’est par lâcheté, par facilité. Face au tragique de la liberté, qui est son lien intime à la mort, l’homme fuit. Il se réfugie dans l’obéissance aux dieux puis dans celle, plus trompeuse encore, aux sciences qui prétendent dévoiler la « force des choses ». Voyant ses fils, la marionnette se croit libre. L’homme intériorise les déterminations sociales ou biologiques et croit ainsi les dominer. Ici, la pensée de Charbonneau (mais pas sa langue) fait songer à celle des moralistes français qui, sous le voile des grands sentiments, savaient voir et décrire les ressorts et les ruses des mesquines passions humaines. L’homme dit, sincèrement, « liberté », mais il pense « force des choses » et cette confusion est constitutive de ce que l’auteur appelle la « Grande Mue ».
Parfaitement aliéné, mais croyant que cette aliénation est la plus grande des libertés, l’homme moderne arraisonne le monde, détruit la nature partout, la détruit en lui-même. Homme endormi, que reste-t-il du jour ? Le point de non-retour n’est-il pas trop proche ? En tout cas, à son oreille se fait entendre une voix trompeuse : « Ne nous inquiétons pas. Tous, et chacun, nous avons reçu ce compte en banque ; à tout jamais la liberté nous est donnée, par Dieu ou le Cosmos. La Liberté c’est la Nécessité. La Liberté c’est l’État. Nous pouvons dormir tranquilles, nous avons des casernes et des prisons pour les défendre. »
Une liberté mensongère
L’homme endormi répond que vient la nuit, mais aussi le matin et, non sans évoquer Patmos de Hölderlin, Charbonneau répond que « [l]a chance de notre temps est exactement celle de ses périls ». Jamais l’esprit de l’homme vivant n’a-t-il était aussi colonisé par son être social. Jamais donc cette « liberté mensongère », seule capable d’ « anéantir une liberté vivante », n’est-elle plus exposée que dans son triomphe. La gigantomachie que ce philosophe veut peindre est celle, intérieure, de l’homme contre son être social. Et ce combat à peine commencé, sans même que son issue en soit connue ou même connaissable, est déjà, en quelque sorte, gagné. Car ce combat est la liberté elle-même. Il implique un « je » qui se pense et se dit contre le « on ». Il est un mouvement vers la liberté et dans ce livre Charbonneau n’en peint pas l’être, il peint ce passage.
« Quand l’univers l’écraserait, l’homme serait encore plus noble que ce qui le tue parce qu’il sait qu’il meurt », écrit Pascal ; Charbonneau ne dit pas autre chose : « L’univers entier me crie : Tu n’es pas, et je te le prouve en t’anéantissant. Je lui réponds : je le sais. Tu n’atteindras pas jusqu’ici ta victime. » La vérité de tout homme est dans cette conscience qu’il ne sera plus. Ce « Je fus » indicible est dans sa potentialité paradoxale l’essence de la liberté car « c’est la mort qui nous situe et qui nous définit ».
Ici, la parole, souvent si naturelle de Charbonneau, se heurte à l’indicible et au paradoxe puis tombe ou s’élève — s’ouvre en tout cas — dans l’apophatisme. Le ciel, la terre et les dieux sont absents de cette gigantomachie, seuls les mortels sont présents, mais non en tant que groupe ou en tant qu’êtres sociaux, mais en tant que personne humaine réduite à son intimité la plus grande, à son être le plus propre et le plus incommunicable. C’est là et uniquement là que se joue la liberté de l’homme, pour Charbonneau. Non sur les barricades ou sur les champs de bataille, mais dans ce qu’il y a de plus privé, à l’échelle la plus basse, celle de l’individu par nature indivisible et impuissant à se dire au monde. C’est seulement là qu’il peut « accepter la mort, l’angoisse et le conflit » c’est-à-dire « accepter d’être libre ». En ne reculant pas devant le tragique de la liberté, en sachant qu’un jour il sera dit de soi « il fut » et en y acquiesçant, sans peur ni forfanterie, il devient libre. Cela suffit et c’est le plus important, car si tout est vanité sous le soleil, la liberté, elle, « est tout sauf vaine ».
Certes, le lecteur peut ne pas se faire à cette voix, ne pas s’accommoder de cette langue ; il peut trouver l’analyse naïve, le propos daté (et sans conteste, les conditions de la rédaction sont liées à l’immédiat après-guerre). Reste que l’ouvrage, en plus d’être beau et bien édité, a au moins une valeur historique. Il témoigne d’une tentation et d’une tentative de la pensée française, mais aussi d’une forme de radicalité bizarrement empreinte de modération qui n’est pas sans évoquer certaines tendances très actuelles.
Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.