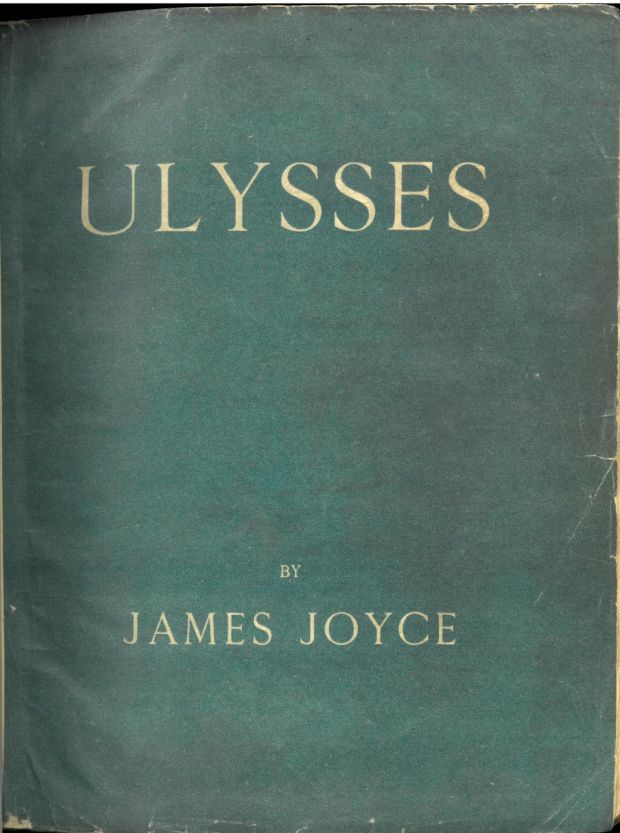Palimpseste de l’épopée homérique, l’Ulysse de Joyce est un roman qui déconcerte à plus d’un titre. Son illisibilité, ses étrangetés stylistiques, la fragmentation du récit, ces éléments, ainsi que la longueur de ce continent de prose, concourent à léser nombre de lecteurs, et à lui conférer la réputation d’un redouté de l’histoire littéraire. Un texte qui a bouleversé la vie romanesque, jusqu’à la définition de la narration, ne saurait être facile. Mais à qui sait habiter cette œuvre – car la lire c’est ici résider – c’est un archipel insu qui se présente, une cavalcade dans un infini où chaque pas contient sa propre dignité, en somme, une expérience.
16 juin 1904, Dublin. C’est cette journée que raconte Ulysse. Stephen Dedalus – Télémaque – et l’Ulysse dublinois, Leopold Bloom ; avec la présence remarquable de Molly Bloom, cantatrice et femme de Leopold. Et cette journée est triviale. L’insoupçonnée force du quotidien. Un quotidien que Joyce identifie à la Vie. Il faut donc, pour incorporer cette totalité, envisager le jour sous tous les angles possibles, le longer pour le prolonger, et se risquer à représenter un tournoiement intensif ; réaliser en littérature le chiliogone cartésien.
Leopold sort de chez lui – alors que sa femme pourrait le tromper, il préfère ne pas s’interposer –, et cherche, en agent publicitaire, des informations toute la journée ; mais sa quête se dissout et le plus souvent, c’est un homme qui erre dans les rues de Dublin, comme dénué d’ombre, silhouette discrète, tacite, que nous suivons. Le monologue intérieur, qui est le procédé d’écriture par lequel nous entrons dans les pensées d’un personnage – pensées insaisissables, effleurées au vol, éclatantes –, abolit les canons de la narration « classique », et par cette descente dans la conscience et l’inconscient d’une personne qui vaque à ses occupations, Joyce retranscrit la vie qui prend pour chœur le corps d’un homme. Par moment, Bloom décrit simplement ce qu’il voit : des rues, des commerces, des personnes ; par moment s’interroge sur sa condition de juif, d’exilé (combien de référence à la terre promise, à l’Ancien Testament…), sur le vide qui élague l’Irlande, la ville, et les hommes. Ses bottes, éculées par la marche, offrent pourtant de vrais onguents sapides.
Nous sommes dans Ulysse à l’intérieur d’un archipel infinissant. Ses chapitres s’autonomisent à mesure que le livre avance ; on peut parler d’une myriade de nuances pour songer à ces variations auxquelles procède l’écrivain –, on aborde alors un corps pluriel, un foisonnement des langues prodiguées par un savoir encyclopédique. Ulysse est une polyphonie dont les voix sont en réalité moins des personnages que des entités. Les entités sont des synthèses entre des personnages tenus par leur langage, et le langage dissolvant les personnages : le langage se fait cor, retentissant, et se réfléchit lui-même. Joyce verse le lecteur dans un chatoiement désiré où chaque épisode imprime une nouvelle lumière : le langage devient histoire.
Longue balade consacrée par la parole, le langage, qui pénètre toutes les demeures : le prosaïsme d’un Mulligan carabin, de certaines discussions dans les pubs ; l’amplitude d’une discussion sur Shakespeare où Stephen pose que le personnage principal de Hamlet est le spectre du père (que Shakespeare jouait lui-même) et non Hamlet lui-même – indication, peut-être, quant au fait que Bloom serait ce père absent, ce père impossible que cherche Stephen, sans trop le savoir –, les méditations esthétiques sur une plage où chaque parole que profère le jeune artiste prend des tons incantatoires, comme seuls certains grands moments de solitude peuvent les formuler :
« Je repousse cette ombre circonscrite, inéluctable forme humaine, et la rappelle. Illimitée, pourrait-elle être mienne, forme de ma forme ? Qui prend garde à moi ici ? Où et par qui seront jamais lus ces mots que j’écris ? » (p.50)
Stephen est l’artiste en germe, artiste qui, comme le narrateur de La recherche du temps perdu, prend forme à mesure que le roman avance. Mais forme qui demeure indéfinie, puisque ne débouchant sur aucune réponse, quand Proust opère le geste d’une grande réflexion entre l’écriture et le temps douant ce faisant son œuvre d’une clôture. Ici, la partition finale n’en est pas une, plutôt, elle retrouve son début. Stephen est, pour une certaine part, une question en défaut de réponse. Et c’est un terme auquel il faut consentir si l’on songe au fait que dès le départ Stephen est absent au corps, comme immatériel, et que selon ce dernier ce qui définit l’artiste c’est la transsubstantiation par laquelle il s’élève dans le tout. Conception mystique du créateur dans l’ici-bas : la vocation artistique est de s’épanouir en tant qu’ombre. Shakespeare jouant le spectre du père dans Hamlet en est le parangon :
« [P]arce que la perte est son gain, il passe à l’immortalité tout d’une pièce, sans avoir profité de la sagesse qu’il a formulée, et des lois qu’il révéla. Il est un spectre, une ombre à présent, le vent sur les rochers d’Elseneur ou tout ce qu’il vous plaira, la voix de la mer » (p.193)
Consomption du créateur dans la création, voilà la voie dans laquelle s’engage l’écrivain. Si Stephen reste donc sur l’impossible rivage de l’indéfini, c’est peut-être qu’il fermente lui-même sa descente dans l’acmé des choses. Il est une figure du devenir permanent.
On pourrait aisément y fonder une théorie esthétique (peut-être à consonance hégélienne par le déploiement d’un devenir où l’identité du singulier et de l’universel formulera le sceau d’une nouvelle révélation), mais il faudrait alors l’incorporer à l’art poétique que déploie Joyce, en amont. Joyce produit en effet, selon Jean-Michel Rabaté[1], non pas un simple roman mais un véritable art poétique dont on identifie les principes avec les épiphanies – construction joycienne reprenant le sens initial du mot, l’apparition, pour exprimer la manifestation de n’importe quelle situation, prosaïque ou non, et souligner l’étrangeté que chaque moment quotidien peut contenir; acérer le temps par ces petits riens du quotidien.
Le monologue intérieur en est un autre : une suite souterraine s’entretisse, un réseau crépitant, une fugue versicolore, donnant alors à la parole une valeur propre. Ce jaillissement autonome décorde le roman de sa définition encalminée. Comme Mallarmé répondant à Degas : « [C]e n’est pas avec des idées qu’on fait des vers, c’est avec des mots », Joyce fait advenir le mystère de la parole par le mot, conception charnelle et non abstraite (ce qui n’interdit en rien l’hermétisme, et donc Mallarmé) de l’écriture.
Les rythmiques d’une époque
Au chapitre (qu’on serait tenté de nommer chant) XI, Les sirènes, les voix – toujours plurielles dans Ulysse – sont mêlées à la musique durant le concert à l’hôtel Osmond. Simon Dedalus, père absent (le non-père) de Stephen, va au piano, chante nostalgiquement ; suit Ben Dollard qui entonne une canzone sur l’Irlande, sa pureté, sa paix déchue, ses vertus de résistance face à l’oppresseur britannique. Bloom subit plus qu’il ne goûte ces paroles. Ce contraste confère à ce passage une floraison d’enchevêtrements : la mélodie est rejointe par un contrepoint, et le thème musical de la fugue devient motif littéraire. La partition tantôt lyrique, allègre ou graveleuse, chamarrée, peut donner au lecteur le sentiment d’une suite hallucinée. Mais il faut alors sentir qu’il y a au sein de ces variations une composition bien unique. Et de même qu’on sent dans le Lamento della Ninfa de Monteverdi un horizon poindre au seuil de la polyphonie, il en va de même ici où la musique de la langue condamne (et Bloom sortant du bar, avec) celle, hâve, de la frivolité malheureuse.
Cette incarnation d’une littérature musicale peut nous aider à saisir en quoi Ulysse peut être autant de tonalités, de sonorités et de contrepoints. Tous les genres littéraires sont représentés, et les conjonctures sont légion. On passe par exemple d’un enterrement à, plus tard dans le livre, la réapparition du défunt. Dignam, dublinois lambda, père de famille et alcoolique, est décédé. Depuis un convoi qui mène au cimetière, Bloom voit le corps de Dignam tomber de son lit, la gueule ouverte. On devrait leur cirer la bouche et tous les orifices se disent les spectateurs de cette scène. Cet humour noir est le pendant d’une suite d’évocations sombres : on suit des canaux et la rivière Liffey, dans un fiacre qu’on confondrait avec la barque de Charon dans le Styx. C’est que nous allons à l’Hadès. La mise en terre du mort est crénelée d’un gris tout beckettien. « Jusqu’au jour où il aurait besoin de quelqu’un pour le descendre une fois mort dans le trou qu’il aurait encore pu creuser tout seul » (p.208). Bloom a beau considérer que les cellules nous rendent « éternels », sur le plan matériel (s’opposant, implicitement, à l’immortalité de l’âme), la mort demeure l’inexplicable contre-jour de la vie. L’une et l’autre sont inextricables, leur liaison, énigmatique.
Dignam, enterré, revient plus tard dans un pub. Les dialogues empruntent cette fois à la comédie, le comique est suggéré par le décalage :
« – Qui est mort ? demande Bob Doran.
– Alors t’as vu son fantôme, fait Joe, que Dieu nous protège.
– Quoi ? fait Alf. Bon dieu. Y a pas cinq.. Quoi ?… et Willy Murray qui était avec lui, les deux là près de chez chezpluscomment… Quoi ? Dignam mort ?
– Qu’est-ce qu’il y a Dignam ? fait Bob Doran. Qui parle de…?
– Mort ! fait Alf. Il est pas plus mort que vous et moi.
– Possible, fait Joe. Ca n’empêche qu’ils ont eu le toupet de l’enterrer ce matin même. »
(p.495)
L’assemblée des voix essaime l’oralité dans l’écrit (celle-là même qui indique le rythme et que Manley Hopkins évoquait à propos de la Bible : « le mouvement de la parole dans l’écriture ») produisant une forte impression de théâtralité. Or, plus encore que ces discussions, il faut noter que le pauvre Dignam n’est pas mort selon Alf (ou pas plus qu’eux ne le sont…). Et si l’on se souvient de l’importance de la spectralité dans le texte qui va du fantôme de Shakespeare, aux fantômes des parents morts de Bloom, ainsi que la mère de Stephen, et qu’on la double de ce moment où Bloom, durant l’enterrement, sur cette contiguïté silencieuse entre la vie et la mort, on peut sans doute y voir une syncrétisme étrange des vivants et des morts, qui est analogue à celle de l’écriture : combien de référence à des éléments mythiques, anciens, médiévaux (de la théologie, à la philosophie, aux mystères théâtraux…) dans l’écriture de Joyce ! S’il s’agit de faire coïncider cette journée narrée et la Vie dans son entier, alors la mort y aura précellence. La mort a, elle aussi, une équivocité qui lui donne différent reflets selon le moment de la journée raconté : elle peut être synonyme d’un deuil du sens qui frappe d’inertie tous les dublinois, comme noués à l’absence; mort d’une nation, l’Irlande, dont tout le folklore ne se conjugue plus qu’à l’imparfait ; le mort-né qui sous-tend régulièrement les pensées de Bloom (les allers-retours entre telle et telle pensée, la résignation…). Elle aussi se trouve irisée par les ondoiements de ce 16 juin.
Joyce a intimé à son écriture de se faire sève, et si un Beckett fait de la dialectique laconie-circonvolution indéfinie, le sel de son théâtre, son compatriote envisage le bâti moderne d’une tout autre envergure. Sont présents des éléments modernes comme cette narration intérieure lovant des suites d’épiphanies, une phénoménologie de la perception singulière, et d’autres traditionnels : ainsi la pièce de théâtre qui prend place au chapitre XV, fait écho aux mystères médiévaux, ou, en amont, la maternité dans laquelle Joyce pastiche Thomas Malory, Carlyle, retraçant la langue anglaise en miroir de cet accouchement ; le nouveau-né symbolisera le matin d’une autre parole. La méthode mythique[2] dont parle T.S. Eliot est illustré.
Surtout, il donne au roman une coruscation moderne, insoupçonnée, par cet archipel de voix et de sons. L’oralité fait sens : des grossièretés aux élucubrations abstraites, tout le monde est convié dans cette épopée moderne. La polyphonie devient art poétique, celui-là même que Pound essaiera d’inscrire dans le domaine éponyme, et c’est bien de ces harmonies chaotiques qu’il faut partir pour se larguer dans l’écume intarissable d’Ulysse. Ce dédale, antérieurement à la prose éclatée d’un Céline ou aux mouvements faulknériens, traduit l’effort spirituel permanent de la grande littérature, celui de mettre en jeu son propre corps, au risque de la mutilation, afin de congédier tout risque de coagulation, d’arrêt, et de participer à la moirure de son infini. Ainsi la musicalité d’Ulysse engage-t-elle à faire entrer dans le texte et dans ce Dublin moderne le tout de la vie, le tout de son ombre.
« Et ignotas animum dimittit in artes » (Il tourne son esprit vers l’étude d’un art inconnu).
Phrase que Joyce scelle en épigraphe du Portrait de l’Artiste en jeune homme. Il la reprend des Métamorphoses d’Ovide (VIII, v.188).
Pierre Jose
Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.
[1]Jean-Michel Rabaté, James Joyce, Hachette
[2]T.S. Eliot, Ulysses, Order and Myth, 1923