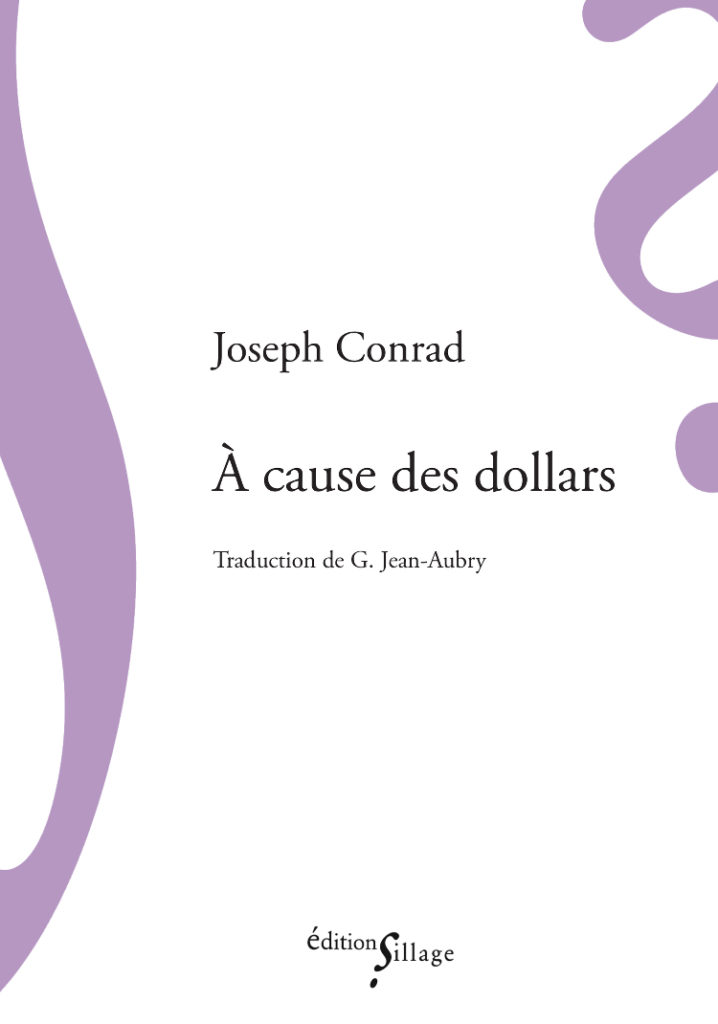Aux éditions Sillage vient de reparaître une nouvelle injustement méconnue de Joseph Conrad : À cause des dollars. Publiée à New York dans le Metropolitan Magazine le 14 septembre 1914, cette mésaventure maritime dépeint la manière avec laquelle la vie humaine peut être précipitée en enfer par la passion illicite de l’argent.
L’œuvre de l’écrivain de langue anglaise Joseph Conrad est marquée dans son ensemble par le motif de la navigation. Et pour cause, ce fils d’aristocrate polonais, né en 1857 du nom de Józef Teodor Konrad Korzeniowski, intégra à 21 ans la marine marchande britannique ; il obtint en 1886 son brevet de capitaine au long cours ainsi que sa nationalité britannique. À cet égard, la nouvelle À cause des dollars, dont les éditions Sillage reprennent la traduction française de G. Jean-Aubry parue en 1924,ne fait pas exception. À travers les souvenirs que le personnage Hollis partage au narrateur, elle raconte l’histoire de Davidson, capitaine d’un navire à vapeur nommé le Sissie, envoyé collecter dans les plus petits établissements de l’île de Célèbes, en Indonésie, de vieux dollars d’argent. Mais qu’on ne s’y trompe pas : bien que nous retrouvions l’Indonésie du premier roman de l’auteur publiée dix-neuf ans plus tôt, La Folie Almayer, cette nouvelle n’est pas d’abord un récit de voyage ou d’aventure. Elle est avant tout le récit psychologique, peut-être spirituel, de la manière avec laquelle l’argent, dans sa toute-puissance silencieuse, peut parvenir à éradiquer en l’homme son humanité, en brisant des vies. C’est la raison pour laquelle Conrad a longuement hésité sur le choix du titre de sa nouvelle, qu’il baptisa d’abord Anne-la-Rieuse (Laughing Anne), ce qu’il reprit pour son adaptation théâtrale en 1920. Or, l’auteur se décida finalement en 1915 pour le titre que nous lui connaissons actuellement, Because of the Dollars, afin de souligner que le motif criminel de l’argent est premier, en ce qu’il cimente le destin commun de ses personnages.
Humanité défigurée
Si Conrad s’est heurté à la difficulté d’intituler sa nouvelle par le nom de son personnage principal, c’est parce que celle-ci s’articule autour de deux personnages principaux : le capitaine Davidson et son amie d’enfance Anne-la-Rieuse. Ces deux personnages ont un point commun : ce sont par nature deux figures de gaieté. En effet, Anne-la-Rieuse ne doit pas son surnom à autre chose qu’à sa tendance fréquente et naturelle à « rire un peu hystériquement » ; Davidson, pour sa part, est semblablement décrit par les personnages comme un homme « corpulent et sympathique », « vraiment bon » et « profondément humain ». Ainsi est-il qualifié par Hollis , lorsqu’il le croise, avec le narrateur, au début du roman en se promenant sur le port de Singapour. De telles qualités sont exprimées par « son habituel sourire aimable » et sa « placidité extérieure », qu’il ne quitte jamais… à une nuance près, qu’Hollis remarque en disant : « Davidson sourit parfois, vous l’avez vu […], son sourire, c’est la seule chose qui n’est plus comme autrefois. » Aussi, ce changement interpelle-t-il le narrateur, qui a bien remarqué lui aussi ce visage et ce sourire « voilé[s] de mélancolie, d’une sorte d’ombre intérieure ». Le narrateur fait de ce changement physiologique la question fondatrice de la trame narrative : « Qui donc l’a récompensé d’être si bon en lui gâtant son sourire ? »
La réponse de Hollis à cette question constitue alors la matière même de toute la nouvelle, qui naît de ce problème à résoudre. À l’origine du récit figure cette disjonction, ce hiatus entre l’éminente bonté de Davidson et la mort dans l’âme qui vient déformer ce sourire pourtant authentique, dont le lecteur, avec le narrateur, attend d’en découvrir la cause. Or, il s’avère que la raison de cette difformité n’est autre que l’argent, qui est par deux fois présenté comme la cause suffisante du malheur, en premier lieu par la femme du capitaine, inquiète de son expédition : « elle pensait qu’il y avait du danger à cause des dollars » ; en second lieu par le narrateur lui-même qui résume aux dollars l’origine de l’isolement désastreux de Davidson : « tout cela à cause de ces vieux dollars ». En effet, le héros est victime, lors de sa collecte des dollars dans le village insulaire de Mirrah, d’une tentative de vol nocturne, en bande organisée, des caisses de dollars abritées par la Sissie. Au cours de cette tentative, Davidson assiste impuissant à l’assassinat d’Anne-la-Rieuse, au crâne fracassé, au sourire soudain définitivement aboli. Cet événement marque alors le début de sa chute inexorable : flanqué d’un sourire déformé par un chagrin incurable, Davidson revient auprès de sa femme en lui proposant d’accueillir le fils orphelin de son amie d’enfance. Elle s’y refuse par ressentiment, jalouse que son époux lui ait tu les événements de la tragique expédition qu’elle lui avait pourtant défendu d’entreprendre. Il finit alors sa vie seul, la mort de son amie d’enfance sur la conscience, incapable d’assumer seul l’éducation de l’enfant à cause de ses longues absences de marin et abandonné par sa femme à la fierté blessée. « Tout cela à cause de ces vieux dollars ».
La banalité du mal
En ce sens, nous voyons sans conteste que ce qui constituait la question fondatrice du récit en est aussi, par conséquent, sa réponse conclusive : « telle est l’histoire qui a gâté le sourire de Davidson ». Dans cette nouvelle de l’écrivain britannique, l’argent abîme le visage humain, lui fracasse le crâne et lui voile le sourire. Pour autant, Conrad procède-t-il à une dénonciation sans mesure de l’argent ?
Il serait inadéquat de prêter au romancier des prétentions mystificatrices. L’argent n’est pas présenté comme un démon ou une force invisible ; il est placé dans le contexte ordinairement perceptible des échanges. En effet, le capitaine Davidson a pour mission très ordinaire d’aller collecter de l’argent pour le gouvernement qui s’apprête à changer de monnaie. Comme l’indique l’appareil critique, il s’agit de remplacer les Trade dollars, « frappés à partir de 1873 aux États-Unis et mis en circulation en Chine et dans plusieurs pays d’Orient ». Pour ce faire, ces dollars d’argent ont été progressivement retirés de la circulation à partir de 1878 et leur matière réutilisée pour la frappe d’une nouvelle monnaie : c’est donc cette mission de collecte que Davidson est chargé de réaliser.Dans cette perspective, que l’argent puisse être une cause d’égarement insoupçonnable, cela ne se voit pas à l’œil nu, mais se déduit de certains usages et regards que porte sur lui l’individu. Et c’est tout le problème : le mal gît dans la banalité.
C’est pourquoi Conrad n’emploie même pas ce mot d’argent (money) dans sa nouvelle. Il emploie le terme, beaucoup plus ordinaire et tangible, de dollars. Le contraste est ainsi d’autant plus frappant entre la banalité de cette chose et sa capacité de destruction des vies humaines. L’argent, monnaie muette autant que satisfaisante, est silencieux sur sa puissance de mort.
La femme, puissance d’éveil
Si l’argent est muet, qui donc peut être capable de déchiffrer son langage, dans son entièreté ? En l’occurrence pas le héros, car Davidson assume volontiers la mission de collecte qui lui est confiée. Le personnage qui, en fait, discerne le mal dès le début de la nouvelle, n’est autre que la femme de Davidson. C’est elle qui, en amont de l’expédition maritime, l’avertit de sa mauvaise intuition : « sa femme en faisait tout un foin, elle l’avait supplié de rester à terre et de se faire remplacer pour ce voyage. […] Elle serait inquiète tout le temps qu’il allait être parti. » Malgré l’expression de cette crainte, Davidson reste sourd et se montre même amusé par cet avertissement : « Il lui avait répondu […] qu’il n’y avait plus, de nos jours, de pirates dans la mer de Java, si ce n’est dans les livres pour enfants. Il avait ri de ses appréhensions, mais il était désolé tout de même ».
La femme de Davidson n’est cependant pas la seule à deviner le naufrage moral qui se prépare. Au cours même de l’expédition, Anne-la-Rieuse, dans une démarche si risquée qu’elle en est sacrificielle, avertit Davidson du brigandage dont son bateau et lui-même s’apprêtent à être victimes : « Mais que va-t-il vous arriver ? Ils en veulent aux dollars que vous avez à bord. » En avertissant Davidson, Anne-la-Rieuse expose sa vie et celle de son enfant à un terrible danger : celui d’être découverte par le brigand français, avec qui elle s’est stratégiquement acoquinée, comme la traîtresse responsable de l’échec de son plan. Or, la maladie de son fils cloué au lit la retient dans la petite maison de ce village de Mirrah : « Si le petit n’avait pas été mal je me serais enfuie avec lui – vers vous – dans la forêt – n’importe où. » Tel est malheureusement le sort qui l’attend : Davidson ayant déjoué les plans des voleurs sans avoir prévu le sort qui serait réservé à la malheureuse, il la condamne, impuissant, à être poursuivie et assassinée dans la nuit par le voyou.
En somme, la nouvelle de Conrad se présente comme un blâme de l’argent en même temps qu’un éloge, prudent mais réaliste, de la féminité. Dans la nouvelle, ce sont en effet les femmes qui, soit par leur jalouse circonspection soit par leur héroïque et maternelle générosité d’amour, se montrent capables de percer l’enveloppe muette du démon ordinaire de l’argent pour en déceler la puissance mortellement tentatrice. À l’aube de la Première Guerre mondiale, ou plus exactement au commencement du crépuscule de l’Europe, Conrad nous montre combien ce foyer privilégié de la tentation au mal observé par les différentes religions traditionnelles devient banalement et insensiblement piégeur. Son diagnostic, en un sens, rejoint alors celui que formule Péguy de l’autre côté de la Manche, lorsqu’il constate, dix ans plus tôt, dans sa Note conjointe sur M. Descartes et la philosophie cartésienne, que « pour la première fois dans l’histoire du monde toutes les puissances spirituelles ensemble et toutes les autres puissances matérielles ensemble et d’un seul mouvement et d’un même mouvement ont reculé sur la face de la terre. […] Pour la première fois dans l’histoire du monde l’argent est maître sans limitation ni mesure. » Mais à la différence du directeur des Cahiers de la Quinzaine, l’écrivain britannique ne situe pas l’argent « seul devant Dieu » : pour lui, à côté de l’Esprit, il y a la Femme. Dans la sagesse de ses vices autant que de ses vertus, l’instinct féminin fait face à la monnaie, cette seule amante capable de ravir à la femme ses biens les plus précieux : la raison de l’homme et le sourire de l’enfant.
Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.