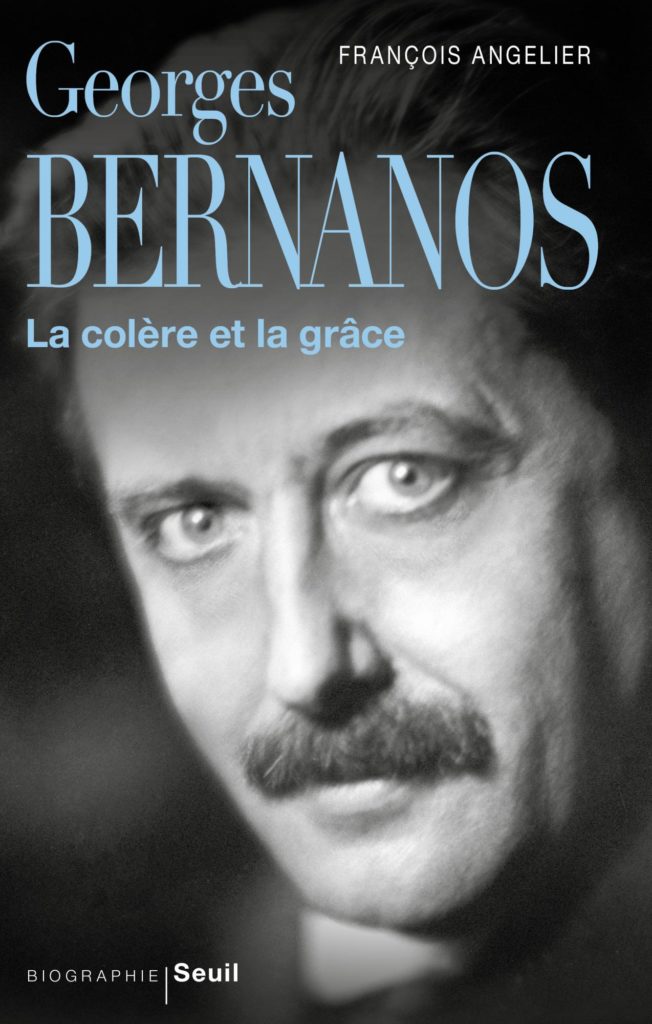François Angelier est journaliste, éditeur et auteur. Il produit notamment l’émission « Mauvais genres » sur France Culture et dirige la collection Golgotha chez Jérôme Millon. Au Seuil, il vient de faire paraître Georges Bernanos. La colère et la grâce, une monumentale biographie de l’écrivain royaliste. Avec lui, nous nous sommes plus particulièrement intéressés à la question de la technique qui va hanter Bernanos jusqu’à la fin de sa vie.
PHILITT : La formation intellectuelle de Bernanos (Action française, Drumont) ne le prédisposait pas à s’intéresser à la question de la technique. Pourtant, ce thème va hanter les dernières années de sa vie. Quand commence-t-il à en parler et pour quelles raisons ?
François Angelier : Cette question apparaît soudainement, de façon pleine et entière, à la fin de La Grande peur des bien-pensants (1931), défense exaltée d’un Édouard Drumont très personnel, presque imaginaire, décrit comme un pamphlétaire solitaire dressé contre la République ploutocratique et l’affairisme démocratique. À la fin de l’ouvrage s’impose à Bernanos une vision de la cité future, une cité dictatoriale où l’homme n’est plus que le desservant d’un peuple de machines. Si cette vision rappelle Metropolis (1927) de Fritz Lang, on ne sait pas exactement d’où elle provient. Elle se développe et s’amplifie ensuite avec une particularité : Bernanos n’est pas un antitechniciste nostalgique d’une époque préindustrielle. C’est un motard forcené, il a le goût des randonnées motocyclistes très longues avec sa femme ou avec ses amis. Il n’y a pas d’hostilité de principe chez lui à la technique. Il fait d’ailleurs enfourcher la moto du légionnaire au curé d’Ambricourt dans Le Journal d’un curé de campagne (1936) en ajoutant une description du sentiment physique que l’on éprouve au contact d’une telle pratique.
La moto a donc un statut paradoxal : c’est une machine qui rend libre…
La moto est pour Bernanos une sorte d’hyper-cheval, un cheval d’acier qui lui permet une très grande liberté, qui lui donne l’impression d’être projeté au cœur de l’espace, de maîtriser la vitesse et l’élan. Ce n’est pas un engouement éphémère. Il en fera jusqu’en 1947 (un an avant sa mort) et malgré un accident terrible survenu en 1933 qui va l’handicaper à vie.
Tout cela véhicule une sorte d’imagerie du chevalier moderne !
Oui, cette idée est présente dès la Première Guerre mondiale. Bernanos a tout fait pour se faire intégrer au 6e régiment de cuirassiers malgré une santé fragile. Il a ensuite demandé à rejoindre l’aviation militaire qui était à ses débuts. Il trouvait très exaltant l’idée de participer à cette aventure militaro-machinique. Mais il a été refusé à cause de problèmes oculaires.
« Bernanos n’est pas un antitechniciste nostalgique d’une époque préindustrielle. »
Peut-on considérer que l’expérience de la guerre est, pour Bernanos, le moment initial de la confrontation à la civilisation des machines ?
Bernanos a participé pendant cinq ans à la Première Guerre moderne. Il est seulement démobilisé en 1919. Il y participe à « l’arrière de l’avant », dans une position ambiguë. Il prend tout de suite conscience de la monstrueuse nouveauté de ce conflit. À ses yeux, on franchit là une limite dans l’histoire du monde : on passe de la guerre comme combat à la guerre comme industrie, d’une guerre d’affrontement à une guerre d’extermination machinique par les gaz, le lance-flamme, les tanks, l’aviation etc. Il y aura ensuite chez Bernanos des visions radicales, des visions apocalyptiques lorsqu’il envisage les guerres futures.
Comment réagit-il aux bombardements d’Hiroshisma et de Nagasaki ainsi qu’à la découverte des camps d’extermination ?
Il ne réagit pas car il les avait vus depuis longtemps ! Dans un texte de 1947, Dans l’amitié de Léon Bloy, Bernanos explique que le mendiant ingrat (et lui-même par un procédé d’identification) avait déjà anticipé tout cela. Ce n’est donc pas quelque chose qu’il découvre sur le mode de la stupeur ou de la sidération. Il s’y était préparé par sa méditation sur le devenir de la catastrophe.
Si Bernanos ne parle plus de « monde moderne », mais plutôt de la « civilisation des machines », il semble que Péguy ait joué un rôle décisif sur ce sujet. Dans quelle mesure ?
Le monde moderne de Péguy est plutôt une sorte d’ambiance générale diffusée par un certain nombre de docteurs et de personnages qui ont des fonctions presque magiques (Taine, Renan etc.). C’est une donnée globale qui se définit contre l’ancienne France. C’est un face à face entre les corps, les pratiques, les coutumes de l’ancienne France et le monde moderne qui en constitue la négation. C’est quelque chose de plus philosophique, de plus théorique alors que la civilisation des machines est pour Bernanos quelque chose d’extraordinairement concret. Une référence de Bernanos demeure méconnue : la trilogie des insectes de Maeterlinck. Bernanos y trouve une grille de lecture du monde moderne qui lui permet d’analyser le fonctionnement disciplinaire, alvéolaire et totalitaire de la civilisation des machines.
Dans un passage célèbre de la France contre les robots, Bernanos dit que la civilisation moderne « est une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure ». Qu’est-ce que cela signifie exactement ?
Le terme de « conspiration » est important. Cela signifie que ce n’est pas un phénomène historique irréversible. C’est quelque chose de médité, de fomenté, de calculé par les maîtres de la cité future : ingénieurs, philosophes, technocrates, financiers etc. Le terme de « vie intérieure » aussi. Il renvoie au monde des données fondamentales : l’enfance, l’honneur et la sainteté. Seule la vie intérieure vous permet d’approcher et de retrouver les ferments premiers. La civilisation moderne cherche à couper l’accès à l’esprit. Et cela passe par la négation de la vie intérieure. Tout ce que condamne Bernanos est de l’ordre de l’extériorité. Non pas la mauvaise pensée ou la mauvaise idéologie, mais quelque chose qui réduit l’homme à des stimuli.
« Une référence de Bernanos demeure méconnue : la trilogie des insectes de Maeterlinck. »
Bernanos estime aussi que la technique produit une nouvelle espèce d’homme. Il raconte qu’il était inconcevable « il y a vingt ans » qu’un « petit bourgeois français » se laisse prendre ses empruntes ou qu’on l’oblige à voyager avec un passeport. De quelle nature est la révolution mentale qui s’est opérée ?
Bernanos est à mi-chemin entre le métier à tisser et la reconnaissance faciale. Le petit bourgeois auquel il fait allusion – lui qui est loin d’être un défenseur de la bourgeoisie – c’est le Français moyen, petit entrepreneur balzacien qui joue son risque, qui mise le peu qu’il a, qui est encore un personnage indépendant. Il y a encore chez lui quelque chose qui renvoie à l’idée d’aventure personnelle. Et l’homme qui va advenir ne vivra plus d’aventure puisqu’il n’aura plus rien de personnel. Pour Bernanos, l’identité de l’homme se dissout dès lors qu’elle est réduite à des fiches d’identité. Ce qui définit un homme, ce n’est pas son anthropométrie. Quand l’anthropologie laisse place à l’anthropométrie, l’homme se dénature et devient un objet, un ustensile au service de plus malin que lui. Bernanos préfigure tout un mouvement de pensée (Ellul, Charbonneau, Anders). Il faut néanmoins avoir en tête que Bernanos est un client de café. Ce n’est pas un historien ou un sociologue. Il ne dispose pas d’une bibliothèque de 300 000 volumes. C’est un homme seul, dans un café, qui lit le journal. Tout ce qu’il dit, tout ce qu’il écrit est une réflexion à partir des données que lui livre la presse. C’est un méditant.
« La première vraie machine, le premier robot, fut cette machine à tisser le coton qui commença de fonctionner en Angleterre aux environs de 1760 », écrit-il. Cette machine fut aussitôt détruite par les ouvriers anglais. Cette geste est-elle devenue impossible dans notre monde où les machines sont désormais omniprésentes ?
On peut toujours casser des machines. Mais elles seront remplacées dans l’heure. En réalité, ce ne sont pas les machines qu’il faut casser, c’est le cerveau de l’ingénieur et les plans qu’il a conçus. La machine n’est jamais qu’un artefact, le résultat d’un travail théorique, d’une production industrielle. Bernanos rend hommage aux luddistes, aux « briseurs de machines ». Il aime cette réaction intuitive de l’artisan contre l’ouvrier, ou plutôt contre l’opérateur.
« La Civilisation des machines est la civilisation des techniciens, et dans l’ordre de la Technique un imbécile peut parvenir aux plus hauts grades sans cesser d’être un imbécile […]. » Quelle définition Bernanos donne-t-il de l’imbécile et pourquoi celui-ci s’épanouit-il dans la civilisation des machines ?
Il y a eu le bourgeois de Flaubert, le cochon bloyen et voici l’imbécile bernanosien. L’imbécile bernanosien, c’est celui qui croit bien faire, qui est persuadé d’avoir raison et qui, en définitive, pousse le monde à la catastrophe. Cela rappelle Renan, l’intellectuel de la IIIe République qui consacre la science et qui croit avoir trouvé la solution du problème. C’est sa figure emblématique de la nocivité. Imbécile, étymologiquement, c’est celui qui ne peut pas marcher sans une béquille, qui a besoin pour se mouvoir d’un objet technique.
« Nous allons vers un monde utilitaire, un monde qui est celui du profit et de la performance où l’enfant n’a pas sa place. »
Dans Français, si vous saviez (« Les Monstres »), Bernanos oppose la Technique à l’enfant. En quoi sont-ils antagonistes ?
L’enfant est un témoin des temps archaïques, de la pureté héroïque, de l’Eden. L’enfant est dans une sorte de nudité. L’homme de la civilisation technique est un enfant qu’on a forcé à travailler. L’homme, c’est l’enfant usiné, confisqué, défiguré par la machine. Pour les techniciens, l’enfant ne sert à rien. Nous allons vers un monde utilitaire, un monde qui est celui du profit et de la performance où l’enfant n’a pas sa place. L’enfant renvoie à la gratuité, à la pureté du geste, à l’innocence radieuse.
Dans La liberté pour quoi faire ?, Bernanos écrit : « Les techniciens n’ont pas besoin de nous. La question est de savoir si l’Histoire a un sens, ou si c’est la technique qui lui en donne un. Ou, pour parler plus clairement encore, il s’agit de décider si l’Histoire est l’histoire de l’homme, ou seulement l’histoire de la technique. » Comment tranche-t-il finalement la question ?
Bernanos dit que la technique n’a pas besoin de « nous ». Et ce « nous », c’est lui. Et lui, c’est les hommes libres : les mendiants, les gitans, les enfants, les errants… Le grand empire des machines n’a pas besoin d’hommes libres. Au contraire ! Ils ne lui servent à rien et peuvent même être dangereux. Réduire l’histoire à la seule ingénierie technologique, à l’homo faber, au seul développement de la civilisation matérielle, est une terrible erreur. Pour lui, la civilisation est tout sauf matérielle. Et il a tout fait pour vivre en dehors des rails, au sens strict. Au brésil, il a voulu vivre par-delà les limites du réseau ferré, hors-fer. Bernanos veut se situer par-delà la technique, dans une zone sauvage, une sorte de wilderness.
Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.