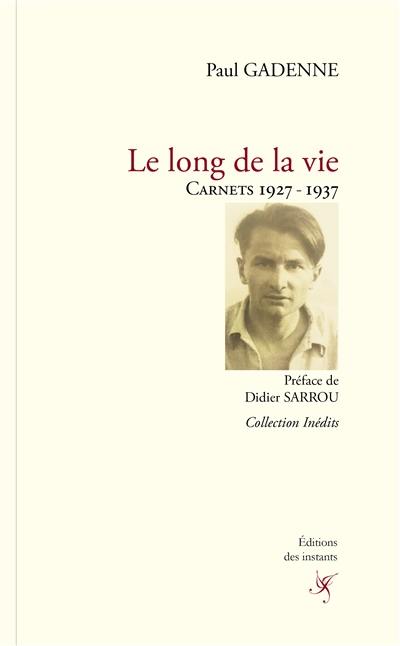Paul Gadenne (1907-1956), « le romancier congédié » selon le titre d’un livre que son exégète et préfacier Didier Sarrou lui consacra, est l’auteur d’une dizaine de romans et de nouvelles qui tentent de circonscrire les souffrances de l’homme moderne. La réédition par les éditions des Instants des Carnets, intitulés Le Long de la vie, permet de sonder la généalogie intellectuelle de ce romancier malheureusement oublié, chez qui la maladie et la solitude ont forgé une admirable connaissance du malheur des hommes.
Il convient ici de signaler que Les Carnets, comme toute production diariste, ont quelque analogie secrète avec les almanachs paysans : la certification et le doute sont renvoyés à la charge du lecteur. Pressentant une possible lecture biographique, Paul Gadenne a inscrit, postérieurement à la rédaction une mention teintée d’une ironie — si rare chez Gadenne qu’elle en devient exquise lorsqu’elle se manifeste — au sommet du Carnet II : « Méfie-toi lecteur qui t’aventurerait dans ce livre, ce sont ici mes mensonges ». Il bafoue ainsi d’un revers ironique les germes viciés d’une lecture qui se plairait à fouiller dans ses écrits le manifeste absent devant résorber, tel le foudroiement d’une vérité enfin révélée, les mystères de L’Invitation chez les Stirl ou de La Plage de Sheveningen. Cette mention résonne, et se transpose mimétiquement, avec la conception du roman que Paul Gadenne condensera dans son opuscule À Propos du roman, dans lequel il écrit que beaucoup de ses contemporains lisent un roman comme ils liraient un journal « avec l’espoir d’en retirer des informations ou de subodorer quelque scandale. […] Le mouvement du livre, son accent, les moments où il tourne sur lui-même, comme une porte sur son pivot, laissent entrevoir le revers des choses ». Comme Olivier Leirins dans L’Invitation chez les Stirl lorsqu’il déambule dans l’énigmatique maison de la non moins énigmatique Mme Stirl, on se perd parfois dans des « complications imprévues, des additions, des pièces vouées à l’oubli » au sein de ses Carnets. Néanmoins, et comme des arceaux qui planeraient au-dessus d’un ouvrage dont il conviendrait de repérer les trajectoires, on peut tracer un triangle qui relierait souterrainement ces neuf carnets : celui-ci aurait pour base la solitude et la maladie, et leurs lignes déchirantes convergeraient vers un sommet où siègerait l’espoir d’une rédemption.
L’incompressible solitude de Paul Gadenne
Dans l’antre de l’écrivain en puissance, c’est la diffuse marée de la solitude qui surnage dans l’intériorité de Gadenne, se minéralisant peu à peu en un continent de douleur. À de rares exceptions, la solitude — l’incompressible solitude de l’être souffrant — serait, si l’on se devait de le trouver, le motif central de ces Carnets. Tel le tapis persan, où les motifs s’entrecroisent autour d’une même volute, l’intimité de Gadenne enroule ses aspics tuméfiés autour d’un moyeu solitaire et torturé. Ainsi, dès les premiers carnets, c’est à l’aune de cette épine d’angoisse qu’il déclame sa complainte : « Je ne connais rien en dehors des quatre murs de ma chambre. Je suis seul. Aucun de mes besoins n’est assouvi, mes puissances restent inemployées. Serai-je seul toute ma vie ? ». Se raffermissant ensuite, dans le Carnet II en une puissance plus dangereuse encore — inatteignable : « La solitude dans les bois ou une salle de concert est une volupté trop dangereuse pour que je la cherche encore ». Le sourd crissement de l’être solitaire sur les pages tend dangereusement à se rapprocher avec l’exil nécessaire que Dante rendait indispensable à toute forme de création[1]. La solitude chez Gadenne n’a pas eu l’effet d’une retraite obscure dans un lieu interdit où le sage serait comme délivré du souci des hommes, elle lui dévoile au contraire le strident et unanime hurlement de la souffrance des âmes meurtries. Le retranchement forcé qu’il a dû subir à deux reprises dans le sanatorium de Praz-Coutant devient le lieu d’une convulsion permanente où les amours conquises puis perdues s’enroulent vers le gouffre, autour d’un maelström grandissant de solitude. En grand lecteur de Kierkegaard, Gadenne développe des relations qui semblent se conjuguer à l’aune de cette impossible Reprise que fut la relation entre Kierkegaard et Régine Olsen. Et la solitude des lettres non reçues vient se surajouter à cet amas de souffrance qui se cristallise en lui : « Mon être est distendu par les désirs, les déceptions, la douleur. Mon Dieu, je ne vous sens plus, et la nuit en moi est presque totale. Je ne sais plus pour qui je souffre. »
L’immense complainte endeuillée que Gadenne découvrit alors durant ses cures successives, il la remémora dans ses Carnets sous forme d’innombrables ébauches de romans et de croquis d’études. Le roman se fait ainsi l’unique prisme de ses impressions — il est la « seul forme qui répond à cette curiosité de l’homme pour l’homme », tel qu’il le définit dans À Propos du roman. Dès lors, et en cela l’expérience du sanatorium est capitale, une scansion profonde irrigue désormais Gadenne : la recherche des effluves sacrées du miracle de la communion éblouissante va devenir son nadir rédempteur. Charles Blanchet, le seul relecteur des manuscrits de Le Long de la vie après Yvonne Gadenne, évoque cette mystique de la communion en citant un passage des Carnets de Siloé dans un article publié en 1963 et intitulé « Gadenne où la passion de la rencontre » : « La vie ne vaudrait pas la peine d’être vécue si elle ne comportait un échange entre les êtres, une communauté, une effusion, un transfert, un don, un échange d’influx ».
Loin de s’apitoyer inlassablement sur sa propre damnation, ces Carnets grésille selon la vibration que Gadenne observait dans Les Trois Sœurs de Tchekhov dans le Carnet I : « C’est que la tristesse n’est pas causée d’emblée. […] La tristesse n’est ni uniforme ni continue ». La douleur se délie puis se rétracte en pur moment d’extase avant de se reformer en un nœud serré, où la jointure ouverte sur une possible rédemption n’en est que plus éclatante. Comme le plissement des lèvres qui aiguise le sifflement, les spasmes de la souffrance aurait quelques liens enfouis avec le raidissement d’une empathie. Chez Gadenne, on retrouve en toute page ce regard enveloppé d’une profonde complainte qu’un Gadda a pu porter sur les plus hautes cimes dans sa Connaissance de la douleur — tous deux écrivains d’une immuable douleur charnelle ; le titre originalement traduit étant Une connaissance depuis la douleur. Reliés par un abîme de solitude qui n’a eu de cesse de ronger leur existence, Gadenne comme Gadda ont puisé leurs cognizionedans les sombres nuées des nuits percluses qui deviennent le creuset d’un impouvoir des larmes.
« Seul celui qui a porté jour après jour depuis un sombre et lointain horoscope le fardeau de sa vie pourra se réputer être son propre biographe », voilà ce qu’écrivait Gadda dans la préface d’Éros et Priape. Ce à quoi Gadenne ajouterait sans doute : Seul celui qui a porté jour après jour depuis un sombre et lointain horoscope le fardeau de sa vie pourra se réputer être le biographe des autres.
La cognizione de la douleur
Dans l’amoncellement continu des publications, rares sont les œuvres qui s’appesantissent sur la longue patience de Paul Gadenne [2]. Exception faite pour L’Architecture de Marien Defalvard où la mention de Paul Gadenne apparaît nommément au détour d’une grammaire littéraire. En décrivant les deux types d’écrivains qui s’étreignent sur l’axe immensément vertical de sa critique, Defalvard dépeint un Paul Gadenne extatique et puissant, qui fait partie du premier groupe, du « type de ceux qui creusent, qui creusent une intuition initiale, un terreau, qui tournent en vrille à l’intérieur d’une obsession ». Paul Gadenne serait de ces écrivains de l’intérieur, qui sonde les plaies et les contusions tuméfiées qui meurtrissent le cœur de l’homme. Au contraire d’un Nabokov que Defalvard décrit comme étant du second ordre, du type de ceux « qui se donnaient au monde, qui allaient vers lui. Le creusement, le combustible n’était pas en eux mais hors d’eux […] »[3]. Désigner la maladie dont souffrait Gadenne comme une obsession d’écriture chez lui serait tout à la fois véridique et mensonger. Elle gouverne certes souverainement l’arrière fond physique de chaque phrase, celles-ci étant écrites par le douloureux patient de la tuberculose qu’est Paul Gadenne. En place et lieu d’une obsession, on y lirait plutôt dans ces Carnets un perpétuel brasillement du corps souffrant — une vibration tantôt précise tantôt instable de l’écrivain en construction.
Chez le patient préalablement meurtri, la moindre grippe sonne l’épouvantable tocsin de l’addition mauvaise. Gadenne, en proie à une lourde fièvre passagère, nous décrit alors ce qui semble être une descente dans les enfers de la déréliction : « Samedi 2h. – Un empoisonnement de l’esprit, voilà ce que j’ai. Évidemment, sous la dépendance de l’empoisonnement physique, de l’intoxication intestinale. Le moindre rayon de lumière me blesse au plus tendre du cœur. Regrets désordonnés. Souvenir de bonheur. Cela me transperce. Je sens fondre ma résistance au mal ».Et la maladie s’hypostase en une troublante réalité duelle, où Gadenne s’étreint avec son chancre rongeur : « La maladie nous dédouble. En cela ses effets sont semblables à ceux du sommeil. Dans les deux états, c’est le fantôme qui domine. » Ce spectre ténébreux nasse le malade, et son cortège de haillon l’assaille de toute part — chute vertigineuse dans le gouffre de « l’esprit qu’on doit avoir dans la mort ». La nébuleuse de douleur que connaît habituellement Gadenne n’est pas d’un ordre temporel aux frontières tracées, où la délimitation entre l’enjouement vital et la déconvenue du corps serait clairement délimitée. Au contraire, le trouble se fait incessant et grimpe sous le tégument, il « se glisse au plus vif de l’esprit, [il] émousse l’âme ». Pour reprendre la métaphore du fardeau que Gadda utilisait, on retrouve dès le Carnet II cette intuition générale sur son joug, qu’il définit comme un « mal qui de jour en jour semble grandir, menacer ? ». Fonction canalisatrice et clairvoyante de la douleur qui ouvre les portes d’un couloir menant au gouffre : « Ce mot “illimité“ lu tout à l’heure dans le dictionnaire au mot qui définit mon cas, est terrible ». Resserrant continuellement sur l’objet engourdi avec la même prégnance qu’une tenace lierre étreindrait sur le bois éméché, la maladie se fait mâchoire grandissante qui engloutit la sève sacrée — le nœud de ce mal incorporé resserre son étau et les failles de lumière se fendent. La douleur — l’inexpugnable et tenace douleur qu’un corps de médecin pensait alors lui expurger se remembre en une réalité plus angoissante encore. Les moments de répit deviennent des osculations attentives, et le moindre frémissement d’un silence n’est plus perçu comme une convalescence en cours, mais devient l’objet d’une élaboration moralisante : sournoisement, la maladie suivrait le cours des marées et ses accalmies ne sont que des répits donnés par surcroît. La corruption des sensations s’accompagne concomitamment d’une égale accusation personnelle — la décomposition subie rehausse le sentiment moral de la culpabilité. Ce prisme vicié semble avoir totalement gangrené Gadenne dans le dernier Carnet : « J’ai deux organes blessés, l’un grièvement puisqu’on l’estime perdu. Mais cela n’est rien : tous mes maux sont moraux. »La souffrance se fait absolue, l’étiage de l’esprit poursuit sa route macabre. Toujours dans le derniers Carnets, Gadenne ne trouvera alors plus que Dieu comme interlocuteur idoine pour ses angoisses. Les prières et les espérances remplacent les froides constations des premiers Carnets : le désespoir se mue en une imploration — les genoux crissent sur le carrelage du sanatorium : « Mon Dieu non, je veux espérer, je crois que vous me tirerez de ce cauchemar. Je vous le demande humblement. Punissez-moi autrement, s’il est possible, je vous en supplie. »
La retraite miraculeuse
Le désespoir et son abîme duquel on ne revient pas indemne n’est pas toujours la seule réalité de Paul Gadenne. S’entremêlent, au sein de ces Carnets, dans un brouillard touffu, certains insulaires lumineux qui exhalent les fugaces fumerolles d’une rédemption possible. Dans une note datée du 24 décembre, soit le jour avenant de la possibilité d’une parousie, il écrit : « J’ai de plus en plus tendance à considérer la maladie comme une expérience d’un immense intérêt ». Reliant toujours le livre et la vie, Gadenne confronte sa douleur à ce qu’en exhument ses étoiles romanesques : « Il faudrait voir comment les romanciers interprètent le fait de la maladie, s’ils n’y voient pas (comme Proust) un moyen de connaissance particulier, un fait de nature supérieure qui n’est pas toujours exclusivement une tribulation mais aussi une exaltation. » Cette métaphysique arrachée avec pugnacité à la maladie — thème principal de son premier roman Siloé — Paul Gadenne la commente en ces termes souverainement autobiographiques dans À Propos du roman, « [elle] constitue une chambre d’expérience où va s’élaborer, sous des pressions inédites, sous des pressions encore inconnues, un nouvel homme ». Gadenne nous décrit alors une dimension inconnue de la tourmente qui alimenterait dans un holomouvement la tempête et son phare coruscant. Ainsi, la maladie en ce qu’elle porte « l’espoir d’une renaissance », comme il l’écrit dans le Carnet VII au cours d’une conversation avec un médecin, devient pour lui une catharsis et purge tremblements du corps et craintes de l’âme. À rebours de sa volonté d’anéantissement, la maladie ouvre ainsi une brèche dans l’architecture gangrenée qui ronge Paul Gadenne : il entrevoit la possibilité d’un nadir de l’esprit. Cette sonorité entrouverte n’a pas le vacarme tonitruant des révélations religieuses ou mystiques, elle poursuit une lente ascension depuis les grands fonds de l’endolorissement jusqu’à devenir une mélodie secondant Gadenne dans son désespoir latent. L’infusion souterraine de cette partition — proportionnellement lumineuse à mesure que ce mal démembre son corps — Paul Gadenne en rend compte dans une des premières notes de son Carnet final : « Renouvellement, rénovation, régénération qui s’opèrent à l’intérieur d’un être qui passe de la vie courante et active à la vie réduite et imposée par la maladie ». Cette régénération est manifeste dans une scène où Simon, le personnage principal et autobiographique de Siloé, en sortant de la salle d’attente du sanatorium, suggère que c’est bien au cœur des ténèbres que la possibilité d’une parousie serait la plus vivace : « Il savait que la matière épaisse dont la plupart des journées étaient faites, que cette torpeur malade, ce poids des gestes, cette succession d’heures vides, menaient à des paliers resplendissants, à ces clairières ensoleillées […] ».
Cette mystique longuement mûrie entre les oppressants murs décolorés et vitreux du sanatorium, nous pouvons en saisir l’indicible immensité dans une célèbre conférence que Gadenne donna au lycée de Gap en 1936 (Discours de Gap, repris dans Une Grandeur impossible). Dans ce plaidoyer en faveur du regard stationnaire de l’Homme contre sa gesticulation permanente, il cite la célèbre lettre que Dostoïevski envoya à son frère lors de sa réclusion au bagne : « Ce qu’il est advenu de mon âme et de mes croyances, de mon esprit et de mon corps durant ces quatre ans, je ne te le dirai pas, ce serait trop long. La constante méditation ne m’aura pas été inutile. J’ai maintenant des désirs, des espérances, qu’auparavant je ne prévoyais même pas. » La retraite au sanatorium aura eu chez Gadenne la même fonction révélatrice que le bannissement a eu chez Dostoïevski : dans le miroir de leurs souffrances intimement vécues, ils entraperçoivent le singulier reflet d’une vie véritable — formes stellaires d’épiphanie. Tous deux, c’est dans les dédales de la solitude qu’ils se feront frère de la souffrance et par là même sondeurs des plaies de l’homme, qui désormais est irrémédiablement nu face à la Douleur.
Henri Rosset
Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.
[1] « Tu laisseras tout ce que tu aimes le plus chèrement ; et c’est la flèche que l’arc de l’exil décoche pour commencer » (Dante, la Divine Comédie, Paradis, XVII)
[2] Juan Asensio, La longue patience de Paul Gadenne, article publié sur Zone Critique https://zone-critique.com/2017/05/18/paul-gadenne/
[3] Marien Defalvard, L’Architecture, Fayard (2021) p. 148-9