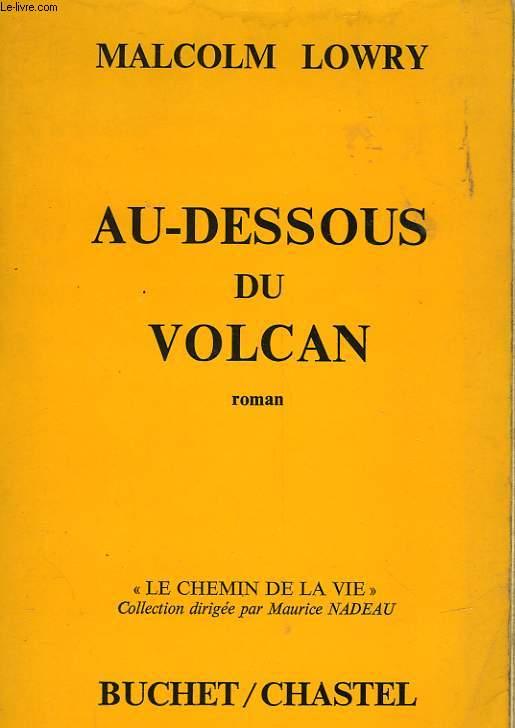Malcolm Lowry, né en 1909 à quelques encablures de Liverpool, est un romancier britannique dont l’œuvre centrale s’intitule Au-dessous du volcan. Publié en 1947 en Angleterre par l’éditeur Jonathan Cape, ce livre se définit comme la quête d’un Consul, qui plonge « toujours plus avant dans les ténèbres » à la recherche d’un paradis perdu. Décédé d’une overdose de somnifère en 1957 à l’âge de 47 ans, la vie et l’œuvre de Malcolm Lowry sont autant de répétitions du tragique récit d’« un homme non pas piégé, mais tué par son propre livre et les forces malignes qu’il soulève ».
« Il existe une étrange confrérie : celle des amis d’Au-dessous du volcan. On n’en connaît pas tous les membres et ceux-ci ne se connaissent pas tous entre eux. […] Utilisé par certains comme un sésame, le nom de Malcolm Lowry est pour d’autres un test qui partage facilement l’humanité en deux camps », écrivait alors Maurice Nadeau en ouverture de l’édition Folio du Volcan. Ainsi, les lecteurs d’Au-dessous du Volcan se rassemblent en une secte mexicaine, où le mescal tient le rôle de mot de passe. Dans cette confrérie, il se chuchote des noms étranges : la barranca, Farolito de parian, Popocatépetl, l’Ixtaccihuatl, Oaxaca — sans oublier le Consul, véritable double démoniaque qui seconde Lowry dans ses explorations. Ils parlent en termes de chapitres, de noms propres et mélangent les langues — ânonnant sans cesse dans un espagnol bancal, l’énigmatique formule qui encerclait le jardin du Consul : « ¿ LE GUSTA ESTE JARDÍN ?’ ‘¿ QUE ES SUYO ?’ ‘¡EVITE QUE SUS HIJOS LO DESTRUYAN ! » Par sa folie même, cette secte réalise ainsi le souhait secret de Malcolm Lowry, qui a « modestement espéré que sa première crainte, celle d’être suivi, contaminerait le lecteur pour le hanter. » (Merci infiniment)
Épousant le chant du Consul, véritable aède ivre d’Au-dessous du volcan qui redoutait « tout ce qui offrait des voies d’accès ou de sortie, dessinait des limites, donnait un sens ou un caractère, un but ou une identité à cet effroyable maudit cauchemar qu’il était obligé de porter partout sur ses épaules », l’œuvre de Lowry résiste à toutes les tentatives de concaténation simpliste. Car ses livres appartiennent à la race des livres monstrueux : ces œuvres dantesques qui s’enfoncent au plus proche de l’abîme, là où gît le « le monstre du romanesque » évoqué par José Bergamín.[1]
Au seuil de l’infini, dans les gouffres du monde
Lowry écrivait à Jonathan Cape qu’il y avait « mille écrivains capables de vous peindre des personnages à n’en plus finir, pour un seul qui soit capable de vous raconter quelque chose de neuf sur le feu infernal. ». Poète s’écharpant avec ses propres démons, Lowry capta mieux que quiconque la nuit de l’Homme — cette zone grise où la conscience se fait l’objet des « clavecins de la ténèbre ». À travers le Volcan, Lowry effectue alors ce que les anciens grecs nommaient une catabase : la descente volontaire d’un homme vivant dans le royaume des morts, afin d’y recueillir quelques noix d’or enfouies dans sa géographie infernale. Ce thème de la descente, de l’ascension inversée en direction d’un centre noir est omniprésent chez Lowry : il lui faut descendre, inlassablement et irrémédiablement « plus bas, plus bas, toujours plus bas, vers ce qui mène sous la conscience à l’extrémité meurtrière » (Le Voyage infini vers la Mer Blanche). Nous saisissons l’ampleur de cette catabase par la voix du Consul dans Au-dessous du volcan : « …Nuit : et une fois de plus, le corps à corps nocturne avec la mort, l’aube dont la froide beauté jonquille se redécouvre en la mort, la chambre trépidante d’orchestres démoniaques, les bribes de sommeil apeuré, les voix à la fenêtre dehors, mon nom répété sans cesse avec mépris par des groupes d’arrivants imaginaires, les clavecins de la ténèbre » ou encore dans le chapitre VII du Volcan, qui agit comme un véritable cœur des ténèbresqui engloutit le roman tout entier : « Précipités la tête la première vers l’Hadès, vers une bousculade de démons piquetés de flammes, de Méduses et de monstres vomissants, en plongeons abrupts ou avec de grotesques bonds en arrière, égoïstes et rougeauds, parmi les bouteilles en chute libre et des emblèmes d’espoirs déçus. »
L’écriture de Lowry arpente ainsi la paroi verticale des gouffres que laboura en son temps Baudelaire, notamment dans son poème Le voyage, dont les derniers vers sont une définition parfaite de la catabase évoquée précédemment :
« Verse-nous ton poison pour qu’il nous réconforte !
Nous voulons, tant ce feu nous brûle le cerveau,
Plonger au fond du gouffre, Enfer ou Ciel, qu’importe ?
Au fond de l’Inconnu pour trouver du nouveau ! »
Cette métaphore du gouffre, évoquée ici par Baudelaire, est à mille lieux de l’image de l’esthète roulant pour lui-même, qui se plairait à imaginer quelques tréfonds gothiques pour se complaire dans une exaltation surfaite de l’obscurité. Au contraire, chez Lowry comme chez Baudelaire, ce sont davantage les gouffres qui les appellent à eux que l’inverse. Loin d’être maladive, cette fascination se fait semblable « à ce mal qui, dit-on, s’empare des plongeurs de fond, incapables de résister à la tentation de descendre encore et encore jusqu’à ce qu’ils se noient. Volupté de l’abîme. » (Le feu du ciel vous suit à la trace, Monsieur !) Au-delà de cette alacrité, la fréquentation des sous-sols du monde — entendus comme les puits sans fonds où l’âme humaine s’éperdue à chercher ses propres fondations mythiques — n’est pas sans danger, comme le soulignait Nietzsche dans Par-delà bien et mal : « Celui qui combat des monstres doit prendre garde à ne pas devenir monstre lui-même. Et si tu regardes longtemps un abîme, l’abîme regarde aussi en toi » (§ 146).
Dans le Volcan, Lowry et le Consul — tels des soutiers prisonniers de leur barque délabrée sur les eaux rouges d’un Styx mexicain — fixent leur cap vers le Farolito de parian. Le Farolito est une simple cantina mais que le Consul rehausse à un stade symbolique supérieur : « c’était un endroit singulier, vraiment un endroit de la fin de la nuit et du début de l’aube ». À la fois lieu polaire en direction duquel le Consul étire ses déambulations, le Farolito est également le lieu de son exécution : incarnation violente de la dualité de l’abîme évoquée par Nietzsche — lieu de vérité et de sanction. Comme Orphée qui ne pouvait se retourner dans les Enfers, Lowry et le Consul sont ainsi engagés sur une voie fatale — irrévocable : « Comment, et avec quelle foi aveugle, retrouver sa route, se frayer son chemin en arrière, maintenant, à travers les tumultueuses horreurs de réveils qui se brisent, chacun plus effroyable que l’autre, à partir d’un lieu où même l’amour ne pouvait pénétrer, où il n’y avait pas de courage, hormis dans l’enfer le plus intense ? » La dimension tragique du Volcan s’incarne sauvagement à travers ce courage infernal du Consul ; devenu le prisonnier volontaire de cette cascade menant à l’abîme, il est irrémédiablement condamné. Et c’est d’ailleurs ce qui rend le Volcan si troublant : nous ne pouvons pas réellement nous identifier à la trajectoire enflammée du Consul. Il marche le long de son chemin de croix, au-dessus d’un gouffre que lui seul perçoit, à la recherche non pas d’une rédemption enfouie mais plutôt d’un sanctuaire du désespoir.
Le cri en provenance de l’Éden
« Mes secrets sont de la tombe et ils doivent être tus. C’est ainsi que je pense parfois à moi-même comme à un grand explorateur qui, ayant découvert un extraordinaire pays, n’en peut jamais revenir pour faire don au monde de son savoir : mais le nom de ce pays est enfer. Mais ce n’est pas au Mexique, bien sûr, mais dans le cœur », voici comment Lowry se décrivait dans Lunar Caustic. Évincé d’un Éden infernal qui paraît connu et qui n’est pourtant jamais décrit, Lowry comme ses personnages affleure ce monde perdu, sans jamais l’étreindre (dans La Traversée du Panama, le narrateur reste au large d’une côte inabordable et qui lui reste interdite : « Un sentiment d’exil m’oppresse… Un sentiment au-delà de l’injustice et de la misère… C’est de passer au large d’un lieu tel que celui-ci »). Pour saluer les traducteurs, et notamment Clarisse Francillon, membre éminent du premier cercle des lowriens en France, (avec Max-Pol Fouchet et le jeune Maurice Nadeau), citons ce qu’elle disait de l’œuvre de Lowry : « un de ses thèmes obsédants […] est celui du lieu privilégié, lieu à jamais inaccessible peut-être. » Ce lieu mythique — sorte de théâtre où la cruauté du monde serait absente, nous en saisissons l’envers déchu dans le Volcan à travers la métaphore du jardin.
Tel un jardin sous le jardin[2], le Volcan en lui-même en est un — broussailleux et chaotique où chaque page est une crevasse dans lequel le Consul ne cesse de sombrer. Le Mexique lui-même peut également se lire comme une allégorie d’un autre jardin, qui affleurerait sous le précédent pour venir siffler son chant enténébréde la « perte éternelle qui jamais ne dort du vieux Mexique » (Jardin d’Etla). Ce thème de l’irrémédiable chute abonde dans le Volcan, notamment par la reprise du mythe du Jardin édénique.
Jonglant avec l’ambiguïté de la traduction que fait le Consul du texte espagnol qui est sur la pancarte située aux abords d’un des jardins, Lowry rehausse une simple prévention au rang de commandement sacré : « ¿ LE GUSTA ESTE JARDÍN ?’ ‘¿ QUE ES SUYO ?’ ‘¡EVITE QUE SUS HIJOS LO DESTRUYAN ! » « Ce jardin vous plaît-il ? Il est le vôtre ! Empêchez vos enfants de le détruire » que le Consul remplace par « Nous expulsons ceux qui détruisent ». Homme de la « destruction » par excellence, le Consul ne pouvait éviter cette expulsion destinale du Jardin, comme du monde lui-même — tant le fardeau de sa propre damnation s’alourdit sans cesse au fil de sa déchéance.
Écrivant ainsi à rebours d’une recherche plus classique d’un lieu ultramarin, d’une idylle sacrée où tous les vins coulaient, il est manifeste chez Lowry que l’héritage baudelairien du corps à corps avec la Perte remplace l’attitude moderne qui se veut distante, voire ignorante de cette vérité symbolique. Toujours dans le Volcan, Lowry nous donne alors une inimitable interprétation du mythe du Jardin d’Éden : « Et si Adam n’avait pas du tout été chassé en réalité ? […] Et si son châtiment avait en réalité consisté […] à être forcé de continuer d’y vivre, seul, bien sûr — souffrant, inaperçu, coupé de Dieu… ». Le Consul s’identifie à cet Adam condamné à vivre dans un Jardin infernal qui se consumerait continuellement — seuls les cendres joncheraient alors sa propre terre, devenue stérile et vaine[3]. Désormais perclus et enfermé dans un univers où la fatalité du Mal tient lieu et place d’une liberté à conquérir, le Consul est alors en proie aux sifflements de la mort qui rôde : « à ce moment il eût pu jurer qu’une silhouette […] paraissant porter une sorte de deuil, s’était tenue debout, tête courbée dans l’angoisse la plus profonde… ». L’air que respire alors le Consul se « remplit de murmure » et on assiste à une extase sombre où l’entrée des Enfers s’incarne en une réelle présence : « C’était là les ultimes moments du retrait du cœur humain et l’entrée définitive du démoniaque ».
Baudelaire ne disait-il pas que « l’ivresse de l’Art est plus apte que toute autre à voiler les terreurs du gouffre » ? (Le Spleen de Paris). Il semble qu’Au-dessus du Volcan donne tort à cette affirmation : la sauvage et puissante houlequi remonte le long de la barranca ne connaît, et ne connaîtra jamais aucune domestication littéraire ou religieuse : sa terreur n’a pour égal que la grâce de l’Éden perdu.
La contemplation des gouffres
Dans le Volcan, la profonde tristesse qui anime le Consul n’a pour unique reflet que cette pénombre qui remonte sur les parois de la barranca, cette falaise mythique qui borde ses déambulations à Quauhnahuac. Désignée comme une « chute formidable », plus ou moins habitée par quelque « Prométhée de cloaque », la barranca est un gouffre béant où l’on jette les chiens crevés (et le Consul, à la fin du Volcan). À la manière d’une frontière infranchissable, la barranca agit comme un portail mystérieux dont seuls des murmures traversent son silence. Dans une des innombrables scènes d’enivrement total, le Consul subit la pleine démesure de ces sifflements qui en émanent : « Il ferma de nouveau les yeux […] il eut, l’espace d’une brève minute […] la vision terrible de la nuit qui l’attendait, […] , la vision de sa chambre trépidant d’orchestres démoniaques, de ses assoupissements brefs envahis par l’effrayante cacophonie, par l’irruption de voix ayant la réalité d’aboiements de chiens ou l’intervention de tiers imaginaires répétant litaniquement son nom plus toute une musique de cris vicieux, de cordes métalliques, de claques violentes, de martèlements, d’empoignades ayant l’insolence d’archidémons, d’avalanches défonçant sa porte d’aiguillonades sous son lit, des cris sempiternels, de sanglots, de ténébreux clavecins à la mélodie effrayante ».
Lowry et le Consul sont tout à fait conscients du danger situé en-dessous du Volcan, au fond de la barranca ; ils savent que « Ce n’était pas pour rien que les anciens avaient situé le Tartare sous l’Etna et dedans le monstrueux Typhée aux cent têtes et yeux et voix » — mais jamais la tentation qui émane de cet appel des gouffres ne faiblira pour les deux écorchés. Ce qui poussera Lowry à évoquer, au détour d’un dialogue entre Primrose et Sigbjörn dans Sombre comme la tombe où repose mon ami, une position médiante, voire mystique — qui fleurirait au plus noir de la nuit : « : « Profond, profond, profond. Profondeurs au-delà et encore au-delà des profondeurs. À nouveau, il se vit en train de contempler les gouffres ». Cette contemplation se matérialiserait ainsi comme une variante abyssale de l’Amor Fati antique : seul l’homme qui résisterait sans faillir au vertigede l’abîme accepterait son propre destin, dans sa pure vérité. Ce que Lowry écrit alors dans un de ses poèmes, La rivière asséchée de l’âme, qui tente de recouvrir l’incompressible culpabilité qu’il porta après le suicide de son ami Paul Fitte[4]. Sur l’autel de l’impossible pardon, la prose semi-chaotique de Lowry prendra alors une allure de prière :
« Et qu’il pleurera jusqu’à sa mort, sachant très bien
Que ne renaitra que celui qui subsiste dans l’obscurité. »
De l’obscurité surgit en lumière un masque de compassion
Les hantises et les démons qui harcellent Lowry se harponnent sur la même croix marine : l’échec, le passé et le remords. Pareil à un Lord Jimdont la faute ne serait jamais clairement explicitée, Lowry porte sur lui une forme opaque de culpabilité. Celle-ci s’apparenterait peut-être à cette offense faite à une donation stellaire de vie véritable à laquelle l’homme n’aurait plus accès pour le Consul dans le Volcan, ou encore l’esseulement de l’âme qui empêche la sublimation du monde dans Ultramarine (dont le bruit des cloches répétées rappelle et ravive cette plaie : « Tintement qui de toi ravive le souci — À mon triste moi me ramène »). Mais comme toujours chez Lowry, le phare appelle à lui la tempête et inversement. Notamment dans Éléphant et Colisée lorsque le héros rompt avec l’habituelle exaltation pour questionner cette perte : « Est-ce là l’épreuve de l’homme : rendre efficace sa contrition ? ». Ce souci de la scission entre l’homme et le divin donne à l’œuvre de Lowry une coloration plus profonde encore — son thème serait celui de la complainte endeuillée envers non seulement cette perte, mais également envers la détresse des hommes.
C’est à cette lecture que nous invite la fin d’Au-dessous du Volcan où, malgré la conduite désastreuse du Consul qui a consumé sa propre vie et celles des autres, le visage d’un simple mexicain entrouvre la possibilité d’une fraternité auseuil de la mort : « Il était seul. Où était passé tout le monde ? Ou n’y avait-il personne. Puis de l’obscurité surgit en lumière un visage, un masque de compassion. C’était le vieux joueur de violon, penché sur lui. « Compañero » commença-t-il. Et puis il ne fut plus là. ». Scansion rédemptrice plus visible encore dans son poème Fragment, où Lowry fait tinter les étoiles, vues ici comme les véritables miroirs de nos abîmes, avec l’impossible communion des hommes, ceux-ci étant prisonniers dans un corps à corps maudit qui les empêche de voir le Compañero écorché qui sied à côté d’eux :
« Les étoiles tels des fusils d’argent dans le vide
Ajustent leur visée sur leur objectif particulier.
Elles ne discriminent pas les catégories de notre douleur.
Nul monde ne se jettera à l’eau pour rechercher
Des pleurs que nous n’avons jamais vu couler
Une douleur jamais partagée,
Que ne puis-je réconforter les morts, étreindre les pierres dans les flots. »
Henri Rosset
Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.
[1] Phrase citée en exergue de la catégorie Monstres romanesques sur Stalker : « Le roman est un labyrinthe qui emprisonne le monstre du romanesque ». José Bergamín, L’importance du Démon et autres choses sans importance https://www.juanasensio.com/archive/2013/09/16/monstres-romanesques.html
[2] Reprise et répétition du titre de l’article de Juan Asensio publié dans Le temps des livres est passé : Sous le volcan de Malcolm Lowry : les livres sous le livre, le Livre sous les livres.
[3] Pour saluer T.S. Eliott et son somptueux poème La terre vaine, dans lequel ces vers sont autant de frères foudroyés dont l’application convient tout à fait à l’endroit du Volcan :
« Si ce n’est là, dessous ce rocher rouge
(Viens t’abriter à l’ombre de ce rocher rouge)
Et je te montrerai quelque chose qui n’est
Ni ton ombre au matin marchant derrière toi,
Ni ton ombre le soir surgie à ta rencontre ;
Je te montrerai la peur dans une poignée de poussière. »
[4] Cet évènement véritablement traumatique nécessite un éclairage : alors que Paul Fitte lui fit des avances qui ne pouvait être refuser, sinon celui-ci se « suiciderait », le jeune Malcolm Lowry lui aurait répondu, selon le premier récit qu’il donnera à sa première épouse, « Eh bien vas-y ». Le lendemain, Lowry et ses amis découvrirent alors le cadavre suicidé de Paul Fitte.