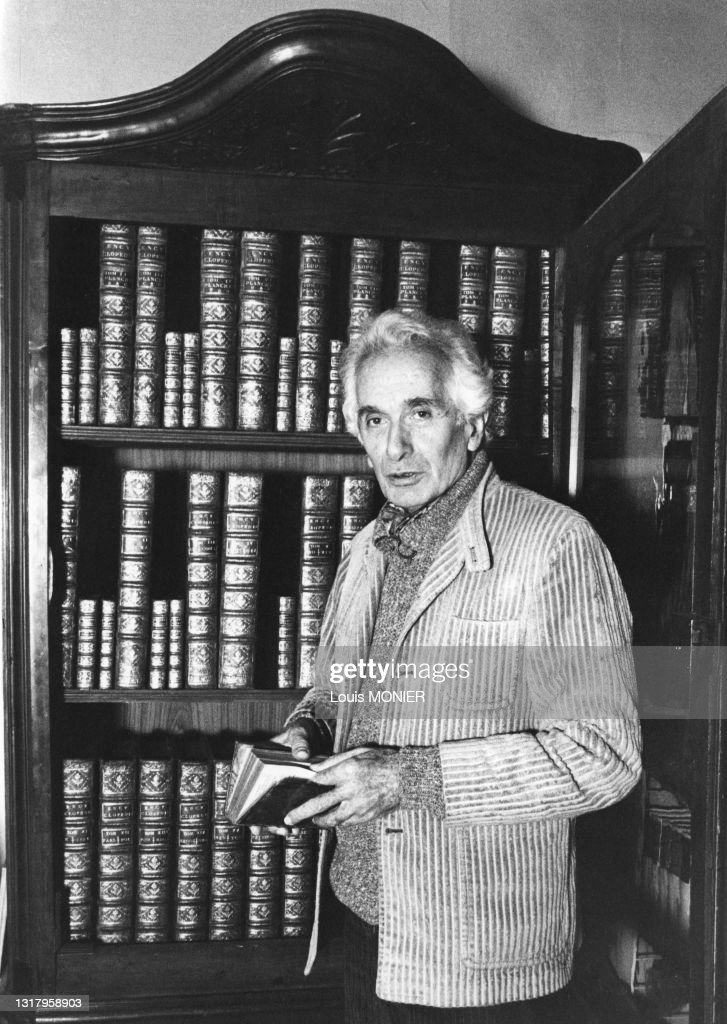Les Chemins de Katmandou, roman écrit par René Barjavel au lendemain de Mai 68, a ceci de remarquable qu’il donne à voir comment le rejet de la modernité peut, par-delà les réticences initiales, rassembler un nostalgique du monde paysan et des hippies férus de haschisch – comme si la post-modernité n’était qu’une autre manière de revenir au monde d’avant cette faute moderne que déplore le traditionaliste.
Le lecteur de Barjavel pourra regretter que, si plusieurs scènes apocalyptiques émaillent ce texte assez étrange, celui-ci n’atteint pas l’intensité de Ravage ; et que, si les évocations des monts et temples népalais ont parfois des reflets de paradis perdu, elles sont bien pâles une fois mises en regard des calmes édéniques qui peupleront L’Enchanteur. Il retrouvera cependant avec satisfaction la prescience du grand scrutateur de la civilisation moderne, qui se concentre dans ce roman non pas sur la technique comme dans ses autres récits d’anticipation, mais plutôt sur les « questions de société » – évoquant ainsi, dans ce livre paru en 1969, une jeune révoltée qui « [passe] la nuit avec un Noir, par conviction antiraciste », ou encore un couple lesbien qui, sans que l’on sache comment, est parvenu à avoir un enfant.
Ce regard sur l’évolution des mœurs en Occident se manifeste, dans la première partie du livre, par la négation de toute importance réelle aux événements de Mai 68. En premier lieu, Barjavel décrit comment la fameuse révolution sexuelle qu’aurait, selon le lieu commun, permise Mai 1968 l’avait, en réalité, précédée, notamment chez les classes bourgeoises dont les enfants érigèrent les barricades du Quartier Latin. Par ailleurs, il met en lumière l’échec de ceux qui – comme Olivier, le héros du livre, – loin de ne vouloir que jouir sans entrave, désiraient bien plutôt une révolution authentique mettant fin au monde consumériste né dans l’après-guerre : « Le monde de demain ne serait pas construit par eux. Ce serait un monde rationnel, nettoyé des sentiments vagues, des mysticismes et des idéologies. […] Dans un monde matériel, il faut être matérialiste ». Face à la victoire de ce consumérisme honni enfanté par la génération précédente, Olivier se réfugiera dans un cynisme qui tient moins de l’appétit dessillé d’un Rastignac que du ressentiment ; en effet, après la dissipation de ses illusions politiques, ce sont la recherche du père enfui et la réclamation de l’argent dû par ce dernier qui, désormais, l’animent. Elles le jettent alors sur les chemins de Katmandou, ville à proximité de laquelle son géniteur semble couler des jours paisibles d’organisateur de chasse au tigre pour milliardaires.
La tentation de l’Orient
Gravissant les montagnes népalaises, Olivier rencontre un trio représentatif du groupe qui sera au cœur de la seconde moitié du roman : les « voyageurs », ces Occidentaux cherchant dans l’Himalaya une issue à la modernité, et dont la description est sans doute l’aspect le plus intéressant des Chemins de Katmandou. S’ils convergent en ce lieu, c’est en raison d’un alliage, désormais familier, entre panthéisme et (extrême-)orientalisme, qui fait de l’Asie en général, et de Katmandou en particulier, le centre spirituel du monde ; et, s’ils recherchent cette spiritualité dont l’Orient serait le foyer, c’est en réaction à l’asséchante raison occidentale, associée aux interdits contre-nature. Ainsi, l’explication que donne Sven à Jane au début du roman, après un rapport mystico-charnel : « la société qui oblige et interdit est mauvaise. Elle rend l’homme malheureux, car l’homme est fait pour être libre, comme un oiseau dans la forêt […] Toutes les relations entre humains qui ne sont pas celles de l’amour sont mauvaises ». Enfin, il est une autre motivation tout sauf négligeable qui, aux yeux de Barjavel, découle du reste : « A Katmandou, on trouve le hachisch au marché, en vente libre, tout naturellement ».
Se séparant du trio pour rejoindre son père avant leur arrivée à Katmandou, Olivier découvre que ce dernier n’est guère qu’un grand enfant désargenté et vivant au jour le jour. Se retrouvant de nouveau face au vide qui le ronge, il décide de rejoindre Jane, avec laquelle il avait partagé une étreinte dont le mysticisme rappellera les divines amours de Merlin et Viviane dans l’Enchanteur, ou encore l’adieu cosmique d’Eléa et Païkan dans La Nuit des temps : et cette mystique de l’union érotique constitue un premier rapprochement entre Barjavel et les « voyageurs », a priori si opposés. Gagnant la capitale népalaise, Olivier découvre une ville de temples en pleine fête cosmique ; ces pages insistent sur la communion de tous les vivants, la religiosité omniprésente, et la place sacrée qu’occupe une sexualité exubérante, joyeuse et liée à la fertilité. Katmandou semble bien être ce que cherchaient Jane et ses camarades : l’antipode de l’Occident rationnel, froid et bardé d’interdits.
Là-bas
Mais la réalité des « voyageurs » vivant à Katmandou est avant tout celle de la déchéance à laquelle les a menés un mode de vie destructeur à base de sexe, de crasse et de drogues : « Elle était couchée sur le dos, à la limite de la vase, le visage de profil, une joue à plat sur le sol, ses cheveux emmêlés lui couvrant le visage, son blue-jean souillé de boue. Une truie enceinte la reniflait, lui ouvrit sa blouse d’un coup de groin, lui découvrant un sein ». Les descriptions de ce genre sont légion, et tout à fait dans la veine de ce que l’on attendrait de la part d’un nostalgique de la société traditionnelle comme Barjavel confronté à ces hippies presque caricaturaux, vautrés dans la drogue et la promiscuité.
Ainsi, lorsque Barjavel écrit : « Dieu était partout, et les ‘‘voyageurs’’ venus le chercher de si loin ne le trouvaient nulle part, parce qu’ils oubliaient de le chercher en eux-mêmes », l’on arrive à la tension la plus séminale du livre, à ce qui sépare l’auteur de ces « voyageurs » – ou, plus généralement, du mouvement hippie –, malgré leurs profonds points d’accord autour du rejet de la modernité occidentale, d’une même vision panreligieuse, ou encore d’une véritable mystique de l’amour.
Dans le cœur de son livre, Barjavel explique la raison pour laquelle les « voyageurs » ne peuvent accéder à cette liberté imprégnée de divin qui règne à Katmandou : « A leur naissance, le bandeau de la raison s’était posé sur leurs yeux avant même qu’ils fussent ouverts. Ils ne savaient plus voir ce qui était visible, ils ne savaient plus lire le nuage, plus entendre l’arbre, et ne parlaient que le langage raide des hommes enfermés entre eux dans les murs de l’explication et de la preuve ». Or, le tragique de leur existence est qu’ils ne peuvent s’empêcher de chercher ce qu’ils ne peuvent atteindre, « Car il y avait cependant une différence entre les garçons et les filles qui venaient de l’Occident vers Katmandou et leurs pères : les enfants s’étaient rendu compte que la raison et la logique de leurs parents les conduisaient à vivre et à s’entretuer de façon déraisonnable et illogique ». Alors, incapables de s’échapper, « Ils […] créaient par la drogue l’illusion d’une ouverture qu’ils franchissaient en rêve, dans le pourrissement de leur esprit et de leur corps, et ne parvenaient qu’à leur ruine ».
La possibilité d’une île, au lendemain du Déluge
L’on voit ici que Barjavel est en profonde sympathie avec la motivation initiale des « voyageurs », et ne leur reproche nullement leurs errements : ils ne sont pas responsables de leur incapacité à échapper à une modernité qui les a formatés. Aussi, seule une (double) apocalypse, pourra purifier Olivier : tout d’abord, après avoir dédié sa vie à sauver Jane envers et contre tout, il la verra mourir au cours d’une scène atroce. Il se souvient alors de Panah, un village indien qu’il avait refusé de secourir lors d’une mission humanitaire. Quittant Katmandou, il subit une mousson colossale – un Déluge – qui va jusqu’à lui arracher ses vêtements, dans un symbolisme un peu chargé ; mais il poursuit sa route, jusqu’aux derniers mots du livre : « dans l’épaisseur de la pluie qui emplissait l’espace entre le ciel et la terre, il se demandait s’il allait trouver au bout de la piste noyée, sur la colline qui émergeait encore, où quelques êtres vivants luttaient pour continuer de vivre, la réponse à la question qu’il avait posée à son père : – A quoi on sert ?… ». A son apocalypse personnelle répond ce Déluge, et tous deux rappelleront au lecteur de Ravage le cataclysme titanesque qui, dans ce roman, jette à bas la civilisation techno-industrielle atteinte dans les années 2050, et pousse les survivants au retour à une société agraire traditionnelle.
Une issue est donc possible hors de l’Occident rationnel : le retour à la vie ancestrale, simple et en communauté. Drogue à part, l’on est forcé de constater à nouveau la proximité de l’idéal de Barjavel et de celui des « voyageurs », tant il est évident que Barjavel, nostalgique de la société traditionnelle, se sentait bien plus proche de ces derniers que du bourgeois bon teint – ou même de l’ouvrier – occidental : car il fustige l’argent et le matérialisme, la société occidentale et ses interdits contre-nature, et révère une Vérité ancestrale et commune à l’humanité entière ; commune, du moins, jusqu’à cette Chute qu’a été la modernité, véritable suicide d’une humanité désormais en voie d’exclusion, par la faute de l’Occident, de l’innocence primordiale (1).
Il est d’ailleurs significatif que ce roman ne soit séparé que par trois années des Mots et les choses, où Michel Foucault, ce pape du post-modernisme fasciné par la pré-modernité, annonçait joyeusement la « mort de l’homme », définissant ce dernier comme une courte et nocive invention de la modernité européenne. Des décennies plus tard, la course à la datation et à l’identification du péché originel de la modernité fait encore rage, tant parmi les post-modernes revendiqués que dans les rangs des réactionnaires assumés : car tous communient dans l’idée que la modernité est une faute.
Jean Delumeau a montré dans le premier tome de son Histoire du Paradis comment la figure du Paradis perdu obsède l’Occident chrétien, et comment cette obsession est intrinsèquement liée à celle du péché originel qui en a chassé l’humanité (2) : dans cette optique, le prométhéisme moderne – dont les querelles entourant la définition et la datation précises rappellent les controverses théologiques au sujet de la datation du péché originel, et de la localisation du Paradis perdu – serait alors, pour Barjavel comme pour les « voyageurs » de Katmandou, pour les réactionnaires comme pour les post-modernes, l’origine du Mal, et le monde le précédant ce vers quoi il s’agit de revenir.
Face à ce péché qu’ils condamnent ensemble, ce qui, d’après Barjavel, sépare la mauvaise option – celle des « voyageurs » – de la bonne – la sienne – tient à ce que les « voyageurs » sont de purs enfants de la modernité, coupés du monde sain(t) originel : ils ignorent donc où chercher, et finissent échoués dans les paradis artificiels. Alors que Barjavel, petit-fils de paysans à la mémoire desquels il dédia Ravage sait – saurait – ce dont il est question : ce retour à l’enracinement dont parlait Simone Weil, dans une communauté ayant pour but non pas d’exploiter ou de conquérir, mais de subsister et de transmettre, de perdurer. Mais, surtout, à ses yeux, le mal est désormais si profond que seul un Déluge pourra libérer l’homme de sa faute : alors, une fois l’enfant de la modernité délivré par l’apocalypse, il pourra se poser la question qui le ramènera vers la communauté : « à quoi on sert ? ».
Or, aujourd’hui, force est de constater que, avec le versant libertaire de la collapsologie (3), l’idée d’un « effondrement » nécessaire pour briser la folie moderne et revenir à une vie d’« entraide » est désormais partagée par les descendants des « voyageurs » les plus radicaux et structurés : à croire qu’entre le patriarche et les hippies, il n’y avait que l’épaisseur d’une feuille à rouler.
(1) Barjavel décrit comment l’influence occidentale contamine les Népalais, notamment en leur apportant la médecine moderne, à laquelle recourent « surtout des hommes jeunes, plus aptes que les vieux à accepter les changements et qui, sous l’influence de l’Occident, commençaient à souffrir de la souffrance et à craindre la mort ».
(2) Jean Delumeau, Une Histoire du Paradis, t.1 : Le jardin des délices, Fayard, 1992.
(3) Nous pensons avant tout à Pablo Servigne, et à son Comment tout peut s’effondrer. Petit manuel de collapsologie à l’usage des générations présentes (coécrit avec Raphaël Stevens, Seuil, 2015) et son L’entraide, l’autre loi de la jungle (coécrit avec Gauthier Chapelle, Les Liens qui Libèrent, 2019).
Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.