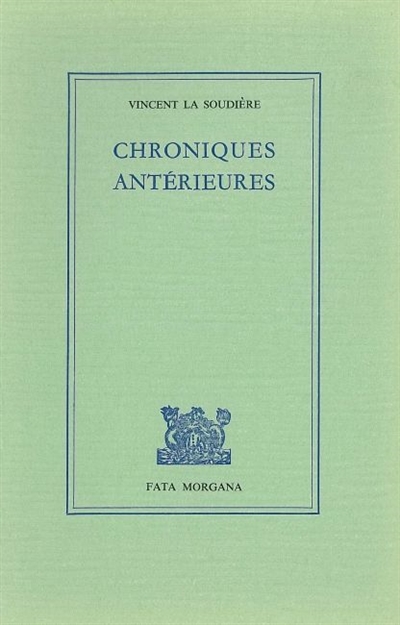Ami de Cioran et de Michaux, Vincent La Soudière (1939-1993) est un poète français qui n’a publié de son vivant qu’un mince opuscule intitulé Chroniques Antérieures (Fata Morgana, 1978). La publication en 2003 de Brisants, un recueil d’aphorismes, et depuis 2010 des trois volumes de son ample correspondance avec son ami Didier, seul intercesseur capable de l’entendre « entre ciel et terre —, dans la vallée de Josaphat où nul n’a de secrets pour personne », nous a fait découvrir un écrivain des extrêmes.
« À qui souffre l’extrême, l’extrême convient » : cette phrase d’Hölderlin que Vincent La Soudière aimait à citer contient en-elle même toute la rage innervée dont son œuvre est porteuse. Poète des confins, écrivain de « l’actualité des profondeurs », il ne ruissèlera pas dans les sillons rectilignes creusés par les esprits mesurés et solaires — qui arpentent davantage qu’ils ne dévalent les falaises de l’esprit. Au contraire, à l’instar des comprachicos rimbaldiens, il va s’attacher à cultiver ses verrues et entailler ses propres plaies pour entonner ses « psaumes de fer ». Trajectoire radicalement inverse de celle de Goethe, dont il loue sa démarche qui « se situe dans une sphère où [il n’a] jamais pu aborder : celle de l’accord de l’âme et du monde » (Lettres III).
Si certaines œuvres ont la linéarité pour principe régulateur — on songe à Proust dont La Recherche en serait la représentation anoblie — d’autres, à l’image de Nietzsche ou de La Soudière, cultivent les fulgurances qui embrasent le monde à défaut de l’envelopper. Ainsi, à rebours des publications patiemment élaborées, sous-pesées avec le soin et délicatesse de l’écrivain établi, l’œuvre de La Soudière fixe ses splendeurs dans le chaos même de son anti-publication : fragments et brisures irradiés seront puisées dans l’amas de carnets, de feuillets déchirés et de notes « polies » qu’il a longuement accumulés. Aphorismes et proses brisés deviendront chez lui autant de puissances d’écritures qui s’arracheront du marais actuel pour décocher la foudre de l’intempestif. Malheureusement assailli par « l’aboulie » qui le rongea, il n’aura jamais pu dépasser ce stade avorté du fragment ou de la note — comme une preuve supplémentaire de l’incandescence de ses paroles, que nul ne peut étreindre impunément. Tels qu’ils nous parviennent aujourd’hui, ses écrits nous apparaissent ainsi comme ce précieux témoignage d’un homme convulsant et torturé, impitoyablement claquemuré dans un « soupirail de l’Enfer »[1] (Juan Asensio) — ne se départissant jamais d’un regard « à travers les barreaux » pour entrevoir les traces d’une aube irradiante.
Écrire, l’épée dans les reins
Dans la première partie de la vie de La Soudière, que l’on pourrait clôturer par, d’un côté, sa naissance et, de l’autre, la publication de ses Chroniques antérieures, l’écriture a pour ambition la transvaluation alchimique de son être en voie de démolition. Dans le sillage romantique de Rilke, il tente d’apaiser ses tourments infernaux grâce à la furie d’écriture : « mes propres mots parfois se [répandent] sur les choses comme un vrai sacrement, transformant l’effrayante réalité en une terre d’absolue justice et harmonie » (Lettres I). Il poursuit alors la quête de la grande œuvre à venir — cette terrible et inhumaine création qui apposerait enfin une paraphe définitive sur ses écorchures. Il lui faut alors, à la suite de Mallarmé, créer son œuvre par élimination (« La destruction fut ma Béatrice ») et emmancher le glaive de justice qui fendra les relents du dérisoire pour ne garder que la nette coupe de l’éclat. « La vie n’est que souffrance et renoncements. La poésie aussi. Autant dire qu’elles s’abreuvent secrètement à une même source ; la source de l’incomplétude, de l’admirable et brisante incomplétude. » (Brisants)— démarche nébuleuse et voilée du poème qui ne se confondra pas chez La Soudière dans une célébration débonnaire[2]. Bien au contraire ses écrits décalqueront l’enroulement d’un tournesol furieux, s’ajournant à la face d’un soleil calciné qui projette les rayons d’une lumière certes, « mais vacillante, chlorotique, fuligineuse. Une lumière avare qui semble émaner d’une paroi rocheuse dans la nuit. Une lumière de gravier et de jointures : végétale et délétère — comme produite par les ténèbres mêmes. » (Eschaton[3])
Mais la seule gemme — aussi brillante et nettement découpée soit-elle — ne suffira pas pour ériger les pilastres d’une œuvre. Hermétiquement condamné en lui-même, prisonnier de son destin vicaire, La Soudière n’arrachera jamais la distance nécessaire pour transposer ses extrémités d’abîmes en une série d’ouvrages édifiée : « je ne vois pour moi aucune possibilité de composer une œuvre, c’est à dire de faire quelque chose qui se distingue de moi-même et de mon expérience » (Lettres I) Il demeurera le condamné « joint » à son trouble — perclus sous les mêmes latitudes où évolue le forçat à qui l’on ne donne aucune limite temporelle à sa détention. Enchaîné dans sa tourbe marécageuse, il sera toujours dans l’attente de cette lame mythique qui en arracherait les lumières hiératiques — « Il faut mûrir encore, avant de faire tomber la vraie parole brisante. Hache qui tranche le fruit. » (Lettres I)
Dans la revue NUNC consacrée à La Soudière, Pierre Monastier souligne avec justesse que malgré les franches ressemblances que l’on peut établir entre la prose calcinée de La Soudière et les illuminations infernales de Rimbaud, le premier reste un « écrivain de la convulsion [qui] semble inscrire sa prose dans cette subjectivité qu’exécrait Rimbaud. » Si Rimbaud, dans une célèbre lettre à Georges Izambard, abhorre la « poésie subjective [qui] sera toujours horriblement fadasse » en réaction face à la prose larmoyante des romantiques, le cas La Soudière est tout autre. Bien qu’adepte des confessions de sangs, celles-ci, par leurs effulgences même, conservent et dépassent la seule subjectivité — les projetant alors à des altitudes insoupçonnées du seul apitoiement romancé : « Toute mon ambition avait été (est encore) de transformer mes souffrances et mes terreurs en connaissances ou en poèmes, de tirer de leurs bouches torturées un enseignement supérieur, presque un pouvoir contre la mort. […] En toute famine gît une prophétie » (Journal, 1969).
Bloc de Basalte Noir
La fin du XIXe siècle nous a habitué à la position chancelante et franchement clocharde du « poète maudit » qui clame sa préférence : les guenilles et la liberté du pauvre plutôt que la veulerie bourgeoise. Chez La Soudière, cette pauvreté est équivoque : elle est à la fois l’objet de grandes plaintes mais sa franche abolition n’est jamais désirée, sous peine de tarir la source même de ses éclosions poétiques : « Il y a en moi un rebelle qui préférera toujours (en secret) sa besace et ses haillons et ses imprécations, aux lits moelleux et aux fauteuils de cuir. […] J’aurai toujours besoin, pour ma tâche, de plusieurs sombres venins, et la voix éraillé du malheur » (Carnet). Dès lors, il se retranchera hors du monde ; son exil sera celui d’un anachorète chancelant sur des ruines. À la suite de Rimbaud qui considérait que « nous ne sommes pas au monde » et que « la vraie vie est absente », La Soudière se perçoit et survit avant tout comme un résidu profane dont la place dans l’existence ne lui est pas acquise : il est « l’Éternel postulant » (Brisants). Ainsi, son daimôn, arqué et parabolique — tendu vers les cimes et balisé par les flammes blanches de sa solitude — puisera son inertie première dans ce profond sentiment de disjonction qu’il ressent. Le monde même finira par s’effriter sous ses haillons, pour ne lui laisser que des « chemins défoncés » sur lesquels il va continuellement traîner. Ses « vagabondage non portuaire » en France, en Espagne ou au Danemark seront autant de périples « zigzaguant[s] parmi les récifs du couchant » où il portera sa « carrure de sable pour guider son immobilité galopante » (Lettres I). À l’inverse du pèlerin qui chemine aux abords des grands fonds baptismaux, il va errer — sans jamais adosser son « Bloc de Basalte noir » à un quelconque granit stationnaire. « Le Destin a fait de moi une libellule agonisante sur un marécage ». (Brisants)
Dans un éclatant passage des Impardonnables, Cristina Campo noue une analogie entre le destin fait de « vides » d’un moine trappiste « qui avançait dans l’ombre » et la danse circulaire des derviches tourneurs, ces mystiques de l’Islam. Ceux-ci, au début de leurs danses, se défont de leur grand manteau noir, « figure du monde », pour mieux recueillir l’impulsion divine. Chez La Soudière comme chez ces disciples de l’Ordre Mevlevi, c’est bien ce même élan de scission intérieure d’avec le monde — ce même arrachement à la « masse gluante des boues originelles » — qui attisent leurs attraits pour cette étincelle mystique allumée depuis « les grandes patries immobiles » (Lettres I). Dans une des lettres qu’il adresse à son psychanalyste, il scellera cette fissure consacrée : « […] le monde et moi, nous formons un tandem depuis longtemps pulvérisé ». On pressent alors que sa relégation aux portes du monde n’est pas celle de l’artiste volontairement exilé qui se détacherait de ses semblables pour des raisons d’inspirations ou de muses lointaines. Prise dans sa dimension philosophique, ses ressacs torturés s’apparentent plutôt à une forme suraiguë d’un soliloque, sculpté dans le grès maudit de la suprême solitude — « Pas de liens, pas de relations, pas de participation… C’est l’Enfer de la Solitude Centrale. La Géhenne du corps et de l’âme » (Chroniques antérieures). Tout se passe comme si le poète cherchait, à travers son isolement, la renaissance de son être par l’élévation intérieure d’un cantique nouveau — immarcessible et crucifiant. Cette voix d’or, actionné par un levier d’Archimède ascétique, arriverait peut-être à resoulever ses derniers lambeaux de vie : « Me réengendrer par moi-même sans passer par aucun intermédiaire du dehors. […] Avec la salive de ma substance, j’ai tissé une toile autour de moi, pour m’isoler, pour refuser ». (Lettres II)
Gouffres antérieurs
Sa pénétration plus en avant des « garages mortels de l’âme » lui donnera les clefs arithmétiques d’un « étrange savoir » insoupçonné : « j’ai tout compris par dégradation et suppression et érosion » (Carnet). Cette ardente détérioration conduira La Soudière à effleurer les pures expressions du chaos pour surgir dans des zones inhumaines : son esprit va progressivement s’allitérer dans une romance apocalyptique et sa raison cognera contre sa propre inconséquence. Il deviendra « l’athée à l’état pur — l’athée du monde —, sans clef de voûte. État limite avant que s’éteigne la lanterne » (Chroniques antérieures). La lumière vacillante, c’est la noirceur primitive d’avant la Parole qui deviendra son imaginaire : commence alors la cartographie de « l’immonde ipséité » des Chroniques Antérieures.
Notion cardinale chez lui, « l’antériorité » désigne cette nuit atonale qui précède le clinamen originel d’où éclatera le monde — période fixée dans les lointains premiers âges, soustraite à l’inflexion viciée prise par l’Homme. Par des « processus effrayants de nettoyage métaphysique », s’initie alors sa descente dans la forge primitive, dans laquelle il outrepassera son propre patronage humain : « Ce n’est même plus mon identité en tant qu’homme qui m’a lâché, c’est beaucoup plus profond et terrible : la forme humaine est en train de m’échapper. Un grand vent désertique a passé sur moi, qui a disloqué en moi le point où l’homme s’articule à l’animal, où l’animal s’articule au minéral[…]. Les millénaires de culture n’ont pas profité à mon âme humaine » (Chroniques antérieures). En débouchant dans ce fond diffus « anté-humain », La Soudière (ou le narrateur brisé des Chroniques) sonde plus profondément encore ce paradoxe du « pèlerinage à reculons vers l’amont » qui enchevêtre sans cesse les cimes et leurs « gouffres étincelants » : « Le stable, le sûr, l’irrécusable, est le point obscur du recul où tout est parvenu — quelque crucifiant qu’il soit. Au bout de toutes les soustractions, il y a un reste qui résiste et perdure. Dans son effrayante humiliation, il est le un, peut-être l’aurore » (dernier paragraphe des Chroniques antérieures). L’infernale noria qui brisa La Soudière n’actionna donc pas ses pales dans le vide : ses dislocations antérieures se révèleront n’être que des prolégomènes en vue d’une découverte plus aveuglante encore : la révélation, en deçà du monde, du premier atome immaculé — la glaise enfin purifiée « prête à une certaine Refonte ».
Loin d’un dolorisme nihiliste, c’est bien en se « décréant » lui-même qu’il gravitera en orbite de Dieu — « son Chemin de Damas à l’envers » ne s’apparente pas à un puits sans fond, mais plutôt à un tunnel s’amincissant à mesure qu’il avance, ne pouvant plus que déboucher sur une ineffable Espérance : « Si Dieu n’est pas cette Force secrète qui germe au cœur de ma nuit, alors je n’ai plus d’existence ; alors je ne suis plus que poussière disparaissant dans le vide cosmique » (Brisants).
Un Pays d’où l’on ne revient pas : le Shéol
À la question « Pourquoi cette exclusive fréquentation de l’Enfer ? » posé par son Marc Wetzl, son seul « lecteur inconnu », La Soudière répondra par l’image mimétique de la souffrance du Christ : « Je sentais obscurément que l’image du suprême abandonné était comme le seul et le dernier miroir où je pouvais me regarder ». Cette comparaison qu’il étire entre le Christ et lui rayonne bien au-delà de la simple métaphore : elle est le fruit enténébré de son expérience vécue dans le Shéol, où il sera lacéré par « le grand poème de l’extase dévoyée — les clameurs ténébreuses de la Jérusalem d’En Bas » (Lettres III).
Cette « instase » sera intensifiée par le texte du théologien allemand Wilhelm Maas, Jusqu’où est descendu le Fils, publié dans la revue Communio en 1981, que La Soudière recueillera « comme du feu pour son œuvre ». Dans celui-ci, Maas définit le Shéol comme ce « Pays d’où l’on ne revient pas, où l’on est totalement séparé des vivants et oublié de Dieu, où règnent le mutisme et l’obscurité, bref la solitude et l’abandon, telles sont les caractéristiques du shéol. Il signifie le règne souverain de ce qui est négatif, le triomphe des puissances du chaos sur la vie et l’ordre (kosmos). L’état de mort et le shéol constituent la somme de tout mal, la négation de tout ce qui est bon, désirable ». Comme le narthex qui sacralise l’entrée d’une église, le texte de Maas va baptiser les souffrances du poète dans les eaux claires d’une communion viatique : « À présent j’exulte de me savoir embarqué dans la descente au shéol avec le Christ ». À la source de cette braise immaculée qui germe dans « l’obscurcissement final », il y a cette grande consolation que « le Christ est descendu plus bas dans les Enfers que toute créature […]. Il me précède de loin dans les lieux infernaux, dans ces extrémités d’abandon et de ténèbres où moi, pauvre créature, je n’atteindrai pas » (Lettres III). Dans la syntaxe théologique héritée d’Hans Urs von Balthazar, reprise par Maas, le Christ, par l’absolue rupture d’avec le Père qu’il a vécue, n’est pas seulement descendu au Shéol : il a fixé l’ultime limes jusqu’où l’homme peut se décréer[4] lui-même. Selon Sylvia Massias, La Soudière interprète son « « expérience de la descente et de la soustraction perpétuelle » comme une kénose qui lui permet d’être identifié au Christ, agrégé, par conséquent, à une humanité en voie de résurrection[5] ». Paradoxalement, il trouvera alors dans cette communion shéolienne avec le Christ une justification à son attraction pour « l’indescriptible chaos de l’avant et de l’après ». Désormais exhaussés, ses anéantissements successifs se dévoileront à lui comme recevables — voire, sous l’influence de certains méridiens pourpres qu’il pratiquait — comme aristocratiques.
Culminant dans les corolles des plus altières pensées, La Soudière se réfère souvent à un commandement professé depuis Éphèse par Héraclite : « Si tu n’as pas désespéré de tout, tu ne rencontreras pas l’Inespéré ». Par cette phrase, nous touchons à ce qu’il conviendrait de nommer la singularité scellée de La Soudière — entendue comme l’horizon de sa pensée, au-delà duquel notre compréhension ne peut qu’aboutir à un silence. Mutique et insondable, cette occlusion nous résiste par son ordonnance intérieure, qui veut que ce ne soit bien qu’au terme de ses infernales noyades dans les « eaux de la seconde mort » que le divin rayon de la Foi pourra perforer l’hermétique cachot où il s’est emmuré. Se trouvant ainsi en exact contrepoint d’une eschatologie plus commune, voulant que le Bien s’étoile sur celui qui accumule les vertus et non sur celui qui s’attèle à un long et déraisonné démantèlement intérieur. Dès lors, son tropisme passif et aboulique n’est plus une tare, il devient le materia prima nécessaire à l’avènement de cette « percée ouranique ». On décèle alors chez lui l’émanation d’un esprit attentiste et espérant — guettant au fil de ses affaissements successifs l’ouverture épiphanique de la « dernière porte » où il connaîtra « la cécité par excès de lumière ». C’est du moins ce qu’il évoque, dans un élan auroral et nietzschéen, lorsqu’il écrit qu’il n’est « descendu aussi bas que pour remonter vers quelque étoile dansante » (Brisants) — ou encore dans ce précepte scandé depuis la plus haute tour : « Il faut aller jusqu’à la perte irréparable, le désastre irréversible, le long baiser des Parques — la fausse-couche lunaire —, avant d’accéder tout entier à sa propre naissance » (Brisants).
Peut-être est-ce dans cet inflexible approfondissement de l’être dans son propre abîme — jusqu’à atteindre l’anéantissement absolu — que se trouve concentrée cette intime lueur d’abîme que nous lèguent la pensée et la vie de La Soudière. Approfondissement dont cette simple phrase adamantine en expose toute la grâce, aussi enténébrée soit-elle : « Car c’est à la nuit de briser la nuit. Et de cette estocade naîtra une blanche échelle de corde pour surmonter la terreur » (Lettres I).
[1] Juan Asensio, In memoriam Francis Bacon, ou le soupirail de l’Enfer où s’enferma Vincent La Soudière, Revue NUNC, Éditions de Corelvour, Numéro 41 (février 2017)
[2] « Il faut une grande faim inapaisée, un grand abîme d’où l’on ne remonte pas, des grandes plages d’angoisse et de désespérance, pour écrire un vers, une ligne, une phrase.
Tout ce qui est béance tenace et douloureuse est valeur dans le monde de l’écriture. Peut-on imaginer un saint Augustin débonnaire sans crampe à l’estomac ? » (Brisants)
[3] Eschaton, Ici finit le règne de l’homme est un ouvrage publié en novembre 2022, aux éditions La Coopérative. Nous pouvons en lire certains extraits dans la revue NUNC consacrée à La Soudière. (P. 67-68)
[4] Rolf Kuhn, La Décréation. Annotations sur un néologisme philosophique, religieux et littéraire, Revue d’Histoire et de Philosophie religieuses, (Année 1985)
[5] Sylvia Massias, Vincent La Soudière, la passion de l’abîme, Les éditions du Cerf, 2015, (P. 369)
Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.