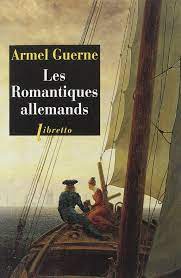Armel Guerne (1911-1980) est un poète et traducteur de langue française. Ami de Mounir Hafez, Georges Bernanos et Emil Cioran, il est l’auteur de nombreuses traductions dont celles de Kawabata, Hölderlin, Novalis, Woolf, Le Livre des Mille et Une Nuits et Moby Dick, pour ne citer que les plus célèbres. La renommée de son travail de traducteur à quelque peu voilé son immense œuvre poétique. Pourtant, et selon son propre aveu, il n’aura eu nulle autre ambition « que celle d’être accueilli et reçu comme un poète, de pouvoir me compter un jour au nombre saint de ces divins voyous de l’amour. »
Dans le bloc d’une modernité indigente, dominée par le « cumul absurde et monstrueux des choses sans âmes », Armel Guerne aura su en arracher une brèche irrédente — une percée à « contre-monde » pour sonner le tocsin de l’Absolu. Depuis sa première flèche décochée jusqu’à son ultime salve, son œuvre ne dévia jamais ses ramures : toutes étaient charnellement orientées en direction d’un astre poétique — unique annonciateur d’une « vérité qui dure, qui commence au ras de la terre et qui va jusqu’au ciel, et qui reste ». Et comme une falaise porte en elle son autre versant, son œuvre de traducteur et de poète s’enracinent en un même Val de Tempé mythique — cette terre des romantiques allemands, sur laquelle ils apposèrent silencieusement le « sceau même de l’éternité » sur la poésie.
Des écrits critiques d’Armel Guerne (colligés dans Le Verbe nu et L’Ame insurgée), scandés à l’orée des constellations intérieures, l’on pourrait dire ce que Bettina Von Arnim disait de la poésie d’Hölderlin : ils sont « dans l’éternelle fermentation de la poésie agissante. ». Sans jamais se nourrir à d’un quelconque « goût du jour » — dont la constante frénésie n’est qu’une preuve de sa paralysie latente — Armel Guerne veilla solitairement sur un rameau de parole, dont il revient à chaque génération de le raviver en une « grâce de charité vivante » (Lettres Dom Claude). À l’instar du guetteur du Pyrée, cette crypte où les prêtres mazdéens entretenaient un feu sacré à vocation millénaire, Armel Guerne loua et préserva cet héritage des « oraisons incessantes » — rétablissant alors la précellence du poème, ce « fût d’airain de toutes les paroles, cet axe autour duquel gravitent tous les mondes et tournent tous les âges […] » (La Nuit veille).
En fidélité à ce décret stellaire, on retrouve ainsi en chacun des poèmes d’Armel Guerne le reflet destinal du « Silentiaire infini » (Journal), qui donna à sa poésie un caractère vespéral et définitif — à l’image du ciel incendié qui culminait au-dessus de Tourtrès, où Guerne siégeait avec son moulin, comme un veilleur sur une Acropole inaltérable. C’est depuis ce « moulin de miracles », enraciné dans « le minéral du vent et des temps oubliés » qu’Armel Guerne écrivit ses plus grands textes poétiques, dont Les Jours de l’Apocalypse, Le Jardin colérique ou la Rhapsodie des fins dernières.
Malgré l’accablante confidentialité dans laquelle son œuvre reste emmurée[1], Armel Guerne demeure une sentinelle dans notre nuit, qui nous rappelle l’impérieuse nécessité de la poésie, cette « Fringale du Saint-Esprit » qui ne rend jamais ses armes à aucun monde, et ne donne ses yeux qu’à l’attente d’une Parole — sans jamais décolorer son « Aile pourpre » (Jean de La Croix).
La modernité ou le verbe sans âme
Si les poètes sont immuables et qu’eux seuls « fondent ce qui demeure » comme le disait Hölderlin, la conservation de leurs souffles semble pourtant mise en péril par le pandémonium moderne, qui ne cesse de réduire la portée de leurs insolentes brisures. Guerne adressa notamment de violents anathèmes à la prolifique logorrhée critique qui, à rebours de sa mission initiale de « passeuse », se contente désormais de palabrer béatement, en montant et démontant les grands textes sur une trame machinale et inerte. En cette nécropole du verbe, érigée par ces marchands de contrebande, nous ne trouvons « Rien de vrai. Rien de vivant. Rien de vécu. De la mort mise en tomes. De la mort. Facile à reconnaître : elle ne peut se taire, puisqu’elle n’existe que dans son bavardage » (Le Verbe nu). En spatulant ainsi son plâtre d’arguties, cette « littérature nécrophile des professeurs, docteurs, commentateurs, exégètes, analystes, biographes, historiographes, anecdotistes, nomenclateurs […] » prouvent d’un même geste qu’elle ne demeure pas dans le poème : sa docte objectivité ne serait donc qu’un épouvantail, auquel elle adosserait son désarmement — sa fuite devant une Parole souveraine. Selon Guerne, ce reniement est l’aiguillon même de cette modernité pantomime, qui, par crainte ou par lâcheté, gesticule sans cesse sur ses propres décombres : « Car il y a une pensée moderne […] revêtue d’une langue barbare ou loufoque, prise dans un corset, une pensée sans souffle ; son cercle s’est réduit aux dimensions d’un cirque minuscule […], sans jamais risquer un regard au dehors » (Le Verbe nu). Dès lors, il nous faut envisager, à la suite de Guerne, que ce tropisme au démantèlement des poètes ne soit qu’une énième modalité du « Moloch technique » démystifié par Bernanos — ce spectre de cendres orphelines, qui oublie volontairement à mesure que sa corruption du monde avance, les ferments vitaux qui l’a fait naître.
Asséchée et brutalisée, l’âme moderne — dont chacune des arêtes semblent vouées à l’osculation comptable du monde — ne saurait donc se mesurer à cette vérité sibylline et fuyante déposée par la poésie. C’est contre ce déchiffrement assis que Guerne cristallisera son roc d’insurgé : sa colère n’aura d’autre visée que la lutte contre tous ces verrous débilitants — resserrés chaque jour par la démence moderne, « dont la caractéristique est de ne penser jamais, mais de tourner en rond, de plus en plus vite, dans la sciure et le crottin de l’époque, avec les autres fonctionnaires, sans jamais risquer un regard au dehors » (Le Verbe nu).
C’est donc à contre-ruine qu’Armel Guerne nous révèle l’aurore d’une Vox Cordis intérieure, celle de la poésie — puisqu’elle est « le seul langage encore assez vivant, encore assez armé, encore assez puissant et entier, assez près du mystère aussi de la parole, pour emporter d’assaut les forteresses de l’inertie et crever le béton du mensonge, portant en elle un grain de vérité humaine qui peut germer encore, une semence de beauté qui fleurira dans la hideur » (L’âme insurgée).
« Tout vrai langage est silence »
En réponse à cette langue verrouillée, cadenassée dans sa propre corrosion, Armel Guerne nous enjoint à scruter le foyer incandescent de la poésie, où ne crépite plus que le « silence » — ce pneuma d’un souffle invaincu qui murmure son « Inavouable absence impossible à saisir » (Le Jardin colérique). Cette absence — inavouable car impardonnable — n’est pas ce mutisme rentré qu’une certaine poésie obscure pour elle-même revendiqua dans une gloire autosuffisante. Au contraire, chez Guerne, le silence est une larme immémoriale à sauvegarder, un Palladium mythique qui assure au monde la perduration d’un insulaire de liberté : « Le silence n’est pas ce qu’on croit, une extinction, une immobilité, un non refermé dans un oui grand ouvert. Le silence est un mouvement qui se contient soi-même, d’une puissance et d’une intensité telle, que bouger à côté devient une caricature grotesque, un stupéfiant simulacre. Le mouvement du mouvement, la source universelle. […] La main de toutes les caresses, de toutes les douleurs, en-deçà du mal et du bien, de tous les actes » (Fragments).
Pour se rendre disponible à cette grammaire poétique, il faut envisager que la poésie abrite en son centre déchiré un baptistère du silence, où se maintiendrait impérialement l’index d’Angerona, cette déesse antique dont le doigt apposé sur les lèvres — symbole d’un silence ordonné — est une insolence opposée à tous les bruits du monde, fussent-ils les plus doucereux. Et c’est depuis cet archipel préservé — où se croisent l’éternel et le temporel — qu’Armel Guerne composa son alphabet adamique, où culmine en son sommet « l’unique voix humaine qui se tient derrière les paroles et qui retentit, mystérieusement, chaque fois que l’homme touche à lui-même […] Tantôt ouverte sur la nuit pesante et se répercutant au fond des abîmes, tantôt déchirée de surnaturelles lueurs, cette authentique voix de l’homme, qui réapparaît brusquement aux heures capitales, transperce et disperse ses langages » (L’Ame insurgée). Pour Guerne, peut-être davantage encore qu’un cœur inapparent ou qu’un axe fondateur, le silence est la force même du poète — du reste, la seule qu’il possède véritablement.[2]
Et pour relier la corolle des diamantaires qui ont serti la poésie d’une aura de silence, il convient de citer Max Picard et son Monde du silence, dans lequel il écrit que « La poésie vient du silence et à la nostalgie du silence ». Cet écho sans retour agit ainsi à la manière d’un crible liturgique, par lequel le poète tamise les reliques d’une parole qui précède[3] la création, pour recueillir le dépôt d’une clarté nouvelle — ouverte dans l’immobile. C’est ce qu’évoque le poème de Guerne Le Poids vivant de la parole, dans lequel il trempe plus profondément encore sa lame hiératique dans les puissances « amassées »[4] du silence :
« On peut écrire, et l’on écrit ;
On peut se taire, et l’on se tait.
Mais pour savoir que le silence
Est la grande et unique clef,
Il faut percer tous les symboles.
Dévorer les images, Écouter pour ne pas entendre,
Subir jusqu’à la mort
Comme un écrasement
Le poids vivant de la parole. »
Il en va donc de la poésie comme d’une ascèse : une constante et héroïque « mine de volonté » qui s’arme en une colonne de silence. En ces deux noblesses secrètes, il se murmure une même langue d’oracle : une éveilleuse de l’Esprit qui va « chercher derrière le bruit ; qui le cueille et qui le recueille pour tous ceux qui s’en sont exilés. » Dans une telle alchimie poétique, nulle place donc pour l’agrément ou l’ornement : chaque mot, aussi simple soit-il, est scandé à sa « saveur maxima »[5] — cristallisant ainsi cette concrétion du poème en une perle secrète, qui témoigne devant son poids vivant : « La muette méditation du plus silencieux des moines est, en ce sens, une écoute du verbe jusqu’au plus fin de l’ineffable. Presque la perfection » (Fragments).
L’abîme du Temps
Pour Guerne, bien plus donc qu’un simple agrégat de mots captieux et éparpillés, le poème est une tension — déchirée aux deux pointes de l’infini, entre le Verbe antérieur et les mots qui le cherchent. Cette césure d’abîme, aussi violente qu’un « orage muet », n’est pas sans nous rappeler la célèbre lettre du poète américain William Carlos Williams, où celui-ci, après avoir écrit que « La vie est surtout subversion de la vie », nous indique qu’il en va de même pour le poème : « Et dans le vers, pour qu’il soit vivant, quelque chose doit être infusé qui ait la couleur même de l’instable, quelque chose qui ait la nature d’une révolution impalpable ». Chez Guerne, il en va d’une même persévérance du poème en un conatus stellaire, d’une même lumière s’accentuant en une force coruscante — toutes ces puissances ardentes concordent à cette « oxydation de l’infini, de l’éternité ou des choses » portée par la poésie.
Décelant alors une « source de tous les feux », le poète en attiserait les reliquats mythiques jusqu’à embraser sa propre parole en un tison ardent — pour pouvoir accueillir « le dépôt d’une vérité » qui n’est pas la sienne. C’est ce remembrement foudroyant qu’enserre le poème Soudain, en éperonnant plus profondément encore cette « victoire renouvelée de la vie sur la mort »[6] dont le poème ne serait qu’un météore :
« Des mots, rien que de les poser
L’un à côté de l’autre,
Qui disent plus et vont plus loin
Que nous n’allons ; des mots
Soudain qui ne sont plus les nôtres
Et qui se tiennent tellement
Près d’une vérité suprême.
Des mots qui cessent d’être dits
Pour mieux venir, soudain, redevenir.
Des paroles de la parole. » (Le Poids vivant de la parole)
Et si « L’arche du monde est sur les eaux du temps » comme l’écrit Guerne dans ses Jours de l’Apocalypse, c’est bien parce qu’il incombe au seul poète de remonter les tubulaires corridors du temps — eux-mêmes reliés au « pilier de l’Éternité » — pour faire tinter la cloche de l’inaltérable. Écartelé entre ces deux pôles temporels, le sien et celui de la parole, le poète condense un « ouragan au-dessus des déserts » et brise le corset anthropique par un rai de foudre — tel le « sang intérieur et son mystère irrévélé, jusqu’alors contenu dans la nuit du corps » (La Nuit veille). Car, à rebours d’un taxinomie moderne, qui réclame au poète une trépignante inventivité tournée vers l’artifice ou l’imagination, Guerne nous enseigne que la « voyance » du poète est avant tout une inclinaison de l’âme envers elle-même — une souveraine attente du Poids vivant de la parole : « Le vrai mystère de toute poésie, c’est que le poète est en nous ; l’autre, celui qui parle, ne parle pas ; ce n’est pas vrai : ce n’est pas lui, mais la Parole ». Ainsi, c’est par un auguste geste d’allégeance que le poète se fait Sphinx, en se mettant au diapason d’une souveraineté antérieure — ne pouvant ainsi plus que « donner sa voix — fût-elle à bout de souffle — à la voix qui appelle » (Au bout du temps).
Et c’est dans cette amorce d’une parole retrouvée que nous décelons la souche première de la pensée de Guerne — le point vital d’où toutes ses frondaisons se ramifient. Elle s’appuie sur l’intuition que la poésie ne doit pas « seconder le monde » comme le disait Kafka à propos du roman, mais qu’elle aspire à se faire miroir de l’Apocalypse, prise dans son sens premier de « révélation » et de « dévoilement » : « Nous avons dépassé le seuil de l’Apocalypse et, à mon avis, on se trompe lorsque l’on veut regarder ou lire l’Apocalypse comme une prophétie ; en réalité on devrait la lire et la comprendre comme une histoire vécue, déjà passée en partie, et au fond de laquelle nous sommes charnellement engagés. C’est ce qui se passe tous les jours. Elle est plus qu’à nos portes, elle est entrée dans notre vie, nous sommes en train de la vivre, absolument » . Ce fond apocalyptique engendre une profonde césure dans sa pensée poétique : il appelle à lui une conversion, qui porte la parole sur l’impérieuse voie de la nécessité. Comme si, par la déchirure qu’elle imposerait, l’Apocalypse pouvait définitivement briser les étoffes viciées du bavardage, afin que la poésie retrouve son innocence d’aérolithe. C’est à cette étoile brisante qu’Armel Guerne espérait raccrocher la poésie, comme le montre une de ses confessions, écrite au battement d’un abîme révélé : « J’ai sur la poésie, d’ambitieuses et claires idées qui la mettent un peu plus haut que la chansonnette : je veux dire, aujourd’hui, vigile de la fin temps » (Lettre à son éditeur).
Les paumes ouvertes
« Sur un vaisseau qui fait naufrage, la panique vient de ce que tous les gens, et surtout les marins, ne parlent obstinément que la langue des navigations ; et nul ne parle la langue des naufrages ». Cette langue de l’effondrement panique, seuls les prophètes et les poètes en connaissent l’usage selon Guerne. Dans un univers désaxé, où dissolution et ensablement semblent être les seuls champs d’avenir, ces deux passeurs d’absolu relèvent les égarés par leurs seuls regards « tournés du bon côté ». C’est un des multiples sens possibles que nous pourrions donner à l’Apocalypse évoqué par Guerne : au-delà d’un état matériel du monde, elle serait une accentuation intérieure par laquelle le poète n’écrirait plus pour lui-même, ni pour les autres, mais face à la fin des temps. Hurlant ainsi sa Rhapsodie des fins dernières sous le porche de l’agonie du monde, ses vers se consumeraient en une détonation irrévocable, qui tremblerait à intensité égale avec toutes les « révélations » — « Pour le poète, l’univers est un drame incandescent. Sa tragédie éclaire » (Fragments).
Guerne nous initierait alors à une bénédiction par le désert — entendue comme le dessèchement volontaire du poète où l’attente et l’attention deviennent ses seules prières, ses seules sources consolantes. Dans ces latitudes-là — creusées dans un insondable abîme qui convoque tous les gouffres de silence et de nuit — la liberté du poète est étrillée par la puissance même de la parole : « La parole parle ; et je l’écoute parler. Elle chante ; et je l’écoute chanter. Elle commande ; et je l’écoute obéir et je la vois obéir. Voici l’École du Voyant ». Et c’est depuis ces soupiraux spéculaires, qui réfléchissent plus profondément encore la lumière reçue, que le poète abandonne ses basses manœuvres pour recevoir la brisure d’un verbe supérieur : « L’écriture n’est qu’une écorce dont on fait une coupe divine ; reste Celui qui la remplit et celui qui a soif et qui la prend pour boire. Suppliant devant l’un et mendiant devant l’autre, le poète est entre les deux » (Rhapsodie des fins dernières). C’est cette arrachée hiératique dont chaque poème est le témoin palpitant qui rend la pensée poétique de Guerne si nécessaire. Elle nous rappelle que par-delà la dislocation du poète, entre supplications et foudroiements, c’est la simple parole portée par la poésie qui nous lègue un cristal effulgent — « Le poète n’a fait que de s’ouvrir le sang, source de parole » (Le Verbe nu).
Il incombe au seul poète de maintenir cette paume ouverte du mendiant — dont les phalanges meurtries ne sont que le reflet pulvérisé de sa propre charité — pour cueillir cette larme immémorée de la parole. Tel un annonciateur, le poète remembre alors cet aiguail mythique en l’apposant sur toutes les ruines du monde — et porte devant un Axis Mundi nouveau, comme un Atlas armé du glaive de l’Archange : « Tous vous tendent leurs pièges, savants, politiciens, banquiers ; les pièges où eux-mêmes sont pris. Le poète vous tend sa bouée, et s’il le peut, sa main ». (Préface de sa traduction des Disciples à Saïs, Hymnes à la nuit, Chants religieux de Novalis.)
[1] Il convient néanmoins de signaler que l’œuvre d’Armel Guerne a été l’objet de plusieurs études, publiés sur Stalker (https://www.juanasensio.com/tag/armel+guerne) mais également sur le site de La fFondation Armel Guerne (https://www.armelguerne.eu)
[2] « Que la poésie la plus sublime ne soit vraiment, en définitive, que l’apprentissage du silence » (Le Verbe nu).
[3] Max Picard écrivit à propos d’Hölderlin que ses mots « semblent venir d’un espace qui existait avant la création » (Le Monde du silence).
[4] « … Le plus difficile est encore d’amasser les silences, tous les silences des sortes les plus diverses, et de les rapporter intacts, un à un, par dizaines, par milliers, les plus petites et les grands, de les recueillir soigneusement au passage et de les rapporter délicatement chez soi. Sans les briser ; sans les ternir ; sans les froisser. » (La nuit veille)
[5]Cristina Campo, Les Impardonnables
[6]William Carlos Williams, Le Printemps et le Reste
Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.