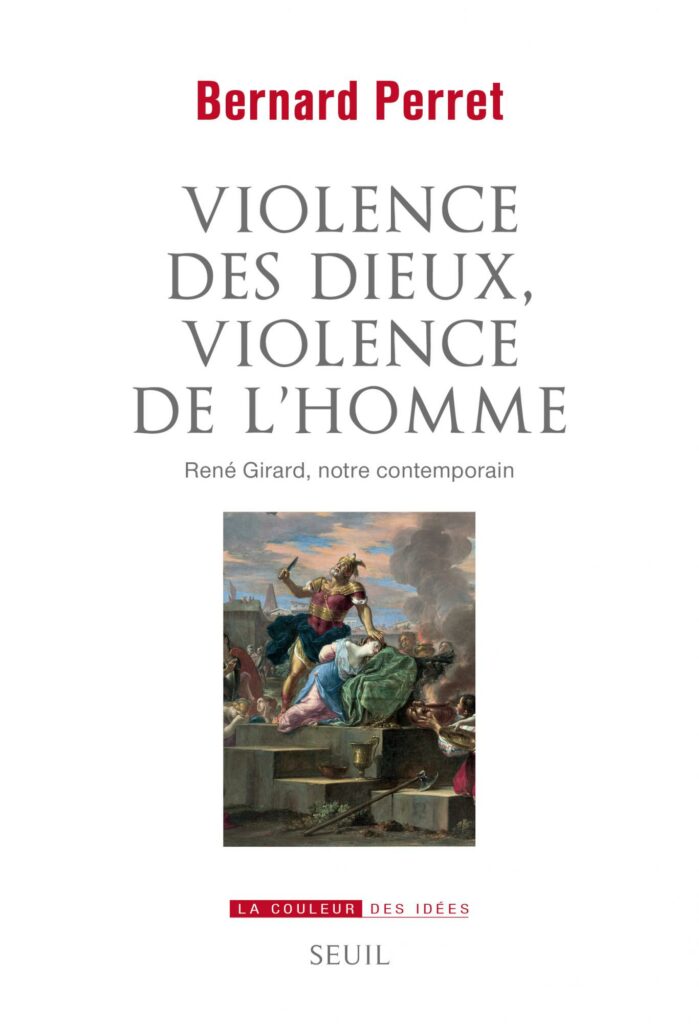Enseignant au Centre Sèvres et à l’Institut catholique de Paris, l’ingénieur et socio-économiste Bernard Perret est membre du Conseil scientifique de l’Association Recherches Mimétiques (ARM). Cinq ans après Penser la foi chrétienne après René Girard (Ad Solem), il publie une somme consacrée à l’originalité théorique du premier penseur systématique de la violence : Violence des dieux, violence de l’Homme : René Girard notre contemporain (Seuil). En revenant sur les prémisses et les conséquences de cette théorie de la violence, Bernard Perret sanctionne les limites de l’œuvre de Girard pour mieux en ressaisir la portée et la fécondité dans les recherches les plus diverses, psychologiques, ethnologiques, théologiques et politiques, et de répondre au défi contemporain d’un retour du religieux concomitant du retour de la violence historique.
PHILITT : L’on associe souvent René Girard à la découverte du « désir mimétique ». Pourtant, l’existence du désir mimétique n’a pas échappé aux Moralistes français, comme La Rochefoucauld qui remarque dans sa maxime 136 : « Il y a des gens qui n’auraient jamais été amoureux s’ils n’avaient jamais entendu parler de l’amour ». La véritable découverte de René Girard ne concernerait-elle pas le rôle de la violence plutôt que la nature du désir ?
Bernard Perret : La théorie girardienne du désir mimétique s’inscrit en effet dans une longue tradition de pensée. Vous citez à raison La Rochefoucauld, mais il faut surtout mentionner Spinoza, qui, dans L’Éthique, décrit en termes très « girardiens » le rôle de « l’imitation des affects »: « Si nous imaginons que quelqu’un aime, ou désire, ou a en haine ce que nous-mêmes aimons, désirons ou avons en haine, notre amour, etc., deviendra par cela plus constant ». Reste que, si Girard n’a pas découvert le désir mimétique, il l’a au moins redécouvert, et, surtout, il est le premier à en avoir compris toutes les implications. Au siècle dernier, c’est la pensée freudienne qui dominait la scène intellectuelle. À la suite de Freud, l’on s’était mis à penser le désir comme libido, c’est-à-dire comme avatar d’une pulsion organique, l’appétit sexuel. Cette approche du désir ne laissait aucune place à l’imitation, même lorsqu’il s’agissait d’expliquer les phénomènes de foules. Par opposition à ce bio-centrisme de la théorie du désir, Girard a remis la mimésis en son centre,ce qui permet d’en saisir la nature profondément relationnelle. Ce que l’on doit avant tout à Girard, comme vous le soulignez, c’est donc la mise évidence des liens entre désir mimétique, rivalité et violence. Son insistance sur ce lien ne va d’ailleurs pas sans un excès de pessimisme dans sa vision des relations humaines. S’il arrive à René Girard de reconnaître la spontanéité et l’authenticité de l’amour, notamment lorsqu’il commente Stendhal, force est de constater qu’il s’est surtout employé à décrire les pathologies du désir sexuel, illustratives de la manière dont les rivalités mimétiques orientent le désir. Ce que Girard, au fond, cherche avant tout à montrer, c’est que la nature mimétique du désir constitue une cause permanente de violence, et que la violence est le problème humain par excellence.
Dans Mensonge romantique et vérité romanesque, Girard écrit que « l’objet n’est qu’un moyen d’atteindre le médiateur », « c’est l’être de ce médiateur que vise le désir ». Le véritable objet du désir n’est-il pas alors le prétendu médiateur ? Auquel cas, ces assertions ne contredisent-elles pas sa propre théorie du désir triangulaire ?
Dans le modèle triangulaire, que Girard a mis au centre de ses analyses, le sujet ne désire pas l’objet parce qu’il est bon et désirable en soi, mais parce qu’il est désiré par un autre, le médiateur. Quand on y réfléchit, il devient vite clair que ce modèle ne suffit pas pour décrire la complexité du désir et des rapports mimétiques entre les individus. Il y a des désirs qui sont de nature intrinsèquement relationnelle, et ont donc une dimension mimétique, sans qu’un médiateur intervienne. C’est le cas du désir de reconnaissance tel que l’envisage Hegel dans sa Philosophie de l’Esprit. Dans mon livre, je m’appuie sur l’analyse de Jean-Paul Sartre dans L’Être et le néant pour montrer que le désir sexuel ordinaire, dans sa dimension relationnelle, est irréductible au modèle triangulaire, pour la raison fondamentale qu’il met en jeu le dédoublement des corps et des regards. Comme le montre Sartre, le corps vivant de l’autre n’est jamais pour moi un simple objet car je vois en lui, un « centre de référence secondaire qui est au milieu du monde et qui n’est pas moi », un centre autour duquel s’organise une vision du monde différente, aussi réelle que la mienne.
Le schéma triangulaire du désir serait-il donc rigoureusement caduc pour les recherches mimétiques ?
Le schème du désir triangulaire reste suggestif dans un grand nombre de situations, d’autant plus que Girard le fait « fonctionner » de manière très souple, en un certain sens transitive voire « dialectique » comme vous le suggérez. Si l’objet désiré renvoie à un médiateur qui le possède ou le désire déjà, le médiateur renvoie à son tour à une plénitude fantasmée qui n’est que l’image inversée d’un « manque d’être ». C’est ce que Girard nomme « désir métaphysique », au sens où ce désir transcende toute satisfaction partielle. Au bout du compte, le sujet désirant est toujours frustré face au caractère illimité de ses désirs. Il y a donc bien une dynamique interne à la relation triangulaire, et non une mécanique rigide entre trois pôles fixes. Le désir, par ailleurs, et malgré son caractère illimité, a généralement une base objective. Dans certains textes, Girard décrit le désir comme le résultat des « interférences mimétiques » qui se greffent sur des tendances préexistantes – appétits, besoins, pulsions, mais aussi aspirations et idéaux suscités ou promus par la culture ambiante, résultant eux-mêmes d’une sédimentation des interactions mimétiques dans la vie sociale. En définitive, le cœur de la pensée de Girard sur le désir peut se résumer à ceci : l’élément mimétique est ce qu’il y a de plus spécifiquement humain dans le désir, et partant de plus intense, de plus créateur au plan culturel et, en même temps, de plus dangereux et potentiellement destructeur par la violence qu’il recèle.
Si le désir est le résultat d’interférences mimétiques préexistantes, le mimétisme se jouerait-il donc surtout, en dépit de la spontanéité apparente de nos désirs, au niveau de la constitution des goûts et des préférences du sujet humain ?
La spontanéité apparente de nos envies et de nos désirs tend à nous faire oublier comment ils sont apparus. Il est vrai que cette genèse se confond avec le processus de notre développement psychique depuis notre naissance. Jusqu’à une date récente, sous l’influence notoire du psychologue Jean Piaget, on pensait que le jeune enfant découvrait son corps et le monde physique qui l’entoure avant d’entrer en communication avec autrui. Or, depuis la découverte des neurones miroirs, on sait que l’enfant prend conscience de l’autre comme « autre soi » en même temps qu’il se découvre lui-même comme corps propre. Par certains côtés, ces avancées rejoignent et radicalisent l’« interactionnisme symbolique » de G. H. Mead. Dans Mind, Self and Society (1934), Mead avait montré le caractère intersubjectif du processus de construction de soi, mais il en avait donné une interprétation purement comportementaliste, refusant par principe d’envisager une imitation inconsciente agissant directement sur les motivations. Pour lui, la signification que chaque individu donne à ses propres gestes et à leurs effets sur l’esprit d’autrui, n’est que le résultat d’une intériorisation des réactions conscientes de l’individu aux initiatives d’autrui, et des « attitudes » qu’elles suscitent chez cet individu. Pour Mead comme pour Girard, le « soi » émerge des interactions sociales, mais la manière dont la théorie mimétique comprend ce processus est plus satisfaisante à tous égards. Les idées de Mead peuvent être repensées et reformulées à partir de la notion d’ « intercorporéité », que le neurologue Vittorio Galese définit comme « la résonance mutuelle de comportements sensori-moteurs intentionnellement significatifs ». Pour résumer, la constitution relationnelle du sujet n’est pas, comme le pensait Mead, le résultat d’une adaptation comportementale contrôlée, de manière cognitive, aux actions d’autrui, mais le reflet d’une communication plus profonde, largement inconsciente, indissociablement cognitive, affective et sensori-motrice. Cela étant, et bien qu’il soit pour l’essentiel le produit de notre vie relationnelle, notre « moi » est une entité bien réelle. Le désir a une mémoire, et il tend à se structurer de manière stable. Jean-Michel Oughourlian, l’un des deux psychiatres qui a collaboré à l’écriture de Des choses cachées depuis la fondation du monde, nomme « moi du désir » cette identité créée par la sédimentation du désir au cours de l’existence – une structuration progressive dont le processus échappe à la conscience. C’est sur cette structure permanente du désir qu’agissent les suggestions des modèles qui se présentent à nous et qui orientent nos envies et nos aspirations.
Parallèlement à cette « sociologie mimétique » dont vous posez les jalons à partir de ces deux auteurs, en quoi la théorie mimétique s’enrichit-elle de certaines études psychologiques en neurologie ?
Les avancées de la neurologie confirment les analyses de Girard sur l’importance de l’élément mimétique dans le désir humain, mais elles suggèrent aussi que les phénomènes mimétiques constituent un monde plus vaste que celui qu’il a exploré. On ne peut d’ailleurs pas lui reprocher de l’avoir ignoré : il était très conscient du rôle de la mimesis dans l’empathie et l’amour spontané, ainsi que dans toutes les formes d’apprentissages nécessaires à la vie sociale. Cet élargissement du champ de la théorie mimétique ouvre des perspectives prometteuses dans divers domaines des sciences humaines et sociales, et aussi pour inventer de nouvelles pratiques sociales. Dans mon livre, j’évoque brièvement le « yoga du rire » ou encore la pratique, d’origine coréenne, du « gong bang », par laquelle des étudiants se filment en train d’étudier afin de s’encourager mutuellement. Ces innovations, qui peuvent certes paraître anecdotiques, donnent une idée de ce que l’on pourrait faire en utilisant de manière réflexive le pouvoir de la mimesis.
La psychologie n’est pas la seule science sur laquelle ouvrent les « recherches mimétiques » initiées par René Girard. Dans votre livre, vous regrettez en effet ce « débat qui n’a pas eu lieu » entre Girard et l’ethnologie qui le précède, en particulier celle, structuraliste, d’un Claude Lévi-Strauss. En quoi consiste le différend méthodologique et doctrinal entre les deux penseurs ?
L’apport majeur de Lévi-Strauss est d’avoir compris que toute culture est un système de signes qui se définissent par leurs oppositions mutuelles : c’est l’idée fondamentale du structuralisme. Girard reconnaissait cet apport, et il en a tiré parti. Le problème, du point de vue de Girard, c’est que Lévi-Strauss interprétait cette dynamique de différenciation et de créativité symbolique comme le reflet des structures de la pensée et du langage : elles étaient pour lui l’expression, essentiellement cognitive, d’un besoin d’ordre et de sens inhérent à l’esprit humain. Or pour Girard, ce besoin d’ordre a une raison d’être sociale : les classements et séparations permettent d’attribuer aux individus et aux groupes une place reconnue dans l’ensemble social, et de prévenir ainsi les situations de rivalité. C’est donc la question de la violence qui est au cœur du différend entre les deux penseurs – on peut noter à ce propos Jacques Derrida, dans sa Grammatologie, avait reproché à Lévi-Strauss son « rousseauisme », sa volonté de défendre, contre toute évidence, l’innocence des peuples primitifs et leur ignorance de la violence. Sur le sujet de la violence, Girard est plus proche de Mauss. Bien que ce dernier ait mis le don rituel et non le sacrifice au centre de sa théorie de l’origine de la culture, il était conscient de la menace permanente de chaos violent qui pèse sur l’existence des sociétés dépourvues de système judiciaire.
En quoi Girard, qui donne une place importante à l’étude des mythes, diffère-t-il sur ce point de Lévi-Strauss ?
C’est précisément dans la manière dont Girard et Lévi-Strauss analysent les mythes que leur différend apparaît le plus clairement. J’observe à ce sujet que la lecture girardienne, qui voit dans les mythes l’écho d’une violence fondatrice, est la seule qui donne sens à des régularités relevées par Lévi-Strauss lui-même, telle que l’élimination récurrente au cours du récit d’un individu, qui se trouve être souvent « aveugle ou boiteux, borgne ou manchot » – traits distinctifs que Girard identifie comme des « signes victimaires ». De manière plus intuitive, je ne vois pas comment écarter l’idée que les cultures primitives ont souvent dû vouloir garder une trace mémorielle des crises violentes ayant mis en péril leur existence, et des circonstances dans lesquelles ces crises ont été surmontées. Le fait que la violence constitue le point aveugle de l’anthropologie structuraliste se révèle également dans son incapacité à interpréter les rites, sinon comme des pratiques « dénuées de bon sens » qui, selon Lévi-Strauss, tournent le dos à l’effort de rationalisation à l’œuvre dans les pratiques de classification, les mythes et le totémisme. Girard, au contraire, n’a aucun mal à articuler les fonctions des mythes et des rites, et à comprendre ces derniers comme des moments de réactualisation d’une catharsis fondatrice et de refondation des différences sociales.
À propos des rites, René Girard semble identifier le sacrifice à l’expression de la violence en tant qu’acte de destruction, plutôt que comme acte d’oblation, car, selon lui, définir le sacrifice comme « un acte de communication avec le divin, c’est […] le rejeter dans l’irrationnel et l’insignifiance », résumez-vous. N’est-ce pourtant pas irrationnel seulement aux yeux de l’homme moderne, frappé d’une ignorance métaphysique ? Cette conclusion de Girard ne vient-elle pas du fait que la théorie du sacré, formulée par l’anthropologue Mircea Eliade, lui faisait tout simplement défaut ?
Girard n’ignorait pas les écrits de Mircea Eliade, qu’il lui est d’ailleurs arrivé de citer. La question que pose la confrontation de ces deux penseurs est de savoir ce qui vient en premier : l’idée de Dieu, ou la pratique du sacrifice ? Schématiquement, Eliade part d’une notion originaire du divin pour analyser à partir d’elle les différentes hiérophanies ou manifestations du sacré. Girard s’inscrit au contraire dans la perspective de Durkheim. Pour ce dernier, le sacré a une origine sociale, et l’argumentation développée dans Les formes élémentaires de la vie religieuse (1912) garde à mon avis toute sa valeur. L’un des arguments de Durkheim est que l’idée même d’une distinction entre des réalités naturelles et des réalités surnaturelles suppose un concept de nature comme ensemble de phénomènes régis par des lois. Or les idées abstraites ne peuvent émerger d’elles-mêmes dans une conscience individuelle. Elles sont indissolublement liées au langage, qui ne peut lui-même émerger qu’en tant que phénomène social. En ce sens, et de manière quasiment tautologique, il ne peut y avoir de « religion naturelle ». Bien entendu, on ne peut exclure l’existence d’une conscience religieuse pré-langagière, mais sous une forme nécessairement très confuse – on sait en effet grâce à l’imagerie cérébrale que la fixation des images dans le cerveau est liée au langage, qui est lui-même construit socialement et historiquement. Un autre argument fort contre la religion naturelle, à mon avis, est le fait que l’idée même de divinité transcendante a une histoire que l’on peut en partie retracer. Le passage, en Extrême-Orient, des rites sacrificiels brahmaniques à des formes plus rationnelles de spiritualité comme l’hindouisme puis le bouddhisme, de même que la tradition prophétique de la Bible et le développement de la culture grecque, portent tous la trace d’un cheminement qui va du sacré rituel vers une idée plus élaborée, plus « morale » et plus rationnelle de la transcendance divine. On trouve à cet égard des indications très claires dans La République de Platon. Pour résumer, Girard et Durkheim voient la religion s’émanciper progressivement du sacrifice, notamment au cours de l’âge axial (quelques siècles av. J.-C). On ne voit donc pas comment une idée bien constituée du divin pourrait précéder le sacrifice. Par conséquent, lorsque Girard évoque cette irrationalité du sacrifice défini comme communication avec le divin, il veut dire, je pense, que nous ne pouvons pas comprendre cette pratique à partir d’une idée du divin qui serait apparue avant elle, et qui nous serait immédiatement accessible.
Cette explication de l’idée du divin ou de la surnature à partir de sa genèse historico-sociale, comme l’ont fait, avant Girard, les philosophes du soupçon tel que Feuerbach avec sa méthode « génético-critique », ne revient-elle pas précisément à la vider de tout contenu intelligible ?
Ce n’est pas parce qu’une représentation a émergé à l’occasion d’un processus social qu’elle est vide de sens. Dire qu’une idée a été suscitée par un certain type d’expérience collective n’interdit pas qu’elle ait d’emblée du sens au regard de chaque expérience individuelle, ni non plus qu’elle soit adéquate pour signifier un aspect important du rapport au monde. Une fois qu’un sens de la transcendance est apparu, il va exister par lui-même dans chaque conscience individuelle, et produire des effets. Girard lui-même, dans ses derniers écrits, regrette d’avoir trop insisté sur la discontinuité entre le sacré et la conscience religieuse monothéiste. Il existe bel et bien une « unité du religieux », un sens universel de la transcendance, qui s’exprime sur un mode spécifiquement religieux dès qu’une victime est mise au centre de la vie d’un groupe.
René Girard, dans Des choses cachées depuis la fondation du monde, désigne la traditionnelle « lecture sacrificielle de la Passion » du Christ comme « le malentendu le plus paradoxal et le plus colossal de toute l’histoire », qui relève de « l’impuissance radicale de l’humanité à comprendre sa propre violence ». Ce faisant, n’est-ce pas la tradition chrétienne toute entière que Girard révoque comme un colossal malentendu, étant donnée notamment la place centrale du sacrement de l’Eucharistie ? Dans ces conditions, n’est-il pas contradictoire de voir en Girard un penseur chrétien, comme il prétendait l’être ?
Revenons aux Évangiles. Le récit de l’institution de l’Eucharistie est très clair : lors de la Cène, Jésus dit « prenez et mangez, ceci est mon corps ». Ce n’est donc pas à Dieu qu’il se donne, mais aux humains. Il ne s’agit pas d’un sacrifice au sens religieux habituel, mais plutôt d’un « anti-sacrifice » : Jésus, et donc Dieu à travers lui pour la théologie chrétienne, se soumet délibérément à la violence des hommes pour la dévoiler et les aider à s’en libérer. Dans mon livre, je donne de nombreux exemples de l’attitude « anti-sacrificielle » de Jésus : lorsqu’il renverse, par exemple, les tables des marchands du Temple, il met littéralement « à terre » les offrandes que les juifs de l’époque achetaient sur le parvis pour les offrir en sacrifice dans le temple. Il est difficile de ne pas y voir une attaque contre la pratique sacrificielle elle-même. Le fait évident que Jésus est la victime innocente archétypale qui se soumet librement à la violence humaine, n’a jamais été perdu de vue par les chrétiens, mais il est vrai que l’on a assisté, surtout à partir du IIIe siècle, à la montée en puissance d’une interprétation sacrificielle de la mort de Jésus, culminant au moyen-âge avec Anselme de Cantorbéry, en phase avec une ritualisation de la célébration eucharistique réutilisant les « codes » du sacrifice (« consécration », etc.), sans que l’on s’interroge sur la pertinence de la notion de sacrifice dans ce contexte. L’une des difficultés sous-jacentes est que le fait de mettre l’accent sur les circonstances violentes de la mort de Jésus a souvent conduit à accuser les juifs. De ce point de vue, l’apport de Girard est essentiel, car il montre que les Évangiles cherchent surtout à souligner le caractère universel de la violence révélée par la mise à mort de Jésus. Aujourd’hui, même si la liturgie reste équivoque, l’interprétation anti-sacrificielle de Girard n’est pas réellement contestée par les théologiens chrétiens, catholiques comme protestants. Par ailleurs, la dérive sacrificielle du christianisme n’a pas empêché le sens anti-sacrificiel de la Passion d’être intuitivement saisi et, dans une certaine mesure, intégré dans les mentalités. Girard ne manquait pas de souligner que Nietzsche avait parfaitement compris ce point. Dans la perspective nietzschéenne, le christianisme s’oppose frontalement à la logique du sacré archaïque, celle qui sous-tend la sacralisation de la violence : c’est le sens que donnait Nietzsche à l’opposition archétypale entre la figure de Dionysos et celle du Crucifié.
Pourtant, Jésus ne rejette pas le sacrifice. Il le maintient, en n’en parlant d’ailleurs que comme une oblation et non comme une destruction, mais tout en restaurant sa véritable signification : « Si donc tu présentes ton offrande à l’autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l’autel, et va d’abord te réconcilier avec ton frère ; puis, viens présenter ton offrande » (Matthieu V, 24).
Il s’agit certes, dans ce cas, plus d’une subordination que d’une suppression du sacrifice. Mais il n’en demeure pas moins que cela change tout, car le sacrifice devient soudain quelque chose de secondaire par rapport aux impératifs de conversion et de réconciliation. Cela dit, il est vrai que Girard a changé d’avis sur l’emploi du mot sacrifice. Dans ses derniers textes, rompant avec son point de vue « anti-sacrificiel », il reconnaissait l’existence et la valeur d’un « sacrifice de soi », d’un « sacrifice par amour », au motif que l’on ne peut se passer de la radicalité signifiée par ce mot : l’idée est que seule la radicalité éthique du don christique de soi peut s’opposer à la puissance « diabolique » de la violence mimétique et des emballements persécuteurs.
Si la Passion du Christ renverse les mécanismes naturels de la violence selon Girard, toujours est-il que les sacrifices qu’il prétend observer dans les mythes non-chrétiens jouent, selon lui, un rôle de régulateur de la violence. Dans notre société sécularisée où l’on ne pratique plus de sacrifice religieux à caractère public, comment cette violence peut-elle donc être régulée ? La mémoire du génocide des Juifs (de la « Shoah ») aurait-il été le point d’arrêt de l’hubris moderne, son humiliation providentielle par l’instauration d’un nouveau mythe sacrificiel ?
Dès le début de La violence et le sacré, Girard souligne l’importance du système judiciaire comme condition de possibilité d’une société sécularisée. La justice, c’est une évidence, procède assez directement du sacrifice. Plus largement, la genèse de la culture et des institutions est vue par lui comme une processus de différenciation à partir d’une matrice sacrificielle. Il faut cependant reconnaître qu’il n’est pas allé très loin dans l’analyse de ce processus. Dans une certaine mesure, des auteurs « girardiens » s’y sont attelés. Il est clair, par exemple, que l’économie de marché joue un rôle majeur pour endiguer la violence et rendre les rivalités socialement utiles. Parallèlement à ce processus au long cours de « métabolisation » des rivalités (par le sport, les compétitions électorales, etc.), le sacré au sens plus traditionnel continue à jouer un rôle, notamment à travers la quasi sacralisation des victimes – une forme de sacré qui, de toute évidence, doit beaucoup au christianisme. La mémoire du génocide des Juifs en est l’une des expressions. Si Girard a peu développé l’analyse de ces phénomènes, c’est en partie au moins parce que l’orientation de sa pensée était profondément apocalyptique. Il était pénétré de l’idée que l’humanité se rapproche inexorablement d’un moment de vérité où elle devra choisir entre l’anéantissement et une conversion à la non-violence radicale, c’est-à-dire, pour lui, à l’amour christique. Tout en prenant ses avertissements au sérieux, j’essaie dans mon livre de développer une vision plus ouverte de l’avenir de l’humanité, sans pour autant retomber dans un progressisme naïf.
Vous repérez d’ailleurs une application importante de la théorie girardienne de la violence en philosophie politique. Souvent minimisée, et pourtant importante chez Max Weber, l’attribution à l’État du « monopole de la violence légitime » est aujourd’hui fortement discutée à propos des « violences policières ». En quoi ce rôle central de la violence en politique amène-t-il René Girard à réévaluer à la fois la théorie moderne du contrat social et la bipartition schmitienne du politique entre amis et ennemis ?
Girard était très critique à l’égard de la théorie de Jean-Jacques Rousseau. Selon lui, la fiction du contrat social est fondée sur la croyance que les humains sont capables de maîtriser leur violence grâce à leur seule raison. Girard voyait plutôt l’État comme l’aboutissement contingent d’une longue suite de métamorphoses des institutions issues du sacrifice – parmi lesquelles la royauté sacrée – sous la contrainte pratique de limiter les effets destructeurs de la violence, ce qui le rapproche plutôt de Thomas Hobbes, dont le style d’explication reste cependant, à ses yeux, trop centré sur l’individu supposé rationnel. Son pessimisme semble le rapprocher de Carl Schmitt : pour le juriste allemand, partout où il y a politique, il y a « discrimination de l’ami et de l’ennemi ». Schmitt avait indéniablement raison de souligner l’élément d’antagonisme inhérent à toute forme d’union politique : on s’unit toujours contre un ennemi. Girard ne voyait pas les choses différemment, mais il n’approuvait pas, pour autant, les prétentions normatives de la théorie schmittienne. Il n’était pas question pour lui d’ériger le principe ami-ennemi en règle d’action, ne serait-ce que pour la raison que toute situation d’antagonisme est susceptible de dégénérer. De par sa nature mimétique, la violence risque toujours de déboucher sur une « montée aux extrêmes », pour reprendre la formule de Clausewitz. Au regard de la théorie mimétique, l’apologie schmittienne d’une guerre menée « dans les règles », conçue comme une institution régulatrice, reflète l’illusion largement partagée qui porte à croire que l’on peut maîtriser rationnellement la violence, l’instrumentaliser. Au contraire, la thèse défendue par Girard dans son dernier ouvrage Achever Clausewitz (2007) est que la guerre moderne tend à échapper à toute limitation. La désacralisation girardienne de toutes les institutions affecte aussi la guerre : aucun dispositif ne peut nous prémunir de manière certaine contre l’emballement mimétique de la violence. Même le « monopole de la violence légitime » détenu par l’État à l’intérieur des frontières d’une nation ne peut être considéré comme définitivement acquis – on le voit tous les jours. D’où la nécessité vitale d’affronter la violence en nous, à la racine, en commençant par prendre conscience de ses mécanismes anthropologiques.
Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.